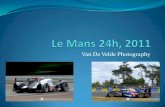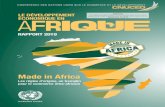République Démocratique du Congo Justice –Paix – Travail · 2009-09-05 · Le système...
Transcript of République Démocratique du Congo Justice –Paix – Travail · 2009-09-05 · Le système...

République Démocratique du Congo
Justice –Paix – Travail
PPllaann ddeess PPeeuupplleess AAuuttoocchhttoonneess
Rapport Final
(Février 2007)
Préparé par Dr. Kai Schmidt-Soltau Email: [email protected] Webpage: www.Schmidt-Soltau.de

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 2
SOMMAIRE
Résumé exécutif – Synthèse des Conclusions ...................................................................5
Executive Summary................................................................................................................8
1. Introduction....................................................................................................................11
2. Description du Projet GEF-BM .....................................................................................13
3. Informations de base sur les populations autochtones ............................................16
3.1. Economie et Environnement.......................................................................................18 3.2. Le système traditionnel de tenure foncière.................................................................19 3.3. Les impacts des projets de conservation....................................................................22 3.4. Les interactions avec les groupes ethniques voisins..................................................24 3.5. Organisation sociale ...................................................................................................26 3.6. Examen du cadre légal ...............................................................................................27
4. Consultation..................................................................................................................28
5. Evaluation des impacts et propositions des mesures d’atténuation spécifiques aux populations autochtones.......................................................................................29
6. Analyse des capacités .................................................................................................34
7. Responsabilités de la mise en œuvre..........................................................................40
8. Suivi et évaluation .........................................................................................................40
Annexe 1 : Politique opérationnelle «peuples autochtones» (PO 4.10) de la Banque Mondiale .......................................................................................41
Annexe 2 : Bibliographie..............................................................................................47
Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées.............................................................51
Annexe 4 : Projet de Termes de Référence relatifs à la mise en œuvre du PPA du Projet GEF-BM ......................................................................................53
Annexe 5 : Les ateliers de validation à Kinshasa et Beni ........................................ 59

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 3
Abréviations AAPDMAC Action d’Appui pour la Protection des Droits de Minorités en Afrique Centrale ACOPA Action Communautaire de lutte Contre la Pauvreté ACORDI Action Communautaire pour le Développement Rural Intégré ADELIPO Action de Développement pour la Promotion des Droits humains et Gestion des Intérêts des Pygmées
Originaires AFD Agence Française de Développement AGIR Agro-Industrie Rurale AIMPO African Indigenous Minorities People Organisation ANPANMNP/PFNB Association Nationale du Premier Peuple Autochtone Natif et Minorité Nationale Pygmées en RDC – Plate-
forme nationale des Batwa AP Aires protégées APF African Parks Foundation ARAP Action pour le Regroupement et l’auto promotion des Pygmées Ass PA Associations des peuples autochtones AWS African Wildlife Society BM Banque Mondiale CADAK Coordination des Activités de Développement Autour de Kyavirimu CADDE Centre d’Action pour le Développement Durable et l’Environnement CAF Collectif des femmes de Beni CAMV Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables CBD/ CDB Convention sur la Diversité Biologique CEFDHAC Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale CENDEPYC Centre d’Encadrement et de développement des Pygmées au Congo CI Conservation International CIDB Centre international de défense des Droit des Batwa CNCJA Conseil National de Concertation des Jeunes Autochtones. CoCoCongo Coalition pour la Conservation au Congo CoCoSi Comité de Coordination du Site com. pers. communication personnelle COPEVI Coopératives des Pêcheurs de Vitshumbi CPAKI Collectif pour le Peuple Autochtone du Kivu CPoR Cadre de Politique de Réinstallation CPrR Cadre procédural de Réinstallation CR Cellule de réinstallation Réseau CREF Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers du Nord – Kivu CRU Central Resettlement Unit of the ICCN CT Cellule technique de recasement DAC Development Assistance Committee DCE Délégation de la Commission Européenne DFGF-E Dian Fossey Gorilla Fund Europe DFGF-I Dian Fossey Gorilla Fund International DRC Democratic Republic of Congo DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté ECO ACTION Eco Action ECODEC Ecologie et développement au Congo ECOFAC Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Forestiers en Afrique Centrale (Programme UE) EIE Etude d’Impact sur l’Environnement EIS Etude d’Impact Social FAO Food and Agricultural Organisation FPP Forest People Project FYDHO Fondation Yira pour la défense des Droit de l’Homme FZG Société Zoologique de Francfort GEF Global Environmental Facility (Fonds Mondial pour l’Environnement) GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit und Entwicklung ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ILO International Labour Organisation INICA Initiative for Central Africa INS Institut Nationale de Statistique IP Indigenous Peoples IPP Indigenous Peoples Plan KfW Kreditanstalt für WIederaufbau LINAPYCO Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo LRU Local Resettlement Units LZS Société Zoologique de Londres MAB Man and Biosphere (UNESCO) MECACAP Ministère Evangélique de Chaque Arbre pour Christ Auprès des Pygmées MECNEF Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature, Eaux et Foret (RDC) MEFEPCN Ministère de l’Économie Forestière, de la Pêche, et de l’Environnement, chargé de la Protection de la
Nature (Gabon) MENAPYC Médecine Naturelle des Pygmées au Congo MINEF Ministère de l’Environnement et des Forêts (Cameroun) MST/SIDA Maladie Sexuellement Transmissible/ NP National Park

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 4
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OIT Organisation internationale du Travail ONG Organisations Non Gouvernementale OP Operational Policy OSFAC Observatoire Satellitaire des Forêts d’Afrique Central PA Peuples Autochtones P.A. Protected Area PAD Project Appraisal Document PAM Programme Alimentaire Mondial PAP-RDC Programme d’Appui aux Pygmées en RDC PAP Persons Affecte par le Project PAR Plan d'Action de Réinstallation PED Personnes Economiquement Déplacées PEVi Programme Environnemental Autour des Virunga PFNL Produits Forestiers Non Ligneux PGS Plan de Gestion Sociale PIDP Programme d’Intégration et de Développement des Pygmées PIM Participatory Impact Monitoring PMEF Petites et Moyennes Exploitations Forestières PN Parc National PNG Parc National de Garamba PNKB Parc National de Kahuzi Biega PNVi Parc National des Virunga PNUD Programme des Nations unies pour le Développement PNVi Parc National des Virunga PO Politique operational de la Banque Mondial PPA Plan des Peuples Autochtones PPD Personnes Physiquement Déplacées PREPYG Le Programme de Réhabilitation et Protection des Pygmées ; PSFE Projet Sectoriel Forêts et Environnement PSR Plan Succinct de Réinstallation RAPY Réseau des Associations Autochtones Pygmées RDC République Démocratique du Congo REPALEAC Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers
d’Afrique central. RMIP/AT Relance de la Mission d’Installation de Paysanat pour l’Amenagement de la Terre RP Resettlement Plan RPrF Resettlement Process Framework RPoF Resettlement Policy Framework SEIPI Santé, Education et intégration des Populations Inaccessibles SIGEF Système d’Information et de Gestion des Eaux et Forêts SIPA Solidarité pour les Initiatives des Peuples Autochtones SOCIDEC Solidarité pour le Civisme et le développement au Congo SoDéRu SoDéRu SPAR Syndicat des Paysans UDME Union pour le Développement des Minorités Ekonda UE Union Européenne UEFA Union pour l’Emancipation de la Femme Autochtone UICN Union Mondiale pour la Nature UICN-TILCEPA Union Mondiale pour la Nature - Theme on Indigenous and Local Communities, Equity and Protected Areas UNEP United Nations Environment Programme UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UN-OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs VONA La Voix de la Nature WB World Bank WCS Wildlife Conservation Society WFP World Food Programme WPC World Park Congress WWF Fonds Mondial pour la Nature WWF/CARPO Fonds Mondial pour la Nature / Central Africa Programme Office

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 5
RRééssuumméé eexxééccuuttiiff –– SSyynntthhèèssee ddeess CCoonncclluussiioonnss
Dans la perspective d'une restructuration, la République Démocratique du Congo (RDC) a entrepris un vaste chantier de réformes structurelles destinées à l'amélioration de la gestion de ses ressources naturelles. La Nouvelle Vision pour la Conservation des Aires Protégées dans la RDC vise une «gestion efficace et coordonnée d’un réseau d’aires protégées afin d'assurer que la conservation de la nature sera une composante intégrale du Programme National de Forêt et de Conservation de la Nature et du Programme National de Lutte contre la Pauvreté». Pour la mise en oeuvre de sa nouvelle vision, le Gouvernement de la RDC a demandé, à travers de la Banque Mondiale (BM), une aide financière auprès du Fond pour l’Environnement Mondial (GEF). Le Projet GEF-BM est composé de trois composantes:
Composante 1: Appui à la réhabilitation institutionnelle de l'ICCN (niveau national) Composante 2: Appui aux parcs nationaux Virunga et Garamba (niveau des sites) Composante 3: Expansion du réseau des aires protégées (niveau national)
Le Projet GEF-BM est susceptible d'avoir des conséquences sur les populations rurales à travers l’identification des nouvelles aires protégées avec une superficie de 10 millions hectares, la mise en place des aires protégées avec une superficie de 2 millions hectares et l'amélioration de l’aménagement des parcs nationaux Virunga et Garamba avec une superficie totale de 1,3 millions hectares. Les effets généraux ont été analysés dans l'étude sur l'impact social (EIS), mais la meilleure pratique - la Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale sur les Peuples Autochtones (PO 4.10) - exige une action particulière lorsque les investissements de la Banque Mondiale impliquent des peuples autochtones, qui sont représentés, en RDC, par les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka. Dans la zone tampon du Parc National de Virunga, il y a environ 12.000 individus appartenant aux groupes Twa et Mbuti et dans les autres zones rurales destinées à l’identification des nouvelles aires protégées encore environ 100.000 -200.000 individus appartenant à ces peuples autochtones.
Compte tenu de l’existence des impacts du Projet GEF-BM sur les populations autochtones, la préparation d'un Plan des Peuples Autochtones (PPA) est une condition fixée par la PO 4.10. L’objectif principal de ce PPA, consiste à assurer que le Projet GEF-BM respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations autochtones et à assurer en même temps que les peuples autochtones en retirent des avantages adaptés au niveau socio-économique et culturel. Ce rapport démontre la manière dont ces objectifs peuvent être atteints et il prévoit des mesures destinées: a) à éviter les incidences susceptibles d'être préjudiciables aux populations autochtones concernées; ou b) au cas où cela ne serait pas possible, à atténuer, minimiser ou encore à compenser de telles incidences. La Banque Mondiale n’accepte le financement d'un projet que lorsque ce projet obtienne un large soutien de la part des populations autochtones à l’issue d’un processus préalable de consultation libre et informée.
Ce rapport a pour objet de présenter le résultat d’une étude à court terme menée dans le cadre d'une approche participative et en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (populations autochtones, autres populations rurales, ONG, agences gouvernementales, bailleurs etc.). Le rapport lui-même ainsi que des recommandations ont été discutées et approuvés au cours des ateliers de validation (Kinshasa 10/1/2007 et Beni 13/1/2007) avec la participation de toutes les parties prenantes.
D'un point de vue légal, tous les peuples autochtones sont à considérer comme des citoyens égaux par rapport à toutes les autres composantes de la population Congolaise. Or, il se trouve que, par rapport aux autres Congolais, les peuples autochtones n’ont pas la même influence politique, ni le même statut légal, organisationnel, technique ou économique. Si des mesures particulières et adaptées ne sont pas prises, des interventions dans la forêt, telles que la conservation de la biodiversité, obligent les populations chasseurs-cueilleurs d’abandonner les zones forestières dans lesquelles elles vivent de la chasse et de la cueillette sans que leurs droits d'utilisation soient pris en compte ou qu'elles soient compensées de quelque manière que ce soit. L’impact sera donc l'accélération du processus de la marginalisation, de la sédentarisation et de l’appauvrissement des populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka.
La dépendance accrue vis-à-vis de l’agriculture, de la vie sédentaire pendant une bonne période de l’année, et le désir d’accéder aux services sociaux, ont-ils pu transformer les communautés des peuples autochtones en citoyens à part entière de la RDC tout comme tous les autres Congolais? Certainement pas. Pas un seul parmi les populations Twa, Mbuti, Cwa ou Aka n'est employé comme fonctionnaire public et seulement trois de tous les villages en RDC avait été représentés par un chef autochtone. Même dans celles des localités où les peuples autochtones forment entre 50 à 70% de la population entière, presque aucun de ses chefs n’était issu lui-même de ces populations. Des estimations brutes

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 6
sur leurs revenus en espèces indiquent que les ménages de ces populations ne disposent qu'un dixième par rapport au revenu moyen dans les zones rurales du pays (USD 0,02 par jour et par personne); et elles ne disposent pas non plus des moyens et influences nécessaires pour s’acquérir des titres fonciers à l'intérieur de leurs différentes zones d’usage et de ce qui reste de leur ancien pays natal par rapport aux intérêts provenant de l'extérieur.
Le Projet GEF-BM propose des mécanismes d'amélioration des conditions de vie dans les zones d’intervention du Projet à travers une gestion durable des aires protégées. Mais en considérant l'état actuel des choses, il semble très peu probable que les peuples autochtones soient encouragés à y participer quand on sait que leurs campements/villages ne sont pas reconnus comme «localité» à part entière et qu'ils ne peuvent, de ce fait, interagir avec les services du gouvernement qui, lui, ne travaille pas avec des individus ou villages, mais avec des «localités». Les peuples autochtones, pendant qu'ils dépendent principalement de la forêt, n'y ont pas d'accès légal. Il paraît alors bien claire que, sans mesures particulières et adaptées à leur égard, ils ne pourront pas être parmi les bénéficiaires du Projet GEF-BM. Or, l’ICCN devra assurer qu'à cause de la réhabilitation et expansion du réseau des aires protégées dans le contexte du Projet GEF-BM, ces populations ne:
• perdent le contrôle des terres et des zones d’usage qu’elles utilisent traditionnellement comme source de subsistance et qui représentent en même temps le fondement de leur système culturel et social,
• soient marginalisés encore davantage au sein de la société congolaise, • se désintègrent davantage à l’intérieur du système décentralisé d’administration, • bénéficient moins d’assistance des services gouvernementaux à la suite de la réhabilitation des routes, • soient encore moins capables de défendre leurs droits légaux, • deviennent ou demeurent dépendants envers les autres groupes ethniques, • perdent leur identité culturelle et sociale.
Afin d'atténuer ces risques, 9 activités ont été conçues par l’ICCN dans le contexte du Projet GEF-BM. C'est la conviction mutuelle que seulement l'entière mise en oeuvre du PPA ainsi que de toutes ses composantes, pourrait garantir le respect des exigences de la PO 4.10 et assurer que le Projet GEF-BM respecte pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations autochtones et leur offre des opportunités équivalentes aux bénéfices obtenus par le Projet GEF-BM. Le Projet GEF-BM a entrepris de:
Etablir des opportunités légales égales • Mettre en place les capacités nécessaires à la mise en oeuvre d’un PPA suivant la PO 4.10; • Reconnaître et protéger les campements et les zones d’usage des peuples autochtones à l'intérieur
des aires protégées existantes et proposées ainsi que de leurs zones tampons;
Etablir des opportunités techniques égales • Donner aux peuples autochtones les capacités techniques leur permettant de participer activement
à la gestion et au processus d'identification des nouvelles aires protégées; • Développer les capacités techniques du personnel de l'ICCN ainsi que de ses partenaires en vue
d’une meilleure coopération avec les peuples autochtones; • Sensibiliser les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka sur les risques du processus de développement;
Etablir des opportunités financières égales • Assurer que les villages habités par les peuples autochtones reçoivent leur tranche des revenus
générés par les aires protégées; • Offrir des programmes spéciaux destinés aux populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka pour les faire
bénéficier de l'ouverture des postes et d'emplois dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet GEF-BM (garde de parc, pisteur, etc.);
Etablir des opportunités organisationnelles égales • Faciliter la représentation des peuples autochtones dans les instances de prise de décision
concernant la conservation de la nature, la gestion des aires protégées y compris ses zones tampons et l’identification des espaces destinés aux nouvelles aires protégées;
• Etablir un système de suivi et d’évaluation participative pour le PPA et le Projet GEF-BM.
Les acteurs principaux du PPA constituent l’ICCN et ses partenaires de la conservation, les ONG nationales et internationales travaillant de concert avec les populations autochtones en RDC, les associations des peuples autochtones ainsi que les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka eux-mêmes. L'analyse des capacités a prouvé que: a) L'ICCN ne dispose que de très peu de capacités dans le secteur social et que, dans sa constitution actuelle, elle ne pourra pas réussir dans l'acquisition des

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 7
compétences nécessaires à la mise en œuvre du PPA dans le délai prévu; b) que les institutions de l'Etat en charge des populations marginalisées s'avèrent beaucoup trop faibles et, sans investissements techniques et financiers, incapables d'implanter le PPA; c) que quelques-unes parmi les associations des peuples autochtones et les ONG travaillant de concert avec les populations autochtones disposent de certaines connaissances pour la mise en œuvre du PPA à condition d'être soutenues et supervisées. C'est en tenant compte de cette situation qu'il a été décidé que la mise en œuvre du PPA devra se faire par un réseau des associations des peuples autochtones et des ONG oeuvrant en collaboration avec elles sous la supervision d'une mission internationale de contrôle soutenant et accompagnant la mise en œuvre du PPA.
Globalement, on peut estimer que les 9 activités du PPA seraient suffisantes pour assurer l'exécution du Projet GEF-BM en accord avec la PO 4.10, et que le Projet: • renforcera les systèmes traditionnels de gouvernance et promouvra le respect du dialogue
communautaire et des droits coutumiers de tous les citoyens en RDC; • réduira la pauvreté de toutes les populations et encouragera un développement durable; • déclenchera des impacts positifs sur la population entière, plus particulièrement sur les peuples les
plus pauvres, marginalisés et vulnérables, c'est-à-dire les peuples autochtones; • respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des peuples autochtones; • s’assurera que, à l'intérieur de la zone d’intervention, les peuples autochtones reçoivent les bénéfices
culturellement adaptés et aussi équivalent à ceux que reçoivent tous les autres groupes; • assistera les peuples autochtones à améliorer leur situation de vie.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 8
EExxeeccuuttiivvee SSuummmmaarryy In an attempt to enhance the contribution of biodiversity conservation to pro-poor and sustainable growth, the Government of the Democratic Republic of Congo (DRC) has put in place a comprehensive reform agenda in the area of natural resource management. The New Vision for the conservation of protected areas in the DRC foresees “an effective and well coordinated management of a network of protected areas to make sure that biodiversity conservation is an integral part of the National Forest and Biodiversity Programme and the national Poverty Reduction Strategy”. For the implementation of this new vision the Government of the DRC has requested - through the World Bank (WB) - financial assistance from the Global Environmental Facility (GEF). The GEF-WB Project consists of three components:
Component 1: Support to ICCN institutional rehabilitation (national level); Component 2: Support to selected key national parks (site level); Component 3: Expansion of the protected areas network (national level).
It is expected that the GEF-WB Project impacts on the rural populations through its support to the identification of new protected areas with a surface area of 10 Million ha, the establishment of new protected areas with a surface area of 2 Million ha and the enhanced management of two national parks (Virunga and Garmamba) with a total surface area of 1.3 Million ha. The general impacts are analyzed in the Social Impact Assessment of the Project GEF-BM, but best practice - the World Bank’s Operational Policy on Indigenous Peoples (OP 4.10) - requires that the borrower engages in a process of free, prior, and informed consultations if a project affects indigenous peoples. In the DRC, these are the Twa, Mbuti, Cwa and Aka. Around 12,000 Twa and Mbuti live in the buffer zones of the Virunga National Park and around 100,000 – 200,000 indigenous peoples are depending on those areas, which might be identified to become new protected areas.
For all projects, which affect indigenous peoples, the elaboration of an Indigenous Peoples Plan (IPP) is requested by the OP 4.10. Its objective is to make sure, that the GEF-WB Project respects the dignity, human rights, economies, and cultures of the indigenous populations in the DRC and provides them equal and culturally appropriate benefits, which should be defined in free, prior and informed consultations. The IPP elaborates strategies on how this can be achieved and establishes detailed measures how to (a) avoid potentially adverse effects on the Indigenous Peoples' communities; or (b) when avoidance is not feasible, minimize, mitigate, or compensate for such effects. The Bank provides project financing only where free, prior, and informed consultation resulted in broad community support to the project by the affected indigenous peoples.
The reports presents the findings of a short term consultancy carried out in a participatory manner and in close cooperation with all stakeholders (indigenous peoples, other populations, NGOs, governmental services, donors etc.).The report has been discussed on two workshops (Kinshasa 10/1/2007 & Beni 13/1/2007) and consequently adopted by all stakeholders.
From the legal point of view are the indigenous peoples of the DRC citizens like all other Congolese, but they don’t have the same political influence and/or the legal, organizational and technical capacities to defend their rights, interests and culture as others. As the laws of the DRC do not recognize the user rights of indigenous peoples in protected areas, the expansion of the protected area network and the enforcement of conservation laws in the Virunga National Park and its buffer zones – both financed under the GEF-WB project – would force the mobile hunter-gatherers to leave their “impenetrable” forests, if no specific and innovative mitigation measures put in place. Despite the fact that everybody knows that indigenous peoples depend much more than others on forests resources (hunting, gathering and fishing generate 90% of their livelihoods) this would happen without taking their rights into considerations and/or providing any compensation. This would consequently lead to an increasing marginalization, sedentarisation and impoverishment of the Twa, Mbuti, Cwa and Aka.
Would such an increased dependence on agriculture and more permanent lifestyle, the access to social services etc. transform the indigenous people into citizens like all other Congolese? Decidedly not! Not a single Twa, Mbuti, Cwa or Aka works as civil servant and in the entire DRC only three villages have an indigenous chief. Even in those areas where the indigenous peoples constitute between 50 and 70% of the population hardly any chief is Twa, Mbuti, Cwa or Aka. Rough estimates suggest that their cash income is ten times lower than of any other social group (< US$ 0.02 per day and per capita). They don’t even have the means to obtain legal titles for their land use zones and to defend their traditional land.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 9
The Project GEF-WB proposes mechanisms to improve the living conditions of local communities through the sustainable management of protected areas, but at the present state it is most likely, that the indigenous peoples’ communities will not be able, or enabled, to participate in the collaborative management or the benefit sharing schemes, because their settlements are not recognized as ‘localité’, which is the lowest administrative unit in the DRC, and therefore they cannot interact legally with government services, which only interact with recognised structures.
While they are the most dependent on the forest for their subsistence and incomes, they have no legal access to it. Without special measures, the indigenous peoples will not be able to benefit from the GEF-WB Project, which is in principle and by intention open to everyone. There are several major risks resulting from the GEF-WB Project, which have to be mitigated to insure that the Twa, Mbuti, Cwa and Aka do not
• lose control over the forests traditionally utilized by them as source of livelihood and basis for their cultural and social system,
• become even more marginalized in the society, • disintegrate for the decentralized system of administration, • receive less assistance from governmental services, • have fewer capacities to defend their legal rights, • become or remain as dependents of other ethnic groups, • lose their cultural and social identity.
The ICCN foresees 9 activities to address these risks of the GEF-WB Project. It is a mutual understanding that only the full and timely implementation of the IPP and all its components fulfils the requirements of the OP 4.10 and guarantees that Project respects the dignity, human rights, economies, and cultures of the indigenous peoples and offers them equal opportunities to participate in the benefits of the project. To achieve this, the GEF-WB Project will undertake the following activities:
Establish equal legal opportunities • Put in place the capacity and structures needed to implement the IPP in line with the OP 4.10; • Identify, recognize and protect the settlements and land use areas of indigenous peoples in protected
areas and their buffer zones;
Establish equal technical opportunities • Provide the indigenous peoples with the capacities to participate actively in the management of
protected areas and the identification and demarcation of new protected areas; • Enhance the capacities of ICCN staff and its partners in intercultural communication so that they
can actively cooperate with the indigenous peoples; • Sensitize the Twa, Mbuti, Cwa and Aka on the risks of the development process;
Establish equal financial opportunities • Make sure that indigenous peoples’ communities receive a fair share of the redistribution of
revenues generated by the protected areas; • Offer special conditions for Twa, Mbuti, Cwa and Aka to have equal access to jobs resolving from
the GEF-WB Project;
Establish equal organizational opportunities • Facilitate the participation of the indigenous peoples in all decision making processes related to
biodiversity conservation, protected area management and the identification of new protected areas; • Establish a participatory monitoring and evaluation system for the IPP and the GEF-WB Project.
The main actors of the IPP are the ICCN, its conservation partners, national and international NGOs working with indigenous populations in the DRC, the associations of the indigenous peoples and the Twa, Mbuti, Cwa and Aka themselves. The capacity analysis documented that a) ICCN and its conservation partners have very limited capacities in the social sector and are under the present setting not able to acquire the skills necessary to implement the IPP within the limited timeframe available for this project; b) that the governmental bodies in charge of marginalized populations are extremely weak and not able to implement the IPP without significant financial and technical inputs; c) that some of the associations of the indigenous peoples and NGOs working with indigenous peoples have some knowledge and are - with some backstopping and supervision - able to implement the IPP. Due to that, most activities of the IPP will be implemented by a consortium of indigenous peoples’ associations and NGOs working with indigenous peoples under the supervision of an international control mission, which will supervise and backstop the IPP implementation.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 10
It is assumed that the 9 activities of the IPP are able to guarantee that the GEF-WB Project is implemented in accordance with the OP 4.10 and that the Project: • strengthens traditional systems of governance and natural resource management and embraces
the notion of community dialogue and traditional rights for all ethnic groups of the DRC; • reduces poverty for all ethnic groups and lowers the degradation of natural resources and
promotes sustainable development; • installs an effective management system of protected area and national park management, which
offers positive impacts to the biodiversity, to the rural population in general and the poorest, most marginalised and vulnerable populations – i.e. the indigenous peoples – in particular;
• respects the dignity, human rights, economies, and cultures of the Twa, Mbuti, Cwa and Aka; • assures that the indigenous populations benefit equally and in an cultural appropriate manner from
the GEF-WB Project; and • assists the Twa, Mbuti, Cwa and Aka to increase their living conditions.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 11
11.. IInnttrroodduuccttiioonn La République Démocratique du Congo (RDC) est, quant à sa diversité biologique, l‘un des plus importants pays du monde entier. La valeur de cette richesse biologique est d’une extrême importance pour le pays lui-même, la région et pour le monde entier, et elle est, de ce fait, capable de jouer un rôle-clé dans la lutte contre la pauvreté. Le management des aires protégées constitue un des éléments essentiels à l'intérieur de la stratégie sectorielle forestière. 64 aires protégées (dont sept parcs nationaux) couvrent actuellement 18 millions d’hectares soit 7,7% du territoire national (carte 1). Mais tout le monde sait aussi que la majorité, si non toutes les aires protégées de la RDC n’existent plus que sur papier. En dehors de la nécessité de réhabiliter ces aires protégées menacées de disparition, il serait également prévu, au cours des prochaines dix années, de doubler la surface sous protection (15% selon le Code forestier), ce qui veut dire que le gouvernement de la RDC sera obligé de ré identifier, de ré négocier et de ré démarquer ainsi que de mettre sous management un total de 36 millions d’hectares que couvrent les aires protégées. Ceci constitue un défi majeur.
Durant l’époque coloniale, les parcs nationaux furent créés surtout pour la recherche et la conservation, tandis que les réserves de chasse servaient de terrains de loisir à une élite de chasseurs. Et c'est depuis l’indépendance que le développement du tourisme a été beaucoup plus privilégié comme source de revenues. Mais les populations n'étaient à aucun moment impliquées dans l'identification, la création ou dans le management des aires protégées et les lois y relatives et elles n'étaient pas non plus invitées à participer au partage des bénéfices. En même temps, un grand nombre de personnes a été déplacé de l'espace des parcs nationaux et a vu se réduire, de manière considérable, son accès aux ressources traditionnelles de subsistance. En échange, l'attitude de la population rurale affectée par les parcs nationaux et les autres aires protégées devenait de plus en plus hostile par rapport à elles, aux parcs nationaux et au programme de conservation de la biodiversité, et elle commençait à témoigner d’une résistance, souvent de manière violente, contre chaque élargissement ou renforcement de la loi y relative (Gapira 1979 ; Nzabandora 1984). A cause des manquements de la part de l'état depuis 1993, beaucoup d'entre eux sont rentrés dans leurs vieux campements à l'intérieur des parcs nationaux.
Depuis 2002, la RDC a entamé un vaste chantier de réformes structurelles en faveur de l'amélioration de la gestion de ses ressources naturelles. Dans son calendrier de réformes, le gouvernement propose l'adoption d'une approche de conservation en faveur des plus défavorisés. La Nouvelle Vision pour la Conservation des Aires Protégées dans la RDC (2003: 1-2) destinée à installer une «gestion efficace et coordonnée d’un réseau d’aires protégées en faveur d'une conservation durable de la diversité unique et des ressources naturelles ainsi que des écosystèmes en RDC afin d'assurer que la conservation de la nature soit une composante intégrale du Programme National de Forêt et de Conservation de la Nature et du Programme National de Lutte contre la Pauvreté.». Pour la mise en oeuvre de sa nouvelle vision, le Gouvernement de la RDC a demandé, à travers la Banque Mondiale (BM), une aide financière auprès du Fond pour l’Environnement Mondial (GEF). Le Projet GEF-BM a l'intention d'améliorer l'aménagement des parcs nationaux Virunga et Garamba avec une superficie totale de 1.3 millions d’hectares, d'identifier des nouvelles aires protégées avec une superficie de 10 millions d’hectares et de mettre en place des aires protégées nouvelles avec une superficie de 2 millions d’hectares. Le projet est alors susceptible d'avoir des effets sur tous les habitants de la forêt.
Beaucoup de régions et celles situées en zone forestière plus particulièrement encore sont habitées par des peuples autochtones, c'est-à-dire des «pygmées», mais à cause de la diversité des contextes de leur vie variant d'un cas à l'autre, il n’existe aucune définition appropriée et intégrant entièrement toute cette diversité. Pour des besoins opérationnels et de concert avec d'autres organisations internationales comme par exemple le UN Working Group on Indigenous Populations, le UN Permanent Forum on Indigenous Issues et l’International Labour Organisation (ILO), la Banque Mondiale suggère l'emploi du terme peuples autochtones au sens générique du terme et désignant un groupe socioculturel vulnérable, distinct et présentant, à divers degrés, les caractéristiques suivantes: a) les membres du groupe s’identifient comme appartenant à un groupe culturel autochtone distinct,
et cette identité est reconnue par d’autres; b) les membres du groupe sont collectivement attachés à des habitats ou à des territoires ancestraux
géographiquement distincts et situés dans la zone couverte par le projet, ainsi qu’aux ressources naturelles de ces habitats et territoires;
c) les institutions culturelles, économiques, sociales ou politiques traditionnelles du groupe sont différentes par rapport à celles de la société et de la culture dominante; et
d) les membres du groupe parlent une langue souvent différente de la langue officielle du pays ou de la région (PO 4.10).

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 12
Le groupe de travail d’experts de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les communautés autochtones clarifie «que tous les Africains sont des autochtones en Afrique en ce sens qu’ils y étaient avant l’arrivée des colons européens et qu’ils ont été soumis à la subordination au cours de la période coloniale. Nous ne questionnons donc, en aucun cas, l’identité des autres groupes. Lorsque certains groupes marginalisés utilisent le terme autochtone pour décrire leur situation, ils font allusion à la forme analytique moderne de ce concept (qui ne porte pas uniquement sur l’aboriginalité) dans une tentative d’attirer l’attention ou de demander le redressement d’une forme particulière de discrimination dont ils souffrent» (CADHP 2005: 98). «Presque tous les Etats africains regorgent d’une riche variété de groupes ethniques distincts (…). Tous ces peuples sont autochtones en Afrique. Cependant, certains sont dans une position structurellement subordonnée aux groupes dominant et à l’Etat, ce qui conduit à leur marginalisation et discrimination. C’est à cette situation que s’adresse le concept d’autochtone dans sa forme analytique moderne ainsi que le cadre juridique international y relatif» (CADHP 2005: 126). Des experts nationaux et internationaux ont identifié les groupes suivants comme peuples autochtones: les Twa, les Mbuti, les Cwa et les Aka. Ils sont localisés dans les provinces de l’Equateur, le Bandundu, le Kivu, la province Orientale, le Katanga ainsi que dans le Kasaï. Traditionnellement, ils dépendent de manière très étroite de la forêt pour satisfaire leurs besoins de subsistance en matériaux de construction, en bois de chauffage et de cuisson, en aliments de base telles que les protéines que procure la viande de chasse, ou en pharmacopée traditionnelle à base des plantes médicinales, le seul moyen de soin de santé accessible à la majorité des populations autochtones. Toutes les parties prenantes s'accordent à reconnaître que les peuples autochtones font le plus souvent partie des populations parmi les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus défavorisées. Compte tenu de l’existence des impacts du Projet GEF-BM sur les populations autochtones, la préparation d'un Plan des Peuples Autochtones (PPA) constitue une condition préalable définie par la meilleure pratique; la Politique Opérationnelle 4.10 de la Banque Mondiale (OP 4.10). La Banque n’accepte pas de financer un projet que lorsque celui-ci obtient un large soutien de la part de la communauté résultant d’un processus de consultation préalable, libre et informée des populations autochtones. L’objectif principal de ce PPA consiste à assurer que le Projet GEF-BM respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations autochtones et à assurer en même temps que les peuples autochtones profitent également des avantages socio-économiques culturellement adaptés qu'offrent le projet. Pour atteindre ces objectifs, le PPA devra permettre d'intégrer des mesures et mécanismes dans la conception et la mise en oeuvre du Projet GEF-BM permettant: • aux peuples autochtones d'exprimer leurs points de vue concernant la conception et la mise en œuvre
du Projet GEF-BM à l'intérieur de leurs terres dont ils tirent les ressources nécessaires à leur existence, la participation informée en insistant sur l'implication des représentants des deux sexes,
• d'éviter les incidences éventuellement préjudiciables aux populations autochtones concernées; ou, lorsque cela s’avère pas possible, au moins d'atténuer, de minimiser ou de compenser de telles incidences; et
• d’assurer que les bénéfices prévus pour eux seront culturellement appropriés. Pour atteindre ces objectifs, le PPA a été préparé en février 2006 – janvier 2007 par Dr Kai Schmidt-Soltau en collaboration avec les populations autochtones concernées et toutes les autres parties prenantes dans le cadre d'un contrat de consultation avec l’ICCN, qui doit gérer le Projet GEF-BM. En conformité avec la PO 4.10 et en sus de la présente introduction, le rapport comprend les parties suivantes: • Description du projet; • Données de base sur les peuples autochtones; • Un résumé des résultats du processus de consultation informé et ouvert à tous mené au préalable
auprès des communautés autochtones concernées; • Une évaluation des impacts et risques du Projet GEF-BM et des propositions des mesures
d’atténuation spécifiques en faveur des populations autochtones; • Un programme de mesures visant à assurer que les populations autochtones tirent du projet des
avantages socio-économiques culturellement adaptés; • Analyse des capacités institutionnelles, y compris des mesures destinées à renforcer, en cas de
besoin, les capacités des organismes chargés d’exécuter le projet; • Un cadre propice pour assurer le déroulement d’un processus de consultations permanent durant
l’exécution du projet; • Le plan des peuples autochtones avec un calendrier, des renseignements sur les coûts estimatifs
ainsi que des indicateurs précises; • Des mécanismes et normes de référence adaptés au projet et appropriés pour mener à bien les
activités de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports liées à l’exécution du PPA.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 13
22.. DDeessccrriippttiioonn dduu PPrroojjeett GGEEFF--BBMM L’objectif du Gouvernement est d’accroître les bénéfices sociaux et économiques que les forêts et les aires protégées apportent au pays tout en assurant que cette contribution sera durable et qu'elle respecte l’environnement. Jusqu'au jour d’aujourd'hui, la gestion des aires protégées en RDC était régie par l’ordonnance loi n°69-041 du 22 août 1969 et par ses mesures d’application, mais la loi 11/2002 du 29 août 2002 - le Code forestier - comporte une nouvelle politique d'utilisation des ressources naturelles élaborée pendant la décennie 1990 et discutée lors des forums politiques de même celle portant sur la législation environnementale en mai et juillet 2000. Ce code représente le premier effort de la RDC de développer sa propre vision sur la gestion des ressources naturelles tout en tenant compte des tendances en cours en Afrique centrale et au niveau international. Simultanément, le gouvernement s’atèle à réviser la Loi sur la Conservation de la Nature en vue d'assurer notamment l’harmonisation complète du cadre juridique national avec la Convention sur la Diversité Biologique (CBD). Le Code Forestier identifie des axes à travers lesquels le secteur devra contribuer à la réduction de la pauvreté, à la bonne gouvernance ainsi qu'à l'amélioration des capacités:
1) Le code forestier vise à «promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières capables d'accroître leurs contributions au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures» (§ 2).
2) Le code forestier prévoit comme condition préalable et avant chaque classement d'une forêt (§ 15), la consultation de la population riveraine et la participation de tous les acteurs impliqués dans la gestion. Cette participation sera réalisée à travers des différents mécanismes tels que: l’établissement des conseils consultatifs provinciaux (§ 29, 30, 31), la consultation de tous les acteurs impliqués et notamment ceux du secteur privé et des ONG (§ 5, 6, 24, 74).
3) 40% des recettes des concessions forestières seront destinées aux entités administratives décentralisées (25% aux provinces et 15% aux territoires) et elles devront servir à la réalisation des infrastructures d’intérêt collectif (Code forestier § 122);
4) Les exploitants forestiers sont tenus de convenir avec les populations riveraines des «cahiers de charges», fixant les travaux et services d’intérêt collectif qu’ils s’engagent à réaliser (Code forestier § 89);
5) Les droits d'usage des populations locaux dans les concessions forestières sont reconnues et protégées en vue de satisfaire les besoins domestiques des individus et des communautés (Code forestier § 32); et
6) Les communautés rurales obtenant le droit de gérer directement les forêts dans le cadre des «concessions des communautés locales» (Code forestier § 22).
Toutes les aires protégées sont placées sous la responsabilité de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) (Ordonnance-loi n° 75-023 du 22 juillet 1975). Malgré le dévouement de ses agents, l’ICCN n’est pas épargné du délabrement général des institutions en RDC, caractérisé par des salaires insuffisants, un manque de formation et avec la perspective d’un départ en retraite de ses agents les plus expérimentés. L'ICCN anime un Comité de Coordination du Site (CoCoSi) au niveau de chaque parc, de même qu'une plate-forme de coordination nationale appelée „Coalition pour la Conservation au Congo“ (CoCoCongo). Pendant que le CoCoSi et le CoCoCongo réunissent l’ICCN et ses partenaires, c'est-à-dire les ONG internationales de conservation (WWF, WCS, CI, APF, AWS, DFGF-I, DFGF-E, FZG, LZS, etc.), il n'existe encore, à présent, aucune plate-forme appropriée et réunissant tous les désintéressés et offrant un espace aux populations affectées ainsi qu'aux autres acteurs nationaux impliqués pour exprimer leurs opinions.
Les principaux axes de la Nouvelle Vision pour la Conservation des Aires Protégées dans la RDC (octobre 2003) peuvent comporter deux éléments clefs:
Réhabilitation du réseau des aires protégées. Durant les conflits, tous les AP ont dû subir de graves déprédations. Les actions prioritaires comprennent entre autres: le recrutement du personnel et la réhabilitation des infrastructures élémentaires, le réexamen et le marquage des limites des parcs de façon participative, l’élaboration de plans de gestion participatifs, la mise en œuvre d’initiatives de gestion communautaire ainsi que le développement d’autres activités génératrices de revenus et d’emplois dans la périphérie des parcs. Il est prévu, dans ce contexte, a) «de faciliter la collaboration avec les partenaires de l’ICCN à travers le CoCoCongo, b) d'impliquer les communautés locales dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des politiques et des programmes de conservation assurant l’utilisation durable des ressources naturelles, c) de gérer les aires protégées et collaborer avec les populations riveraines dans la gestion des zones tampons en collaboration et au bénéfice des populations riveraines.» (p.3)

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 14
Elargissement du réseau des aires protégées. Un deuxième axe de la stratégie consiste à réévaluer l’ensemble du système des aires protégées en vue d’en créer de nouvelles ou de déclasser celles ayant perdu leur valeur biologique ou subissant des empiètements irréversibles. Le code forestier prévoit que 15% de la surface entière du pays devra recevoir le statut de protection. Le réseau actuel couvre environ 8%, ce qui signifie qu’approximativement 7%, soit 15 millions d’hectares, attendent encore d'y être rajoutés. Pour ce faire, il faudra conduire une analyse de représentativité du réseau des aires protégées, mener des enquêtes socio-économiques, et cartographier l’occupation des sols afin de pouvoir déterminer les sites potentiels. Ceci implique des consultations locales débouchant sur des nouvelles aires protégées tout en renvoyant aux perceptions locales des terroirs et en respectant les droits des gens sur la base d’un consentement préalable informé.
Dans cette perspective, «les aires protégées peuvent représenter, pour le gouvernement et pour la population rurale en même temps, une source d'importants revenus à travers de mécanismes (permis d’exploitation forestière ou cynégétique, permis de visite des parcs nationaux, revenus directs et indirects du tourisme de vision)» (Le rôle de la conservation des ressources naturelles dans la stratégie pour la réduction de la pauvreté de la RDC: p.2). Les mécanismes disponibles et favorisant cet objectif sont, entre autres:
• «Assurer que les communautés locales participent à la gestion des aires protégées, et bénéficient de ces efforts;
• Encourager et renforcer la collaboration et le développement d’un partenariat avec le secteur privé et la société civile;
• Mettre en place (…) des mécanismes et des politiques permettant d’équilibrer l’éventuel coût d’opportunité pour les populations riveraines des aires protégées et pour la conservation du patrimoine naturel» (p.3).
La Stratégie Nationale de la Conservation de la Biodiversité dans les Aires Protégées de la RDC a élaboré un vaste chantier d’activités dont l’objectif global consiste à: «renforcer la capacité de l’ICCN à assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans le réseau des AP de la RDC, en coopération avec les communautés locales et d’autres partenaires pour contribuer au bien-être des populations congolaises et de l’humanité entière» (p.8). Le Gouvernement de la RDC a, pour ce qui concerne la mise en oeuvre de sa nouvelle vision et de sa nouvelle stratégie, demandé une aide financière auprès du Fond pour l’Environnement Mondial (GEF) à travers la Banque Mondiale (BM). Le projet GEF-BM comportera 3 composantes dont deux interviendront au niveau national tandis que deux autres au niveau des sites:
Composante 1 : Appui à la réhabilitation institutionnelle de l'ICCN (niveau national) Composante 2 : Appui aux parcs nationaux Virunga et Garamba (niveau des sites) Composante 3 : Expansion du réseau des aires protégées (niveau national)
L'objectif du projet de développement consiste à „gérer la biodiversité de manière durable de telle façon qu'elle puisse procurer des retombés socio-économiques aux populations locales ayant été sujet des conflits. En travaillant avec des institutions au niveau central et au niveau des sites, le Projet GEF augmentera à la fois la capacité et le profil de l'ICCN, il contribuera à installer une forte coordination parmi des partenaires et il adoptera une approche intégrée de conservation de la biodiversité en faveur des plus démunis.
La composante 1 augmentera les capacités de l'ICCN et rétablira un directorat fonctionnel au niveau administratif et financier au sein de la direction de l'ICCN. Ce directorat sera entièrement équipé par des employés formés et des ordinateurs, et la qualité de son management financier sera évaluée à travers des audits externes. La composante 1 favorisera également le renforcement de la coordination au sein de l'ICCN (CoCoCongo), de la communication, et du M&E, de la gestion de l'impact social et des systèmes de reproduction. De même, l'ICCN développera une stratégie durable d'acquisition de fonds et de l'acceptance locale des aires protégées. En soutenant les rencontres de la CoCoCongo et les réflexions y relatives, cette composante devra également contribuer à renforcer les capacités de l'ICCN et du M&E et faciliter le partage des expériences et de la reproduction des approches réussies au niveau national. Le projet, en soutenant le processus la coordination de la CoCoCongo, donnera la priorité à assurer la participation des ONG locales et des représentants élus locaux des populations locales et des peuples autochtones.
La Composante 2 apportera un ensemble de soutiens stratégiques aux deux parcs nationaux les plus importants que sont le parc national de Virunga (PNVi) et celui de Garamba (PNG). Dans chacun de ces parcs, le projet travaillera à restaurer les capacités humaines et matérielles à un niveau de base, il renforcera le partenariat avec les populations locales, les peuples autochtones et les ONG ainsi que leur participation au processus de la prise des décisions; il stabilisera les populations des espèces les plus

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 15
importantes, il soutiendra la création des réserves et forêts communautaires et il contribuera à augmenter la participation des populations locales et des peuples autochtones aux activités génératrices de revenus que sont la gestion des zones de chasse et l'écotourisme, la redistribution des revenus générés (taxes d'entrée, etc.), il assurera aussi que toutes les mesures de conservation soient réalisées d'une manière à privilégier les défavorisés, à éradiquer la pauvreté et à ce que l'état social et matériel d'aucune personne n'augmente à cause des mesures de conservation.
La composante 3 soutiendra l'identification et la création des nouvelles aires protégées nécessaires au soutien de l'objectif fixé par le gouvernement d'élargir la surface protégée du territorial national de 6 à 15%. La composante soutiendra par ailleurs l'ICCN à renforcer ses efforts et à mieux conscientiser sur le besoin d'avoir un soutien public dans la réalisation de ces objectifs. L'ICCN s'engagera, à travers cette composante, à collaborer avec les populations locales et les peuples autochtones, avec des ONG nationales et internationales, avec le monde académique et en consultation avec des autorités nationales et internationales. Compte tenu de l'accent mis sur les consultations et les contraintes logistiques rencontrées en RDC, l'objectif consiste à identifier des nouvelles aires protégées avec une superficie de 10 millions hectares et mise en place des aires protégées avec une superficie de 2 millions hectares basée sur des consultations libres, antérieures et informées. La composante contribuera à assurer que le futur système des aires protégées en RDC représente entièrement la diversité biogéographique du pays. Elle compensera en même temps et dans une certaine mesure le risque que certains des aires protégées, ayant été détruits lors de la guerre, doivent être déclassés et elle mettra, en outre, l'accent sur des consultations avec les populations locales et les peuples autochtones tout en respectant le principe d'un consentement libre, antérieur et informé. Elle sera soutenue et implantée par le directorat de l'ICCN en charge de la planification et des études.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 16
33.. IInnffoorrmmaattiioonnss ddee bbaassee ssuurr lleess ppooppuullaattiioonnss aauuttoocchhttoonneess Les «Pygmées1» constituent une illusion classique de l’autre inconnu et de la différence ultime depuis fort longtemps. Borges (1970: 188) les a qualifiés comme un groupe «d’êtres imaginaires», similaires aux fées, sirènes et trolls. Mais contrairement aux autres, les «pygmées» ont été identifiés au cours des années avec une forme corporelle.2 Par la suite, beaucoup d’ouvrages se sont intéressés à ces habitants de la forêt. Alors que certains d'entre eux insistent sur leur homéostasie avec un environnement généreux (Schebesta 1938-1958, Turnbull 1961) en affirmant même que les chasseurs collecteurs ont trouvé une «solution Zen à la pénurie et à l’abondance» (Sahlins 1968: 85), d’autres, par contre, critiquent ces travaux et leur concept sous-jacent d’une société originelle d’opulence (Lewin 1988) et démystifient plutôt le «noble sauvage».
Les peuples autochtones en RDC constituent une mosaïque complexe de groupes ethniques apparentés. Les définitions et chiffres existants ne sont pas précis ni cohérents entre eux. Selon Bahuchet et al. (1999), Bailey (1985), Pagezy (1988a,b) et Dyson (1992) environ 70.000 -100.000 personnes s'identifieraient comme étant des chasseurs-cueilleurs autochtones et/ou comme appartenant à leurs descendants (Tableau 1), tandis que d’autres sources avancent des estimations encore plus élevées. Selon les rapports de Lewis (2000), Jackson (2004) et Lattimer (2004) il y aurait, en RDC, un nombre de 250.000 personnes appartenant à l'un des différents groupes des peuples autochtones.
Tableau 1 : Les groupes des peuples autochtones en RDC
Pour la région autour du Parc National de Virunga, des chiffres plus précises existent: 2.327 ménages de populations Mbuti et Twa ont été recensés dans 216 campements et 107 villages (PAP-RDC 2000 & PIDP Nord Kivu 2004). En extrapolant la taille des ménages dans les zones habitées par les peuples autochtones autour du parc National de Kahuzi-Biega telle que rapportée par Shalukoma (1993, 2000: 3,64 personnes par ménage), on arrive à un nombre total de personnes appartenant aux peuples autochtones autour du Parc National de Virunga de 8.480 de personnes. Par contre, en se référant au chiffre avancé par Plumptre et alias (2004: 42) pour le compte des populations Twa en RDC (5.33 personnes par ménage), 12.400 de personnes appartenant aux peuples autochtones habiteraient la zone autour du Parc National de Virunga.
De par l'histoire et la tradition, les peuples autochtones ne vivaient pas dans la région autour du Parc National de Garamba, mais, à cause de la guerre civile, beaucoup parmi ces peuples avaient dû quitter leurs forêts d'origine pour trouver un refuge dans n'importe quelle région du pays de façon qu'à leur actuelle, l'on ne puisse pas être sûr si ces régions, bien qu’historiquement et traditionnellement non habitées par eux, le soient encore aujourd'hui.
Il est généralement admis que les chasseurs-cueilleurs sont les premiers habitants des forêts congolaises. Selon cette théorie à associer aux travaux de Schebesta (1938-1958) et de Turnbull (1961, 1965, 1983), ces populations ont pendant longtemps vécu en autarcie fondée sur l’économie de la cueillette avant que n'arrivent, pendant le dernier millénaire et à la suite des migrations, des groupes d’agriculteurs vers les zones forestières. Mais d'autres études plus récentes situent ces premiers contacts entre les deux peuples à une période beaucoup plus ancienne, à la période entre 2.000 et 3.000 (Bahuchet 1982, Bailey 1985, Hart et Hart 1986, Vanshina 1990). Voulant définir les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka, les peuples autochtones (PA) comme une entité à part entière, il 1 L’emploi de cette appellation «pygmée» est d'ailleurs aujourd'hui contestée par des anthropologues y
voyant une connotation péjorative. Tenant compte de ces considérations sémantiques, le présent rapport se réfère tant que possible aux autodénominations proposées par chacune des populations citées.
2 Georg Schweinfurth a rencontré ces habitants au cœur de la forêt équatoriale centrafricaine et rapportait à leur sujet: „... enfin, je pouvais réellement régaler mes yeux de la personnalisation vivante de mythes de quelques milliers d’années!” (Schweinfurth 1873, 2: 127)
Groupe Région Population Aka Le long du fleuve Oubangui 5.000
Mbuti (Asua) Au Centre et au Sud de la forêt d’Ituri 5.000-7.000 Mbuti (Kango/Aka) Au Nord et à l’Ouest de la forêt de l’Ituri 7.500-8.000
Mbuti (Efe) Au Nord et à l’Est de la forêt de l’Ituri 10.000-15.000 Cwa d’Equateur Au Sud et à l'Est de Mbandaka 14.000-20.000
Cwa du Kasaï En lisière de la mosaïque forêt savane dans la région des lacs du Kasaï, à Kongolo, au Nord de Kananga et à l'Est de Kabinda
10.000-20.000
Twa A l'Est du Nord-Kivu, au Sud-Kivu et à Maniema 12.000-16.000
Autres groupes Dispersés à travers toute la région forestière en RDC Env. 5.000

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 17
s’avère d'abord nécessaire de les bien distinguer par rapport à leurs voisins agriculteurs. Les peuples autochtones ne parlent pas les mêmes langues, mais plusieurs langues bantoues à la fois; mais ce qui est encore bien plus frappant dans ce contexte, c'est le fait qu'ils perçoivent leurs voisins immédiats, les bantous, différents par rapport à eux-mêmes et ceci à la fois au niveau sociale, économique, idéologique et aussi au niveau de l'organisation politique (Bahuchet 1993a).
Carte 1 Les zones d’usage des peuples autochtones
«Batwa», «Bambuti», etc. renvoie au pluriel alors que «Mutwa», «Mubuti» au singulier dans les langues bantoues. Mais le présent rapport préfère l'emploi du terme «Twa», «Mbuti», «Cwa» et «Aka» pour le singulier et le pluriel en même temps, parce que ces termes «Batwa» etc. sont porteurs de la même ambivalence que présente le terme « pygmée ». En même temps, le terme «Twa» s'emploie en langue bantoue généralement en référence aux populations le plus souvent chasseurs-cueilleurs.
Les peuples autochtones s'identifient eux-mêmes de manière très étroite à la forêt (Cavalli-Sforza 1986). Même s'ils ne vivent pas exclusivement des produits sauvages que leur procure la forêt tropicale, ces produits font partie de leurs besoins fondamentaux et constituent la base à leur vie quotidienne (Ichikawa 1991). Ils sont d'une très grande mobilité, mais leurs déplacements à travers des vastes zones à l'intérieur de la forêt s'organisent tout d'abord en fonction de la disponibilité des produits forestiers, c’est-à-dire par rapport aux différentes saisons de l'année et non pas rapport aux nécessités différentes qu'impose la vie agricole. Ils ont fait de la forêt le centre de leur vie intellectuelle et spirituelle (Harako 1988). Ils se voient eux-mêmes différents et sont également perçus par leurs voisins comme différents par rapports à leur vie sociale, économique, idéologique et politique

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 18
(Bahuchet 1993a). Les populations autochtones des régions forestières en RDC entretiennent des relations complexes avec les populations villageoises agricoles qui les chargent souvent des travaux et avec qui ils échangent des biens et des services; pour communiquer avec eux, ils parlent leurs langues, bantoues ou encore soudanaises. Ces interactions entre voisins sont souvent caractérisées par une inégalité (Turnbull 1965, 1983, Hewlett 1996) et elles s'étendent d'une relative autonomie avec des contacts occasionnels jusqu'à la servitude héréditaire (Grinker 1994). Le type d’interaction développé par chaque groupe autochtone correspond notamment à son niveau de mobilité.
Tous les groupes chasseurs-cueilleurs autochtones sont caractérisés par leur mobilité, mais comme le degré de leur mobilité varie, la fréquence et l'intensité des contacts avec le monde extérieur varient aussi. Certains groupes, spécialement parmi ceux des Mbuti (Asua, Efe, Basua) restent entièrement dépendants de la forêt, tandis que la majorité des groupes Cwa pratiquent l’agriculture pour compléter leur régime alimentaire, même si la chasse demeure l’une de leurs principales activités.
La plupart des populations autochtones de la RDC vie d’une combinaison de production alimentaire et d’exploitation de produits forestiers (Ichikawa 1991, Grinker 1994). Les données des années allant de 1970 à 1980 indiquent qu’à cette époque, ni la chasse, ni la cueillette des produits non ligneux n’avaient détérioré ces ressources naturelles. La chasse et la cueillette n'assuraient que la subsistance locale d’une population de faible densité. Ichikawa (1986, 1996) estime qu’un groupe de 67 personnes récoltait annuellement environ 7 tonnes de gibier dans un territoire de 150 Km². Il est probable que les conflits, l’augmentation de la population et de la demande mettent désormais cette source d’approvisionnement des peuples autochtones en péril.
La participation des peuples autochtones au commerce régional n’est pas du tout récente, car elle se pratiquait déjà au 17ème siècle lorsque les Européens s’approvisionnaient en ivoire et autres produits non ligneux (Vanshina 1990). Mais cela n’avait pas conduit à une représentation adéquate de ces peuples dans le cadre des processus de la prise des décisions à l'intérieur de la société. En RDC, le droit foncier n’est toujours pas entièrement clarifié et l’agriculture de rente, l’exploitation minière, la reprise des activités économiques, y compris, mais pas uniquement, l’industrie du bois ainsi que la mise en œuvre des aires protégées et avec, en même temps, le processus de la réunification et de la relance économique, posent des défis majeurs aux peuples autochtones avec leurs modes de vie et avec ses opportunités et risques particuliers qui demandent d'être observés et traités avec la plus grande attention.
Le nouveau code forestier confirme les droits traditionnels de toutes les populations à profiter des ressources forestières lorsqu'il s'agit de leur subsistance et de leur bien-être socioculturel. Il prévoit des consultations préalables à toute décision relative à l'aménagement et aux compensations à chaque fois qu'un de ces droits traditionnels pourraient être ignoré ou encore restreint, mais en réalité, la situation est beaucoup plus complexe encore.
Sans ignorer que dans une étude ethnologique ou anthropologique, il ne serait pas correct de présenter des différents groupes ethniques comme une seule entité, je le ferai dans ce rapport qui ne s'adresse pas à un public académique et je le ferai uniquement pour le besoin de la cause et tout en renvoyant à l’annexe tous ceux qui cherchent des informations plus détaillées sur les différences et les éléments plus spécifiques relatives à ces groupes ethniques mentionnés.
33..11.. EEccoonnoommiiee eett EEnnvviirroonnnneemmeenntt A l'origine, les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka étaient des chasseurs collecteurs qui pratiquaient rarement l'agriculture. Mais les campagnes de sédentarisation durant et après la période coloniale ont fait en sorte que la plupart des peuples autochtones commençaient à occuper des terres de manière permanente et à y passer la plus grande partie de l'année (Althbabe 1965).
Tout comme les autres groupes ethniques vivant dans la même région, ils ont adopté, pendant ce processus de sédentarisation, un mode de vie basé sur l'agriculture. Durant une partie de l’année, ils restent dans leurs campements permanents, où les hommes défrichent et brûlent des parties de la forêt tandis que les femmes cultivent et s'occupent de la récolte. Mais le niveau de sédentarisation entre les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka diffère de manière significative. Alors que la coutume de quitter leurs villages pendant des longues missions de chasse les éloignant souvent bien loin du village, n'existe pratiquement plus chez les Cwa, les Mbuti, Twa et Aka qui vivent à l'extérieur des principaux villages, passent encore aujourd'hui 1/3-2/3 de leur temps dans la forêt. Tandis que les Cwa, à cause de leur faible activité de chasse, n’ont pas pu maintenir leur style de vie en camp de chasse, la majorité parmi les groupes Mbuti, Twa et Aka disposent d'habitude, et loin à l'intérieur de la

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 19
forêt, de plusieurs campements de chasse qu'ils abandonnent dès que le gibier et les produits non ligneux commencent à s'y réduire, ce qui témoigne d'une bonne et durable gestion de la forêt.
Les méthodes traditionnelles de chasse (à la lance [Efe, Twa] et au filet [Asua]) sont de moins en moins pratiquées et remplacées actuellement toujours plus par la chasse avec des pièges. Mais les informateurs parmi les populations Cwa rapportent qu'autrefois, on pratiquait encore la chasse avec des filets ou d'autres outils de chasse traditionnels.
Fig. 1 : Le circuit annuel de trois campements Aka sur une localité. Source: Thomas et al 1983ff (1.3): 40.
Fig.2. Les surfaces utilisées par les Aka. Source : Thomas et al 1983ff (1.2): 66.
Les raisons motivant la chasse ont, à cause d’une forte demande en viande de brousse, changé au cours de ces dernières années. Les hommes encore jeunes sont particulièrement capables de générer des revenus qu'ils dépensent le plus souvent en boisson à l'intérieur de leurs campements permanents.
Les femmes collectent, en petits groupes, des ignames sauvages, des feuilles de gnetum sp., landolphia, divers fruits et champignons, alors que la récolte du miel sauvage est considérée comme une tâche revenant aux hommes. Vers la fin de la saison sèche, les hommes et les femmes attrapent des poissons dans les petits cours d’eau.
Mais il faut le dire, les conditions de vie des sociétés de la forêt tels que les Mbuti, Twa, Cwa et Aka sont beaucoup moins idylliques que le veulent souvent croire les étrangers. L’exploitation forestière, les activités de conservation telle la création des parcs nationaux et des autres aires protégées et l'intensification de la culture vivrière - exclusivement organisée par les «Bantous» - ont beaucoup contribué à réduire l’espace disponible à la chasse et la cueillette. Toutefois, les peuples autochtones ne sont pas capables de générer plus de 10% des revenus de leurs voisins agriculteurs. Alors que les agriculteurs peuvent générer environ USD 84 (DSRP 2005:23) par personne et par an, le revenu des peuples autochtones n'atteint qu'environ USD 8 par personne et an (USD 0.02 par personne et jour).
33..22.. LLee ssyyssttèèmmee ttrraaddiittiioonnnneell ddee tteennuurree ffoonncciièèrree L'explication du système traditionnel de tenure foncière ne semble pas difficile parce qu'en termes de possessions foncières etc., il n'existe même pas; mais elle peut s'avérer relativement complexe dès que l'on considère que les terres sont gérées en commun. Avant l'époque coloniale, les bandes et groupes n’avaient pas choisi une zone bien déterminée, mais un système bien élaboré de gestion durable de la forêt: lorsque l’exploitation d’une zone commençaient à avoir des impacts visibles (moins de succès dans la chasse et la cueillette), ils abandonnaient tout simplement la zone. Ce système a changé sous le

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 20
développement rapide du côté des agriculteurs utilisant certaines zones le long des rivières pour leur agriculture de coupe et de brûlis et surtout avec l'arrivée des peuples autochtones.
Pendant des périodes de la saison des pluies, les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka avaient commencé à s'installer près des agriculteurs en échangeant avec eux la viande de brousse contre le manioc et d'autres produits agricoles leur permettant ainsi d'éviter des périodes de famine causées par la réduction des opportunités de chasse et de cueillette pendant les périodes pluvieuses. Pendant l’époque coloniale et post-coloniale, les activités d’exploitation forestière et les projets de conservation ont énormément contribué à réduire le territoire disponible à ces populations, mais comme dans le passé, elles semblent encore aujourd'hui incapables de défendre leurs terres contre les pénétrations en provenance de l'extérieure.
Fig. 3 Les calendriers comparatifs d'avant la colonisation et actuels des activités des populations Aka Source: Thomas et al 1983ff (1.2): 80.
Traditionnellement, chaque campement (le groupe résidentiel) se déplace en moyenne six fois par an. Ces déplacements d’année en année s’effectuent à l’intérieur d’une aire correspondant à un domaine vital et couvrant une surface d’environ 2 Km² par personne; ce qui revient donc à 300 Km² par campement. Un domaine vital est selon Heymer (1977:26) «l’espace qu’un individu ou un groupe organisé parcourt tout au long de son existence». Les groupes résidentiels qui s’associent périodiquement pour effectuer la chasse aux filets utilisent des domaines vitaux qui sont largement superposés, mais il est évident que seuls ces groupes utilisent l’aire de forêt formée par cette superposition et d’autres campements ne peuvent y avoir accès, s’y installer, même temporairement, sans autorisation. Dans cette mesure, il est permis d’appeler ce domaine exclusif – territoire/localité. Les peuples autochtones reconnaissent et nomment cette surface de forêt partagée par plusieurs campements. Il apparaît toutefois que la configuration de ces territoires est déterminée par les localisations des zones de chasse et de cueillette des villageois avec lesquels les peuples autochtones d’un groupe particulier ont des relations d’échange (Thomas et al 1983ff (1.2): 87-89.). A un moment donné, quelques bandes ont commencé à aménager leur propre petite agriculture de jardin. A défaut d'un système foncier proprement dit, ils ont commencé, pour gérer leurs fermes, à se servir du système

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 21
élaboré par les agriculteurs, mais tout en maintenant l’idée d’une forêt ouverte en dehors de la zone agricole. Toutefois, le processus de la sédentarisation, aggravée par une dégradation de l’environnement, a réduit la zone de forêt disponible pour les diverses bandes, car leur petite agriculture de jardin ne leur permet pas des déplacements trop loin de leurs fermes et parcelles permanentes. Au cours des discussions, il s’était avéré que les peuples autochtones maintenaient l’idée d’une forêt collective et ouverte à tous, et qu'en réalité, il est possible de démarquer la zone de terre utilisée par les différents groupes résidentiels. Ces zones se trouvent sous pression, car les peuples autochtones n’ont pu développer des stratégies efficaces au profit de la protection des forêts qu’ils utilisent.
Les titres coutumiers des peuples autochtones sur les zones agricoles changent de manière significative. Dans les zones où plus des terrains sont disponibles, les peuples autochtones se sont déclarés propriétaires des terrains dont les limites sont respectées par leurs voisins bantous. Mais, dans le plupart des cas, les peuples autochtones ont fait comprendre de n'avoir aucun droit légal sur les terrains qu'elles occupent. Compte tenu du fait que les peuples autochtones ne sont pas considérés comme propriétaires des terres qu’ils occupent, ils sont les tout premiers à devoir abandonner les lieux lorsqu’il s’agira de céder de la place à des nouvelles plantations ou encore aux divers projets dans le cadre du processus de développement. Dans leur grande majorité, ils ont subi plusieurs changements de leurs campements pour céder la place à l’expansion des villages bantous ou encore aux plantations de leurs voisins. Ils n’ont, à présent, pas d’accès légal à un quelconque terrain, ni aux ressources naturelles non plus. En conséquence, ils sont devenus des simples paysans travaillant sur des terres qu'ils ne possèdent pas et avec des salaires leur permettant rien de plus que la simple survie, dépourvus des moyens pour payer la scolarité de leurs enfants ou, en cas de maladie, les frais de consultation et des médicaments.
Une étude de cas démontre que 14% des peuples autochtones installés autour du Parc National de Virunga sont propriétaires de petites concessions dans lesquelles ils sont contraints de vivre (PIDP Nord-Kivu 2004). Mais ces concessions sont le plus souvent trop petites (moins de 0.1 ha par personne) et elles ne peuvent garantir la survie de leurs occupants ce qui les obligent donc au travail sur les terres de leurs voisins (le revenu moyen en serait 0.01 - 0.02 $US par personne et jour) en pratiquant tout genre d’activités illégales quand ils ne sont pas tout simplement abandonnés à la merci des ONG. Compte tenu du fait que les peuples autochtones ne sont pas considérés comme propriétaires des terres qu’ils occupent, ils sont les tout premiers à devoir quitter les lieux lorsqu’il s’agit de céder de la place à des nouvelles plantations ou encore aux divers projets dans le cadre du processus de développement, et 87% de ceux installés dans les environs du Parc National des Virunga rapportent d’avoir été sujet à ce genre de déplacements involontaires au moins une fois déjà. La majorité de ces communautés a une longue expérience au sujet des migrations imposées: On les a obligés, par la force des armes, d’abandonner la forêt que constitue le Parc National de Virunga au cours des années 60 et puis à nouveau au cours des années 70 pour qu’ils s’installent sur des portions de terrain près des leurs «frères» ou «propriétaires» bantous. Dans leur grande majorité, ils ont subi plusieurs changements de leurs campements pour céder la place à l’expansion des villages bantous ou encore aux plantations de leurs voisins. Suite à des manquements de l’état (1997), ils sont rentrés dans leurs zones forestières d’origine à l’intérieur du Parc National de Virunga et toutes les personnes questionnées affirment que c’était la meilleure période de leur vie. Mais la réorganisation de l’ICCN les a à nouveau obligé de quitter cette forêt et de trouver un bout de terrain pour s’installer ailleurs sans aucune assistance ou attribution d’un terrain servant à leur installation. Ils n’ont, à présent, pas d’accès légal à un quelconque terrain, ni aux ressources naturelles non plus. En conséquence, ils sont devenus des simples paysans sans terre et avec des salaires leur permettant rien de plus que la simple survie, dépourvus des moyens pour payer la scolarité de leurs enfants ou, en cas de maladie, les frais de consultation et des médicaments. Plumptre et al. (2004: 54) démontrent que seulement 12.5% parmi la population Twa dispose d’une éducation formelle, tandis que 40% parmi les populations bantoues peuvent disposer d’une éducation dans l’enseignement primaire et 10% même dans l’enseignement secondaire. Aucun des Twa suivis par Plumptre (2004: 58) dans les environs du PNVi n’a jamais consulté un hôpital tandis que, du côté des bantous, 40% parmi eux y sont déjà allés se faire consulter et soigner. Cette situation explique aussi le taux de mortalité dans les campements des populations Twa deux fois plus grand que celui du côté des villages bantous (PIDP Nord-Kivu 2004) et en Uganda quatre fois (Rudd 2004). Selon les Twa et Mbuti rencontrés dans les environs du PNVi, ces conditions de vie inacceptables s’expliquent par le fait qu’ils n’ont pas d’accès légal à un quelconque terrain, ni aux ressources naturelles.
Bien que les conditions de vie des populations Mbuti, Twa Cwa et Aka installées à quelque distance des Parcs Nationaux soient de loin meilleurs, le problème d’accès aux terrains reste toujours le même. En se rendant dans les zones de réinstallation entre Kambao et Kantine où l’ICCN et ses partenaires

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 22
comptent réinstaller 5.000 ménages vivant à présent près de Beni dans le PNVi, le terrain qui nous a été présenté par l’ICCN et ses partenaires comme étant une zone inhabitée, s’était finalement avéré déjà occupé et utilisé par un grand nombre de groupes Mbuti. Il y existe environ 10 installations Mbuti avec 2 à 4 campements chacun tout proche l’un de l’autre. Les Mbuti se souviennent encore bien de ce jour où le Chef de Secteur les avait invité à assister à un de ses discours les informant, eux et les populations rurales, que 5.000 familles devaient venir et que le gouvernement comptait les installer quelque part entre Kambao et Kantine et que la population rurale était obligée de déguerpir pour céder de l’espace et tout ceci sans avoir droit à quelque compensation que ce soit. Les chefs des groupements, de concert avec les chefs coutumiers, avaient décidé d’allouer cette zone utilisée et habitée actuellement par les Mbuti au profit du plan de réinstallation en espérant de pouvoir ainsi réduire l’impact négatif sur les populations bantoues.
L’absence des méthodes et systèmes traditionnels en faveur d'une meilleure défense de leurs «biens» par rapport aux étrangers ainsi que le fait de ne pas disposer des propriétés/villages/localités légales (attribués par le gouvernement), ont beaucoup contribué à fragiliser de plus en plus leur mode de vie et leur culture lesquelles se trouvent aujourd’hui de plus en plus marginalisées et remplacées par d'autres imposées par l’extérieur de telle manière que ces peuples autochtones deviennent de plus en plus dépendants de leurs voisins parce qu'ils n'ont pas d'alternative et ne peuvent plus tout simplement s'échapper et disparaître dans la forêt à chaque fois qu'ils le voudraient. C’est aussi la raison pour laquelle leurs bases économiques restent fondées et dépendent de la bonne volonté des agents officiels et/ou de leurs voisins qui, eux, disposent pratiquement toujours des capacités plus élaborées pour les discussions des questions de légalité avec les différentes instances gouvernementales.
Le fait que les fonctionnaires soient dans leur plus grande majorité d’origine bantoue, contribue également à augmenter le nombre des désavantages subis par les peuples autochtones. L’argument selon lequel les droits de propriété sur des terres à l’intérieur du code foncier devaient être respectées par toutes les parties prenantes, s’est également montré inefficace.
Relativement récente, la notion même de propriété communale (forêt communautaire ou en RDC concessions des communautés locales») ne propose pas des mesures spéciales en faveur d’une légalisation d’un titre d’utilisation de terres traditionnelles par l’ensemble des communautés. Le gouvernement de la RDC, celui du Cameroun et du Gabon comptent affronter ce problème dans le cadre des plans des peuples autochtones pour le Projet d’urgence et de soutien au processus de réunification économique et sociale (PUSPRES) (Composante 3: Réhabilitation des RN 2 & 4), le Projet d'urgence d'appui à l'amélioration des conditions de vie (Composante C: Désenclavement des zones isolées) en RDC et les Programmes Sectoriel Forestier et Environnement au Cameroun et au Gabon qui prévoient des activités précises en faveur des peuples autochtones privilégiant leur accès aux ressources forestières. En RDC, c’est l’UCoP dans le sein du Ministère du Plan qui est chargé de la création des forêts communautaires d’une superficie de 100 d'hectares par personne le long des RN 2, 4 & 6. Au Cameroun, c’est le PSFE qui est chargé de la création des forêts communautaires d’une superficie de 5.000 d’hectares pour chacune des communautés des peuples autochtones (MINEF 2003); quant au Gabon, le PSFE prévoie 100 d’hectares par personne installée à l’intérieur de l’un des campements des peuples autochtones existant au Gabon (MEFEPCN 2005).
33..33.. LLeess iimmppaaccttss ddeess pprroojjeettss ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn Aujourd'hui, 7,7% du territoire national est protégé, mais l’un des objectives du Projet GEF-BM consiste en l’augmentation de ce taux vers 15%. Cernea & Schmidt-Soltau (2006) ont démontré que les parcs nationaux dans 6 pays du bassin du Congo sont à l’origine d’un appauvrissement du côté des populations rurales en général et des peuples autochtones tout particulièrement (voir aussi Rudd 2004 pour le appauvrissement des Twa causé par le Bwindi National Park en Uganda). Néanmoins, ceci ne constitue pas du tout une nécessité et il est bien montré que la conservation de la biodiversité ne doit pas obligatoirement entraîner l’appauvrissement des populations rurales. La discussion des impacts sociaux des mesures de conservation est déjà bien ancienne: Ainsi, en 1939, l’anthropologue Peter Schumacher avait démontré que la sédentarisation imposée et le changement de mode de vie (de la chasse et la collecte à l’agriculture et la poterie) contribuent à fragiliser la culture et la confiance des populations Twa au Rwanda et pourraient même être à l’origine de leur extinction.
En se basant sur ses découvertes, l’Institut des Parcs Nationaux du Congo-Belge a autorisé les populations Twa et Mbuti de continuer la chasse et la collecte de subsistance à l’intérieur du Parc National de Virunga en se référant au Décret du 14 octobre 1916 disposant que «les terres occupées par les populations indigènes… continueront à être régies par les coutumes et usages locaux» et

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 23
ensuite à celui du 6 février 1920, précisant qu’il s’agit bien des «terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent de quelque manière que ce soit selon les coutumes et usages locaux». Le Décret du 11 avril 1949 relatif au droit foncier reconnaissait des droits de propriété aux communautés, sur la base de l’usage et de l’occupation coutumière des terres: «Les indigènes exercent leurs droits coutumiers dans les forêts protégées indigènes ou domaniales (…). L’exploitation commerciale, par les indigènes, des produits forestiers qu’ils récoltent selon leurs usages coutumiers, est libre dans les forêts protégées domaniales».3 Mais le Code Foncier (Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 § 53 & 387) n’a pas restitué ces droits et l’Ordonnance–Loi du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature dispose que personne n’est autorisée à résider, cultiver ou exercer une activité quelconque à l’intérieur du parc (voir aussi le Cadre de politique de réinstallation)4. Dans cette logique, les peuples autochtones étaient contraints d’abandonner leurs forêts sans être consultés et sans aucune réparation par les projets de conservation comme c’est le cas pour le PN des Virunga.
Beaucoup a été dit à propos des opportunités de bénéfices à tirer des aires protégées au profit des populations rurales. L’UNESCO a imposé des taxes sur la distribution des bénéfices générés chaque année par le tourisme de gorilles. Les bénéfices locaux provenant des 20.6 millions US$ par année s’élèvent à 0.7 millions de US$ ce qui représente 3.4% environ. Plumptre et al. (2004 : 74) démontrent même que le bénéfice tiré des projets de conservation par les peuples autochtones reste inférieur à celui des autres. Pendant que 7% de la population entière se souvient d’avoir pu profiter quelque peu des bénéfices provenant du tourisme, personne parmi les populations Twa aux environs du Parc National de Virunga n’en a jamais vu. Pendant que 6% de la population bantoue questionnée a quelques parents autorisés de collecter des produits forestiers non ligneux à l’intérieur du parc, personne parmi les populations Twa connaissait quelqu’un jouissant du même droit. En revanche, les peuples autochtones ont beaucoup plus souvent soulevé des problèmes à cause de la présence du Parc National: 88.9% des peuples autochtones installés autour du Parc National de Virunga révèlent que la présence du parc entraîne des impacts négatifs (accès restreint, agressions pendant les récoltes et vol des récoltes, affrontements avec les gardiens) alors que personne n'a pu se souvenir d’un bénéfice quelconque (Plumptre et al. 2004: 86). L’appauvrissement des peuples autochtones en RDC, causé par l’établissement des parcs nationaux, a été bien documenté par des études des cas portant sur le Parc National de Kahuzi-Biega (Barume 2000, Mutimanwa 2001), mais qui prouve en même temps que la situation est similaire dans celui de Virunga.
Dès la fin des années 1960 jusqu’en 1975, 580 familles Twa (entre 3.000 et 6.000 personnes) vivant, dans les altitudes des zones forestières du Parc National de Kahuzi-Biega en ont été expulsées de manière violente. Il n’y a pas eu de consultation préalable et aucune disposition n’a été prise pour assister toutes ces victimes d’expulsion à retrouver un terrain ou n’importe autre source de revenus. Cette expulsion a, soudain et d’un seul coup, détruit leur culture, leurs pratiques spirituelles et leur mode de vie. Le coût en a été très grand au niveau humain et social. A présent, on suppose que 50 % de ces personnes expulsées de leur forêt sont mortes, tandis que les survivants sont frappés par une mortalité infantile beaucoup plus élevée en comparaison avec d’autres groupes. (Barume 2000: 63- 70; Lewis 2001: 21-24 voir aussi pour Uganda Rudd 2004).
Suite à l'aveu que les parcs nationaux puissent être à l’origine des problèmes chez les populations autochtones, l’ICCN, de concert avec ses partenaires, a tout récemment commencé à travailler plus étroitement en collaboration avec ces populations concernées. L'ICCN ensemble avec ses partenaires a organisé, en novembre 2005, un atelier dans le secteur nord du Parc National de Virunga destiné à améliorer la cohabitation entre ce Parc, les peuples autochtones et les communautés locales dans la région de Rwenzori et de la Chefferie Watalinga. Mais l'approche utilisée montre bien le faible niveau dans le domaine de la communication interculturelle: L'atelier commença par des longues présentations sur la «Conscientisation: La valeur de la forêt dans la vie de l'homme; la législation des aires protégées en RDC; l'encadrement des pygmées de Bahatsa par l'ICCN & le WWF-PEVi» suivi par d'autres déclarations de la part des autorités locales de façon que les peuples autochtones n'aient pratiquement pas eu l'opportunité d'exprimer leur propre point de vue (ICCN & WWF 2005: 6) alors que le rapport prétend qu'il est «permis d'aborder la problématique des pygmées de manière plus étendue permettant ainsi d'épingler les difficultés mais aussi de montrer les voies pour trouver une solution ou pour soutenir ce peuple toujours écarté et marginalisé par la société. Au cours des travaux en carrefour et en plénière, il était tout particulièrement possible de faire un rapprochement entre la conservation durable du Parc 3 Les codes et Lois du Congo Belge, - Tome III, 8e édition des Codes Louwers – Strouvens, 1959. Chapitre II : « Des usages
indigènes », Section 1 – Usages coutumiers et exploitation à caractère commercial, aux articles 8 à 10, 4 La création des parcs nationaux existants, était décrétée par Ordonnances signées au cas par cas, sans nécessairement
suivre la procédure légale. Dans tous les cas, les droits des populations autochtones habitant les forêts décrétées « parcs », n’ont été pas consider dans les processus de creation du parc.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 24
National de Virunga, le développement et la survie des pygmées» (ICCN & WWF 2005: 8). Quand on sait que les peuples autochtones sont des chasseurs collecteurs, on s'étonne d'autant plus que la question d'accès aux ressources forestières comme le bois, le gibier, le miel et tant d'autres produits forestiers non ligneux, n'a pas été abordée. Tandis que le rapport met en exergue que l’ICCN aussi bien que le WWF «doivent trouver un terrain servant à l'installation des pygmées de même que pour leurs activités» (ICCN & WWF 2005: 8), il vise, et de manière solennelle, l'assistance à l'agriculture («Promouvoir l'agriculture dans le milieu pygmée, apprentissage des petits métiers» ICCN & WWF 2005: 9). Des expériences déjà faites dans d'autres pays montrent bien que cette approche ne pourra très certainement pas aboutir aux résultats escomptés et que la clé à une cohabitation des parcs nationaux avec les peuples autochtones se trouve beaucoup plus dans l'autorisation de continuer la chasse et la collecte de subsistance dans le contexte des plans d'aménagement des parcs nationaux, parce que ces activités constituent les uniques ressources de revenu monétaire pour les Mbuti, Twa, Cwa et Aka ce qui met bien en exergue leur importance.
Le gouvernement du Cameroun et celui du Gabon se sont consacrés à ce problème dans leurs plans des peuples autochtones pour les Programmes Secteur Forestier et Environnement qui prévoient, aux peuples autochtones de ces deux pays et dans le contexte des importants plans de management (MINEF 2003 & MEFEPCN 2005), le droit de chasser et de cueillir dans toutes les aires protégées. L'ICCN et ses partenaires se sont servis d’une approche similaire dans la Réserve de Faune à Okapis (WWF-ICCN 1995, Hart 1986, 2000, 2001)
Toutes ces études suggèrent que l'exploitation de subsistance par les peuples autochtones n'entraîne pas forcement des impacts négatifs sur les ressources forestières. Par contre, Ichikawa (2001: 163) fait comprendre que « l'environnement dans la forêt d'Ituri... a vraisemblablement été amélioré par les interactions entre les Mbuti, les villageois, les animaux et les plantes ».
33..44.. LLeess iinntteerraaccttiioonnss aavveecc lleess ggrroouuppeess eetthhnniiqquueess vvooiissiinnss Les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka ont depuis toujours été et de manière quotidienne en contact avec d’autres groupes ethniques. Mais la nature de ces contacts, leur longueur et leur impact sur toute cette interaction dans le passé, le présent et dans le futur ne varie pas seulement d'un groupe à l'autre, mais même à l'intérieur des bandes (familles) d'un même groupe.
Le fait d'échanger des produits forestiers issus de la pêche, de la chasse ou de la cueillette contre le fer, des ressources d'origine agricole ou encore des produits du marché, contribue au profit d'une relation désignant en même temps une stratégie propre aux peuples autochtones et aux «Bantous». En effet, tous les deux groupes arrivent de cette manière à diminuer les risques dus aux variations saisonnières de la production, tout en spécialisant, d'un côté, les techniques de subsistance et, de l'autre, en favorisant l'échange lui-même. Cette interaction a été perçue et interprétée de plusieurs manières. Alors que certains décrivent les interactions entre les peuples autochtones et leurs voisins comme de l’esclavage (Turnbull 1961), d’autres y voient beaucoup plus l’exemple d’un excellent partenariat interculturel (Grinker 1994). L’interaction en elle-même existe depuis longtemps, mais sans l’option de «disparaître» dans la forêt parce que la forêt, à cause de l'exploitation ou encore des projets de conservation, n’est plus disponible, l’exposition à un mode d’interaction monétaire et l’impact des services gouvernementaux (sédentarisation, regroupement forcée, Code Forestier, aires protégées etc.) changent les modes d’interaction. Les chasseurs–cueilleurs perdent certains aspects de leur pouvoir économique et spirituel et deviennent ainsi de plus en plus dépendants de leurs voisins.
Pour le cas du Cameroun, Ngima (2001) fournit une liste de «requêtes» établie par les «Bantous» et «pygmées» favorisant leur mode d’interaction harmonieuse, originelle et vivante, a été, d'une manière ou d'une autre, reproduite lors de mes entretiens avec les peuples autochtones et «Bantou»: • Amélioration de l’intégration de l’élite interne et externe dans le processus de prise de décision sur
les questions en relation avec l’utilisation de la forêt; • Répondre aux besoins exprimés en investissant dans la construction des routes, des dispensaires
ou centres de santé, des écoles et terrains de football ou bien dans les animations culturelles; • Interdire l’exploitation forestière désordonnée de la part des «étrangers»; • Protéger les plantes médicinales, les arbres fruitiers et autres plantes et espèces d’animaux
représentant une valeur culturelle et économique pour les Baka, Kola et «Bantous»; • Offrir des droits d’utilisation légaux selon les modes traditionnels de faire valoir (l'arbre Moabi tout
particulièrement);

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 25
• Etablir une meilleure régulation et un meilleur suivi du travail effectué dans les forêts par les divers acteurs;
• Assistance dans le domaine de la gestion durable des forêts; • Employer les jeunes des villages «bantous» et des campements Baka et Kola pour tout type de
main d’œuvre (infrastructure, etc.); • Légaliser les droits fonciers traditionnels des Baka, Kola et «Bantou» (y compris les terres des
fermes individuelles ainsi que les zones de chasse et de cueillette commune); • Intégrer à tout prix les peuples locaux («Bantou» et Kola) dans le processus de prise de décision
(Ngima 2001: 233).
Fig. 4: Les relations entre les chasseurs - collecteurs (les peuples autochtones) et les Agriculteurs (les Bantou). Source : Bahuchet et Guillaume 1979 : 118.
Les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka ainsi que leurs voisins sont conscients de la nature fragile de leur interaction et très souvent, lors des réunions, il a été affirmé que les «Bantous» ne sont pas guidés par cette mauvaise intention de vouloir de plus en plus défavoriser leurs partenaires parmi les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka, mais que c'est beaucoup plus le manque d’opportunités d'accroître leurs revenus en équipe. Les deux parties se sont déclarées disponibles d'adopter une approche commune au développement, mais, en même temps, ils ont fait comprendre que, si le développement n'est possible qu'aux dépens des populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka, la majorité des «Bantou» ne veulent pas manquer l'opportunité et ceci pour des raisons économiques.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 26
33..55.. OOrrggaanniissaattiioonn ssoocciiaallee La plus petite unité sociale chez les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka se constitue du groupe de résidence (bande) caractérisé par une sorte de campements séparés à l'intérieur des villages. Les membres de la bande vivant ensemble tout au long de l’année, disposent des campements forestiers et des terres utilisées en commun. Chaque bande est composée de différentes familles et peut avoir un nombre allant de 10-80 personnes. Etant donné que les hommes restent pratiquement toujours dans leur bande après s’être mariés, la stratification sociale peut être définie comme une relation patrilinéaire. Par conséquent, quand c'est un groupe d’hommes anciens nés dans la bande, il s'agit généralement des «chefs» ou bien encore des dirigeants. A cause de la forte croyance en leurs liens patrilinéaires qui ne sont pas toujours développés au même degré dans certains autres groupes, la majorité des bandes reste très reliée aux autres bandes dans la même région. Ce fait joue un important rôle dans leur vie culturelle, mais il ne doit pourtant pas être considéré comme le représentant d'une entité politique ou géographique entière. Chez les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka, les clans constituent un élément fondamental dans l’organisation sociale. Il représente un groupe de filiation patrilinéaire et exogame dont le nom rappelle généralement un épisode de la vie de l’ancêtre fondateur, une représentation souvent mythique. Tableau 2: Taille moyenne des camps des peuples autochtones
Groupes N° de huttes N° de personnes Sources Asua 12-15 60 – 80 Ichikawa 2003 Efe 8 30 – 40 Turnbull 1961 Aka 8 20 – 30 Bahuchet 1995ff Twa 10 40-50 Shalukoma 1993, 2000 Cwa 7 10-20
Des groupes voisins se rencontrent régulièrement lors des expéditions de cueillette et de chasse ainsi que lors de maintes cérémonies et de danses rituelles. Les familles liées par mariage se rendent souvent visite pendant quelques jours et même pendant des mois entiers à leurs parents vivant dans d'autres campements. A ces occasions, les visiteurs participent dans les campements à la vie quotidienne de leurs hôtes tout comme s'ils étaient chez eux-mêmes et cette pratique bien répandue fait en sorte qu'il y ait toujours une famille absente parce que partie en visite ou bien qu'une autre soit venue rendre visite. Le choix des épouses dans des campements éloignés et la tradition du «service des fiancés» encouragent encore plus les visites (un époux fait un long séjour de visite chez la communauté de son épouse). Le fait que tous les campements à l'intérieur d'une localité sont considérés comme placés sous les ordres d'un chef, l'interaction entre ces différents campements a augmenté au cours des années et les ONG ont fait bien des efforts pour encourager cette coopération entre les différents campements de la localité afin de renforcer la position des peuples autochtones lors des discussions avec le chef de la localité. Bien que la majorité parmi les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka se retrouvent actuellement sans autorisation de chasser et de cueillir, leur ancienne vie de chasseurs-cueilleurs continue toujours d'avoir des influences sur leur organisation sociale, leur vie habituelle, interrompue de manière brusque, demeure toujours le fondement de leurs valeurs culturelles actuelles. Cette organisation sociale incarne une dynamique interne bien distincte et elle joue sur la façon dont les changements se concrétisent tout comme elle favorise certaines adaptations plus que d’autres. Les campements doivent s’élargir ou bien se réduire quand il s'agit de maintenir la viabilité des activités de chasse et de cueillette et d'assurer une certaine harmonie sociale. Une ‘stratégie d’évitement’ – s’éloigner des gens avec qui l’on est en conflit – est une méthode bien générale quand il s'agit de résoudre des problèmes. Les PA se servent le plus souvent de leur mobilité lorsqu'ils cherchent à éviter des problèmes tels que la faim, la maladie, la domination politique par leurs voisins agriculteurs ou encore les querelles entre eux. Les relations entre les hommes et les femmes dans ces sociétés dites de «retour immédiat» font partie des plus égalitaires connues (Endicott 1981). La coutume que constitue le partage et d’autres «mécanismes de nivellement» assurent le maintien d’une égalité relative entre tous les membres d'un campement. Les rôles de «direction» sont assumés en fonction d'un contexte déterminé: les individus, femmes ou hommes, dont l’expérience et les capacités sont reconnues dans un contexte particulier, peuvent être démocratiquement acceptés comme exerçant quelque autorité dans ce même contexte, par exemple, lors des expéditions de chasse ou de cueillette, mais aussi pendant certaines prestations rituelles, ou encore, à l'arrivée des personnes extérieures, en tant que porte-parole. Le processus de prise de décision au niveau du village cherche le consensus parmi tous les anciens des différentes bandes coexistant dans un même village (parfois, dans certains villages, jusqu’à 10). Comme on peut s’y attendre dans un système de relation patrilinéaire, les femmes ne sont quasiment jamais intégrées au processus de prise de décision, même lors des discussions concernant les affaires considérées comme celles des femmes (cueillette, agriculture, etc.).

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 27
Quant aux affaires extérieures (interactions avec les étrangers tels qu’agents gouvernementaux, commerçants, etc.), chaque bande nomme une sorte de dirigeant dont les qualifications sont évaluées par rapport à son niveau «avancé» de français, lingala ou swahili, ou encore en fonction de ses bonnes relations avec un tel agent officiel du gouvernement ou d’un village «Bantou». Le «chef pygmée» est un chef nommé uniquement pour les affaires extérieures, mais sans avoir aucune autorité sur la bande. Les organisations sociales et politiques dépassant le niveau que représente la bande, font partie des inventions assez récentes sans correspondre avec «l’approche consensuelle» traditionnelle de l’interaction sociale, mais les institutions extérieures aiment pratiquement toujours passer par un «leader» et elles se méfient lorsqu’elles deviennent les témoins d’antagonismes, de conflits ou de fragmentation, ou quand elles se retrouvent devant une situation où plusieurs personnes se présentent en même temps comme étant le leader et même lorsque, tout au contraire, personne ne veut assumer ce rôle. Le découpage administratif actuel en RDC reflète l'héritage de l’administration coloniale. Chaque province se subdivise en plusieurs districts, territoires et secteurs regroupant un ensemble des villages (depuis les regroupements étatiques et involontaires). Sous la haute tutelle du Préfet, la représentation du territoire est assurée par l'Administrateur, suivi, au niveau hiérarchique, immédiatement par un Chef de Secteur auquel sont subordonnés les chefs de groupement. Dans la plupart des cas, les localités des peuples autochtones sont considérées comme quartiers à l'intérieur d'un village (localité) tombant sous l’autorité du chef de village qui est, le plus souvent, un «Bantou». Le cas où le chef d'un des villages habités par les peuples autochtones soit lui-même un autochtone n'existe que trois fois en toute la RDC. Toujours est-il que les statuts politiques sont reconnus aux peuples autochtones dans leurs relations immédiates par leurs voisins, mais moins souvent par les représentants étatiques de la plus haute hiérarchie. Ils ne sont représentés ni dans aucun des conseils ruraux, ni dans l’administration de l’état, ni dans le parlement non plus, et il ne figure parmi eux presque aucun fonctionnaire.
33..66.. EExxaammeenn dduu ccaaddrree llééggaall Du point de vue légal, les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka sont des citoyens égaux par rapport à toutes les autres personnes nées en RDC. L’article 12 de la constitution de 2006 affirme que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection par les lois ». L’article 13 précise que «aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique», et l’article 51 affirme que «L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays et assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités»; mais, en réalité l’égalité des citoyens déclarée dans la Constitution n’existe pas vraiment: L’éducation est officiellement ouverte à tous, mais il se trouve que les enfants des peuples autochtones ne vont pas à l’école (12% seulement des enfants Twa vont à l’école; Plumptre et al 2004: 54), et quand ils vont à l’école, dans leur très grande majorité, ils s'arrêtent déjà au niveau des cours des toutes premières années et ceci, le plus souvent, pour la toute simple raison que leurs parents ne disposent pas de l'argent nécessaire pour payer les frais de scolarité (USD 15 par an pour l’école premier et USD 30 pour l’école secondaire). Les conditions économiques et sociales sont dures pour tout l'ensemble des citoyens du pays et il est très certain que les problèmes que rencontrent les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka doivent aussi être compris dans ce contexte. Selon les expériences de l'auteur, les efforts déployés en faveur des populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka et sur l’initiative de l’Etat s'expliquent par des actions des fonctionnaires consciencieux lorsqu'ils prennent eux-mêmes et de manière individuelle des mesures selon leurs propres possibilités et prêtant ainsi assistance aux peuples autochtones quand ceux-ci cherchent à faire valoir leurs droits en tant que citoyens. La discrimination que les Twa, Mbuti, Cwa et Aka doivent subir en RDC se fonde sur le fait qu'on les associe à l'idée d'une «vie sauvage» et surtout à celle d'une vie nomade et non agricole. Cependant, de telles pratiques de ségrégation et de discrimination, des stéréotypes négatifs ou le refus de reconnaître à tout le monde les mêmes droits se rencontrent aussi partout ailleurs. Les problèmes que rencontrent les gens de cette région sont très nombreux, mais tout le monde s'accorde aussi que les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka constituent l’une des communautés les plus pauvres et c'est pourquoi l'une des plus vulnérables aussi parce qu'il est claire que la pauvreté est aussi causée par la discrimination. Parmi les fonctionnaires de l'Etat, c'est la majorité qui semble vouloir distinguer les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka par rapport aux autres citoyens (Kabananyuke 1999: 150, 164, 167; Barume 2000: 49 à 51; Lewis 2001: 14-20) et le gouvernement n’a pas encore décidé des mesures efficaces et assurant

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 28
que ces citoyens que sont les peuples autochtones, puissent aussi profiter de la législation selon laquelle «aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique» (Constitution 2006; §13). Dans toutes les régions habitées par les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka, la majorité parmi leurs voisins possèdent des actes de naissance pour leurs enfants. Par contre, les peuples autochtones n'en possèdent que très rarement. Chaque enfant issu des populations autochtones semble alors être marginalisé déjà dès sa naissance; et à chaque étape de sa vie, il se retrouve encore un peu plus marginalisé par ces fléaux que sont la discrimination, la pauvreté et l’exclusion et l'isolant ainsi de plus en plus du reste de la société. Dans certains cas, les peuples autochtones, particulièrement les locataires, se voient refusés le droit de créer des mouvements ou des associations, tandis que leurs «propriétaires» - non autochtones - profitent de leur travail et de toutes leurs autres capacités. Face à cette situation, sans carte d'identité, sans propre terre, sans accès à l'éducation ni à la justice, beaucoup parmi eux doivent se sentir comme prisonniers d'une communauté apatride alors qu'ils vivent bel et bien à l'intérieur d'un Etat. Les droits individuels des populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka sont extrêmement faibles. Les abus à leur encontre sont fréquents et ceux qui les commettent échappent pratiquement toujours à la justice en toute impunité (Barume 2000: 64-67; Lewis 2001: 14-20). Certains d'entre eux ne voient aucun mal à se servir des biens des peuples autochtones, soit simplement par force ou soit encore de manière frauduleuse, et tout en prétextant qu’ils prennent, bien sûr, mais qu'ils ne volent jamais! Devant un tribunal, les Twa, Mbuti, Cwa et Aka savent rarement se défendre de manière efficace, et c'est tout autant rare que justice leur soit rendue lorsqu'ils sont victimes des violations de leurs droits. Des erreurs judiciaires sont fréquemment signalées dans les documents relatifs aux peuples autochtones. Dans des cas graves, des responsables locaux s’associent avec des paysans dans le seul objectif d'exproprier les populations Twa, Mbuti, Cwa ou Aka, comme ils peuvent aussi chercher à taire et couvrir des abus graves commis contre ces populations. Souvent, on les entend dire d'avoir besoin de l’appui d’un «Bantou» pour favoriser l'appui d'une de leurs plaintes auprès des autorités ou pour soutenir une action en leur nom. Ces injustices frappantes témoignent à quel point les peuples autochtones sont défavorisés et qu'ils ne bénéficient pas des même droits et libertés fondamentales que les autres habitants de la RDC. Toute discrimination à leur égard est fondée sur l'identité ethnique qu'on leur a imposée. La même discrimination constitue d'ailleurs un sérieux problème bien connu en RDC. Toujours est-il que l'amélioration des conditions de vie de ces populations semble être le seul indicateur valable et sûr d'une quelconque amélioration de leur situation ethnique, sociale, économique et politique.
44.. CCoonnssuullttaattiioonn Le rapport suivant présente le résultat d’une étude à court terme réalisée en Février 2006 – Janvier 2007 par Dr Kai Schmidt-Soltau, élaborée dans une approche participative et en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (populations autochtones, associations des peuples autochtones, autres populations rurales, ONG, agences gouvernementales, bailleurs, etc.). Ces recherches consistent en 4 phases: • Pendant une première phase les entités (LINAPYCO, REPALEAC, PIDP, CNCJA et ANPANMNP-
PFNB), les ONG (Réseau CREF, UEFA, RAPY, CENADEP, Africapacity, ADEV-Boma, Pygmeeen Kleinood, PAP-RDC, GASHE, CEDEN, DPMET, ERND, OCEAN, OSAPY, CSPSP, PROCOOPYBA, Héritiers de la justice, APDMAC, CPAKI, CAMV, ARAP, APIDE, CEFEO et RRN) ainsi que des organismes bailleurs (Banque Mondiale, UE, France, UN-OCHA, KFW, GTZ) mais aussi d'autres projets relatifs aux peuples autochtones (WWF, WCS) ont été consultés avec cet objectif de collecter des informations de référence et d'évaluer les approches déjà existantes visant l’intégration des peuples autochtones dans le processus de développement.
• Pendant une deuxième phase en février/mars 2006, 8 ateliers de consultation sur les impacts du Projet GEF-BM et sur les mesures de leur atténuation ont été organisés avec la participation des populations autochtones des villages Bigamiro-Mutaho, Nirengenga-Mukendo, Maguha-Mabola, Mopaka, Upende, Mavievie-Endoyi, Mamundioma et Makoyoba (tous en Nord-Kuvu).
• La troisième phase consistait à consulter les peuples autochtones et leurs associations directement sur le rapport préliminaire.
• Finalement, le rapport lui-même ont été discutés et approuvés au cours des ateliers de restitution (Kinshasa 10/1/2007 et Beni 13/1/2007) avec la participation de toutes les parties prenantes (voir annexe).

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 29
55.. EEvvaalluuaattiioonn ddeess iimmppaaccttss eett pprrooppoossiittiioonnss ddeess mmeessuurreess dd’’aattttéénnuuaattiioonn ssppéécciiffiiqquueess rreellaattiivveess aauuxx ppooppuullaattiioonnss aauuttoocchhttoonneess Dans la partie suivante, il s'agira d'examiner, de manière à la fois générale et détaillée, les impacts/effets possibles du Projet GEF-BM sur les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka. Il s'agira d'examiner les possibles impacts/effets positifs, négatifs et cumulatifs et, en fonction de la logique de leur cadre logique, en commençant par les conclusions de l'impact global du Projet GEF-BM.
Dans un déroulement réussi, qui devra fonctionner en accord avec les perspectives définies par les documents divers du Projet GEF-BM et par la politique de sauvegarde envisagée par la Banque Mondiale, le Projet GEF-BM soutiendra le plein respect de la dignité, des droits humains ainsi que de l'unité culturelle, il protégera les peuples autochtones contre les effets négatifs du processus de développement et il devra garantir que ces populations profitent des mêmes bénéfices sociaux, économiques et culturels que ceux proposés aux autres bénéficiaires. Or, l’ICCN devra assurer, qu'à cause de la réhabilitation et expansion du réseau des aires protégées dans le contexte du Projet GEF-BM, ces populations ne: • ne perdent le contrôle des terres et des zones d’usage qu’ils utilisent traditionnellement comme
source de subsistance et qui forment la base de leur système culturel et social, • ne soient davantage marginalisés au sein de la société congolais, • ne se désintègrent au système décentralisé d’administration, • ne bénéficient moins d’assistance des services gouvernementaux, • ne soient moins capables de défendre leurs droits légaux, • ne deviennent ou demeurent dépendants des autres groupes ethniques, • ne perdent leur identité culturelle et sociale.
Lors des discussions avec les parties prenantes, il a été confirmé que toutes les parties prenantes seront prêtes d'assister les peuples autochtones à faire face à ces risques. Mais des obstacles nombreux existent: le faible niveau de décentralisation et la mauvaise communication entre les parties prenantes résultent en un faible niveau de connaissance de l’importance ou même de l’existence des populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka. La faible compétence des fonctionnaires de l'ICCN dans les domaines des interactions avec les populations rurales en général (voir EIS Projet GEF-BM) et avec les peuples autochtones en particulier est souvent à l'origine du fait qu'on ignore ces groupes, mais y contribue également un protectionnisme accru d'un système de favoritisme et/ou célébrant une «domination ethnique». Tous ces phénomènes constituent la menace principale à l’intégration intégrale de ces populations dans la société et à tous les systèmes d’atténuation élaborés par les autorités gouvernementales. Si ces problèmes ne sont pas résorbés, la reforme du domaine de gestion des aires protégées – constituant l'objectif principal du Projet GEF-BM - atteindra peut-être ses objectifs écologiques, mais ces forêts autour des aires protégées, au lieu d'être transformées en zones de sécurité risquent de devenir des zones de pauvreté.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 30
Composante 1 : Appui à la réhabilitation institutionnelle de l'ICCN Activités Impacts sur les peuples autochtones5
Assistance technique, entraînement et équipement pour la direction administrative et financière de'ICCN
Le fait qu'aucun des PA ne soit employé par l'ICCN comporte le grand risque que le renforcement de l'ICCN reste le seul domaine des Bantu avec cette éventualité que le programme de formation ne tienne pas compte des intérêts des PA, comme par exemple de celui de la sensibilisation à propos de la PO 4.10.
Appui à la stratégie de communication de l'ICCN, de CoCoCongo et des concertations de toutes les parties prenantes Services analytiques des mécanismes de financement durables pour la conservation de la biodiversité
☺ Le système de communication pourrait sensibiliser les parties prenantes sur les droits et la culture des PA de même que sur les avantages de leur système d'utilisation des terres.
☺☺ L'implication de toutes les parties prenantes dans la mise en oeuvre du Projet GEF-BM offre l'opportunité d'augmenter le nombre de participants parmi les PA dans le processus de prise des décisions afin de mieux défendre leurs droits, leur culture et leur mode de vie. Il est à craindre que, si des mesures adéquates ne sont pas prises, l'inaccessibilité pour les PA aux services publiques ne leur laisse aucune réelle chance de participer au système de la communication, etc.
La marginalisation des PA dans la société en général et plus particulièrement encore dans les positions de prise de décision comporte le grand risque que leurs intérêts soient pas pris en compte dans le système de la communication, etc.
Composante 2: Appui aux Parcs Nationaux sélectionnés Activités Impacts sur les peuples autochtones
Entraînement: surveillance juridique, suivi biologique et approches de conservation communautaire; Coûts du personnel: en complément au salaire donné en fonction de la performance des gardiens Equipement et accessoires: voitures, avion ultra-léger, communication,etc. réhabilitation des stations importantes dans les parques, maison des employés, infrastructures des centres d'entraînement Coûts opérationnels: maintenance et réparation, voyages, essence, matériel bureautique, rations pour les gardes des parcs
☺ Cela contribuera à la création des opportunités d'emploi des gardiens de parc, guides, etc. ou encore de cadre de l'administration.
☺ Le renforcement du PN pourrait générer des opportunités d'emploi pour les PA, améliorer les compétences de la communication interculturelle des employés du PN et changer ainsi l'approche actuelle qui exclue les PA des parcs nationaux en leur défendant l'utilisation durable des aires protégées.
La constellation actuelle comporte le grand risque que les PA ne puissent pas participer au partage des bénéfices de cette activité, ni profiter de leurs droits, ni de leur savoir-faire de façon à ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins; il faut donc la changer de telle sorte que leur existence soit prise en compte.
Le fait qu'aucun des PA ne soit employé par les PN comporte le grand risque que le renforcement reste le seul domaine des Bantu avec ce danger que leurs intérêts n'y soient pris en compte.
Développement communautaire et management participatif: appui aux comités de dialogue inter-villageois et campagnes de sensibilisation, création des infrastructures sociales utilisant des techniques de travail intensif, amélioration des conditions de vie des populations locales et autochtones, programmes de collaboration avec des associations de base et des ONG sur l'écotourisme, les zones de chasse et les réserves communautaires;
☺☺ Une gestion communale des parcs nationaux pourrait contribuer à réduire les impacts sociaux négatifs et constituer la base d'un partage plus juste en fonction des coûts sociaux causés par la conservation de la biodiversité.
☺ Cela pourrait contribuer à la création des opportunités d'emploi. Dans la constellation actuelle, il paraît très improbable que les PA aient droit à un
partage équitable des bénéfices générés par des aires protégées (emploi, tourisme, etc.). Dans la constellation actuelle, il paraît très invraisemblable que les intérêts des PA
soient représentés de manière équitable dans le processus de prise de décisions et de gestion des aires protégées, etc. Cela pourrait être à l'origine d'une aggravation de leur situation de marginalisation et de pauvreté.
Sans envisager des actions appropriées, il paraît certain que l'amélioration des surveillances des parcs nationaux sur les terres des PA limite leurs accès à leurs sources de revenus, à leur terre, et/ou aux compensations pour le déplacement physique ou économique, et/ou à l'option de participer à une co-gestion des parcs nationaux. Il s'ensuivra un autre appauvrissement et une plus grande marginalisation des PA.
Etudes, suivi et recherche: études socio-économiques, plan de développement touristique (Virunga), appui aux rencontres des donateurs locaux (CoCoSi) et à l'établissement des comités de toutes des parties prenantes Appui à la collaboration trans-frontalière pour Virunga et Garamba:
☺☺ L'implication de toutes les parties prenantes dans la gestion des PN offre l'opportunité d'augmenter la participation des PA dans le processus de prise de décisions afin de mieux défendre leurs droits, leur culture ainsi que leur mode de vie.
☺ Le système de communication, les études et le tourisme pourraient sensibiliser les parties prenantes sur les droits et la culture des PA ainsi que les avantages de leur système d'utilisation des terres. Si des mesures adéquates ne sont pas prises, il est à craindre que l'inaccessibilité aux services puboiques des PA ne leur laisse aucune réelle chance pour participer au système de la communication, à la mise en œuvre des études, etc.
La marginalisation des PA dans la société et dans les positions de prise de décision comporte le grand risque que les intérêts des PA ne soient pas pris en compte dans le système de la communication, des études et du développement du secteur touristique, etc.
5 Légende des impacts: ☺☺ = Impact positif important, ☺ = Impact limité ; = Sans impact notable, mais information dont
il faut tenir compte ; = Impact négatif limité ; = Impact négatif important.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 31
Composante 3 : Expansion du réseau des aires protégées Activités Impacts sur les peuples autochtones6
Assistance technique à la coordination et au contrôle de qualité
Entraînement à l'attention des équipes de l'ICCN, surveillance, consultation et méthodologie de cartographie;
Equipements et accessoires, coûts opérationnels d'imposition et de consultations
Services de consultation et de partenariat en collaboration avec des ONG et des académiques nationaux et internationaux pour une surveillance biologique, consultations locales, sensibilisation des consciences, études socio-économiques
☺☺ Le processus de zonage d'identification des régions pour les nouvelles aires protégées permettra d'identifier des zones d’utilisation coutumière des PA en perspective et la légalisation de cette utilisation en même temps. ☺ L'identification et la démarcation commune des nouvelles aires protégées
contribueront à réduire les impacts sociaux négatifs et à préparer la base d'un partage juste en fonction des coûts sociaux causés.
☺ L’identification et la création des nouvelles aires protégées devront contribuer à créer des opportunités d'emploi comme pisteurs, guides, assistants et/ou des postes d'administration. Ces mesures doivent être bien suivies afin d'assurer qu'elles n'entraînent pas une aliénation culturelle. Il est peu probable que l'identification et la démarcation dans sa forme proposée puissent identifier les campements de chasse des PA et les zones d’usages.
Une bonne partie de la surface utilisée par les PA sera exclue de cette activité parce que le zonage ne couvrira pas les aires protégées existantes et la conséquence en sera le déplacement économique des populations de ces régions ce qui mènera finalement sur un chemin d'appauvrissement.
Les PA n’étant pas représentés dans les structures étatiques, courent le grand risque que leurs droits d’utilisation ne soient pris en compte lors de l’affectation et qu'ils soient convertis à d'autres usages.
Il paraît très invraisemblable que les intérêts des PA soient représentés de manière équitable dans les zones d'exercice, au cours du processus de prise des décisions (quel type d'aires protégées et dans quelles limites) ou dans la gestion des aires protégées, ce qui comporte le risque d'aggraver encore leur situation de marginalisation et de pauvreté.
Sans envisager des actions appropriées, il est certain que l'installation des aires protégées sur les terres des PA continuera sans pour autant leur offrir l'accès aux terres et/ou à l'option de participer dans l'administration commune des aires protégées. Il s'ensuivra un autre risque d'aggraver leur situation de marginalisation et de pauvreté.
Les PA courent le grand risque d'être déplacés économiquement de leurs forêts et que leurs droits ne soient pas pris en compte du fait que la protection des zones d'usage dans les campements ne serait pas le résultat du cadre réglementaire.
Après ces considérations détaillées concernant les risques et impacts résultant des 3 composantes du Projet GEF-BM, l'aspect de l'environnement social général doit maintenant être abordé:
Obstacles institutionnels, légaux et conceptuels • Ni les associations des peuples autochtones, ni les services gouvernementaux, ni et encore moins
les ONG oeuvrant dans le domaine de l'environnement n’ont la moindre idée de la manière dont les droits et les systèmes de la vie traditionnelle des peuples autochtones doivent être traités à l'intérieur du système moderne de la gestion des aires protégées.
• La plupart de leurs campements ne sont pas considérés en tant que localité, et la conséquence en est qu'ils ne peuvent rarement exprimer leurs besoins communs auprès des institutions gouvernementales, qui ne travaille qu'avec des individus ou villages mais avec des «localités».
• Leurs zones d’utilisation (exploitation forestière rurale, chasse, cueillette et pêche) ne disposent d'aucune forme de protection légale et la loi en vigueur autant que le projet de loi sur la conservation interdisent toutes les activités économiques dans les parcs nationaux et un grand nombre des activités économiques dans les aires protégées et les zones tampons. Par conséquent, les peuples autochtones dépendent plus ou moins des sources «illégales».
Mesures d’atténuation des obstacles institutionnels, légaux et conceptuels • La base de toute amélioration dans les relations entre le gouvernement et les peuples autochtones
se trouve dans la reconnaissance mutuelle et dans la volonté d’apprendre chacun de l’autre. Une formation du personnel de l’ICCN, de ses partenaires, des ONG et des associations des peuples autochtones sur la base du standard international (la PO 4.10) contribuera à une bonne compréhension du fait que le respect des droits, de la culture et de la dignité des peuples autochtones doivent constituer un préalable et un signe de bonne gouvernance qu'incarne l’objectif du Projet GEF-BM et celui de l’ICCN.
• Sur la base d’une campagne de sensibilisation destinée aux fonctionnaires et autorités traditionnelles à tous les niveaux du secteur rural et appuyée par un arrêté gouvernemental propre à promouvoir la reconnaissance de toutes les communautés Twa, Mbuti, Cwa et Aka en tant que localité, facilitera l'intégration des peuples autochtones dans le processus de la prise de décision.
6 Légende des impacts: ☺☺ = Impact positif important, ☺ = Impact limité ; = Sans impact notable, mais information dont
il faut tenir compte ; = Impact négatif limité ; = Impact négatif important.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 32
• De manière globale, on peut distinguer, parmi les peuples autochtones, entre les cinq catégories suivantes: a) Des peuples autochtones vivant dans le PNVi à l'heure actuelle soit de manière permanente
temporaire et dépendant avant tout de leurs ressources; b) Des peuples autochtones vivant traditionnellement soit de manière permanente ou temporaire
dans les PNVi, mais qui en ont été déplacés; c) Des peuples autochtones vivant, soit de manière permanente ou temporaire dans les nouveaux
aires protégées - dont la création est prévue par le Projet GEF-BM - en dépendant essentiellement de ses ressources;
d) Des peuples autochtones vivant dans la zone tampon autour des PNVi; et e) Des peuples autochtones vivant dans la zone tampon autour des nouvelles aires protégées. Etant donné que les solutions proposées en faveur d'un groupe ne fonctionnent pas automatiquement autant pour un autre, il est important de s'adresser à toutes ces différentes catégories de personnes et de chercher à connaître leurs besoins de manière individuelle: • En ce qui concerne le groupe a, b et c, la PO 4.10 suggère que «la réinstallation des populations
autochtones posant des problèmes particulièrement complexes et pouvant être lourde de conséquences pour leur identité, leur culture et leurs modes de vie traditionnels, l’emprunteur envisage différents scénarios possibles pour éviter de déplacer les populations autochtones», Basé sur les bonnes expériences faites dans la Réserve de Faune à Okapi et dans d'autres pays (Gabon & Cameroun), l’ICCN devra modifier le projet de la loi de la conservation et les plans d’aménagement des toutes les aires protégées de manière à permettre aux peuples autochtones de continuer à chasser et à cueillir dans leur forêt à l'intérieur des parcs nationaux et des autres aires protégées existantes ou proposées ainsi que de commercialiser les produits de ces activités sous la supervision de l’ICCN (voir aussi CPoR Projet GEF-BM).
• En ce qui concerne les personnes dans les zones tampons – catégorie d & e, l’ICCN va mettre en place des concessions des communautés locales bien équipées pour toutes les localités des populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka dans les zones tampons de toutes les aires protégées existantes ou proposées. Sur la base des procédures légales déterminant la mise en place des concessions des communautés, le gouvernement de la RDC leur permettra de continuer jusqu'à un certain degré leur vie de chasseurs-cueilleurs. Afin de mieux encourager encore l’utilisation durable des forêts, chacun des campements habités par des peuples autochtones recevra des forêts et que chacun de ses habitants pourra disposer tout au moins d'une superficie d'un Km². Ce minimum de superficie devra permettre à ces populations de pouvoir continuer, du moins à un certain degré, avec leur mode de vie basé sur la chasse et la cueillette et de pouvoir en tirer des ressources de subsistance, mais aussi de contribuer à une gestion durable des vastes portions de forêt (Robinson & Bennett 2000).
Obstacles techniques • Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les peuples autochtones, dans leur grande majorité, n’ont pas les
capacités techniques nécessaires à une participation active aux discussions et activités techniques pour mieux prévenir les impacts à long terme des décisions qui leur restent abstraites (lois, réglementations, contrats, plan d’aménagement, etc.). Par conséquent, les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka ne sont pas en mesure de défendre leurs droits, besoins et intérêts et ceci même dans les rares cas où ils sont intégrés dans le processus de prise de décisions.
• Les institutions gouvernementales ainsi que les autres parties prenantes ne disposent pas des capacités nécessaires à un meilleur dialogue avec les peuples autochtones. De ce fait, ces populations ne sont pas traitées avec le respect dû à leur dignité, leurs droits et leur culture.
• Les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka sont généralement dépourvues des compétences techniques leur permettant de conserver et de protéger le savoir-faire traditionnel relatif à la gestion des ressources naturelles etc.
Mesures d’atténuation des obstacles techniques • L'ICCN élabore en collaboration avec des ONG internationales spécialisées dans ce domaine
(UICN-TILCEPA, FPP, etc.) et des associations des peuples autochtones, sur la base des meilleures pratiques, des programmes de formation concernant tous les sujets liés à la cogestion des aires protégées. La sensibilisation ainsi que la formation sera assurée par le personnel des associations des peuples autochtones et ils devront permettre un développement des capacités techniques modernes parmi les peuples autochtones. En dehors des aspects plus ou moins techniques de ces opportunités de formation, un accent spécial sera mis sur une meilleure

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 33
compréhension entre les peuples autochtones et leurs voisins de manière à favoriser l'ouverture d'une voie vers des relations nouvelles et plus bénéfiques.
• L’ICCN élabore en collaboration avec des ONG internationales spécialisées dans ce domaine (UICN-TILCEPA, FPP, etc.) ainsi qu'avec des associations des peuples autochtones, sur la base des meilleures pratiques, des programmes de formation afin de pouvoir accroître les capacités techniques du personnel de l’ICCN, de ses partenaires et de toutes les autres parties prenantes (ONG, prestataires des services, etc.) travaillant dans les zones habitées par les peuples autochtones dans le domaine de collaboration avec celles-ci.
• Même le meilleur système d’atténuation offrant un accès et des bénéfices équitables aux peuples autochtones, va toujours continuer à avoir des impacts sur leur culture et leurs croyances. Le débat parmi les spécialistes en sciences sociales se poursuit – et peut-être s'arrêra-t-il jamais - sur la meilleure manière de conservation de la culture des populations autochtones au cours du processus de développement. La meilleure pratique, semble-t-il, consiste à assurer la sensibilisation sur les risques liés à ce processus, à assister les associations des peuples autochtones dans le renforcement de leurs capacités de défendre leurs connaissances, leur culture, leurs modes d’utilisation des forêts traditionnelles ainsi que de promouvoir la communication et l’échange d’expériences avec les autres peuples du secteur rural. Toutefois, toutes ces activités ne seront jamais en mesure de sauvegarder cette culture et ces croyances en leur ancien état traditionnel, mais elles offrent la possibilité de mieux comprendre les risques et de trouver des solutions propres d'adaptation de leur culture au mode moderne d'interaction.
Obstacles financiers • La contribution financière exigée de la part des participants lors des réunions et des programmes de
formation est généralement trop élevée pour permettre aux peuples autochtones démunis d’y prendre part. Par conséquent, ils restent dans leur majorité exclus des différentes réunions et formations avec cette conséquence qu'ils se retrouvent de plus en plus marginalisés.
• Les peuples autochtones ne jouissent pas d’un accès juste et équitable aux emplois en relation avec les interventions du Projet GEF-BM (gardes des parcs, fonctionnaires, guides, etc.) parce qu'ils ne disposent pas de la qualification formelle exigée. De ce fait, ils ne tirent pas de bénéfices équivalents du Projet GEF-BM et s'en retrouvent de plus marginalisés et appauvris.
Mesures d’atténuation des obstacles financiers • L’ICCN modifiera les modes de distribution des revenus des aires protégées afin d'assurer que les
peuples autochtones reçoivent leur part lors du partage des bénéfices accrûs (EIS Projet GEF-BM). Leur part sera égal ou supérieur par rapport à leur pourcentage parmi la population installée à l’intérieur des aires protégées et leurs zones tampons. L’argent sera remis aux représentants élus des peuples autochtones au niveau du secteur pour être redistribué ensuite aux différents représentants des campements en fonction de leur étendue. Il est à suggérer qu'une petite partie de cet argent (5-10%) soit retenue au profit d'un bon fonctionnement des associations des peuples autochtones.
• L’ICCN offrira des programmes spéciaux destinés aux populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka pour les faire bénéficier de l'ouverture des postes et d'emplois dans le cadre de la mise en oeuvre ou du renforcement des aires protégées ainsi que du Projet GEF-BM (garde de parc, pisteur, etc.);
Obstacles organisationnels • Les peuples autochtones ne sont pas équitablement représentés au sein des instances de prise de
décisions. Leurs droits, besoins et intérêts ne sont donc pas considérés lors de la prise de décisions. • Les peuples autochtones ne sont pas représentés dans le système de suivi et de l’évaluation de
l’ICCN et s'en retrouvent exclus de la dynamique du processus de suivi et évaluation.
Mesures d’atténuation des Obstacles organisationnels • L’ICCN assure aux peuples autochtones le droit à une représentation égale ou supérieure dans
tous les ateliers, les réunions, etc., et aussi dans les instances de prise de décisions, selon leur proportion dans la population rurale, à travers la politique nationale concernant les peuples autochtones. Le Projet GEF-BM offre aux peuples autochtones une représentation équivalente à leur proportion dans la population rurale (les populations affectées par le Projet GEF-BM) au sein de chacune des commissions créées ou maintenues dans le cadre de la mise en œuvre du Projet GEF-BM.
• L’ICCN mettra en œuvre un suivi participatif d’impact du Projet GEF-BM et du PPA.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 34
66.. AAnnaallyyssee ddeess ccaappaacciittééss Dans le domaine de la collaboration entre les institutions gouvernementales et les peuples autochtones, la différence entre la théorie (loi, volontés officielles, etc.) et la pratique, demeurent importantes. En général, l’ICCN et les autres structures gouvernementales n'ignorent pas ces décalages et souhaitent l'atténuer autant que possible. Certaines initiatives individuelles ont été émises de manière ponctuelle afin de favoriser l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones, mais la volonté étatique collective reste focalisée sur la création des richesses capables d'améliorer les conditions de vie dans le secteur rural. Dans ce contexte, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) en cours de finalisation, place les ressources naturelles, la forêt et aussi la biodiversité et l’environnement, comme piliers de son plan d’action. Le Projet GEF-BM Il s’inscrit également dans ce cadre du DSRP (Projet GEF-BM: 7), mais, il est bien connu que toutes ces directives n'ont que difficilement un impact positif réel sur les groupes marginaux et vulnérables. Une évaluation récente de la Banque Mondiale relative aux impacts de la croissance économique dans 6 pays d'Amérique du Sud a démontré que les peuples autochtones ne se trouvent pas parmi les bénéficiaires de la croissance globale. En réalité, leurs conditions de vie s'en sont même empirées (World Bank 2005) et une évaluation globale des projets GEF suggère même que la conservation de la biodiversité offre seulement un petit ou même aucun bénéfice aux populations locales en général et aux peuples autochtones plus particulièrement (GEF-ME 2005). La volonté politique du gouvernement et de l’ICCN, exprimé à travers l'élaboration de ce PPA, de se tourner vers les besoins spécifiques des peuples autochtones, constitue une décision dans la bonne direction et une réponse satisfaisante aux exigences de sauvegarde définies par la Banque Mondiale. Sans ajustement de stratégie visant les peuples autochtones ainsi que d'autres populations marginalisées, le Projet GEF-BM ne parviendra pas à atteindre son objectif social.
Afin d'implanter cette nouvelle stratégie, l’ICCN et ses partenaires devront améliorer leurs compétences dans le domaine social. A présent, moins d'1% parmi le personnel de l'ICCN a fait des études en sciences sociales. Parmi les 1.800 fonctionnaires de l'ICCN se trouvent seulement environ 10 sociologues et environ 5 anthropologues. Leurs connaissances sont acceptables, mais ils ne disposent que rarement des expériences pratiques et le plus souvent, ils sont trop peu nombreux pour pouvoir installer les changements nécessaires. Mais la conscience d'un besoin de changement existe déjà et on affirme d'être de plus en plus consultés lors de l'élaboration et de l'implantation des activités. Comme il n'existe aucune structure administrative permettant de développer le débat sur les questions de savoir comment intégrer les leçons tirées dans le travail quotidien ou encore, comment communiquer les expériences faites hors du pays, les meilleures pratiques (cogestion, intégration des peuples autochtones, mesures de partage des bénéfices, etc.) restent toujours ignorées par l’ICCN.
Il y a un seul fonctionnaire au sein de l'ICCN disposant des connaissances relatives aux besoins spécifiques des peuples autochtones. Ces connaissances doivent être présentées, développées et ensuite mises à la disposition des fonctionnaires par un spécialiste en sciences sociales disposant des connaissances théoriques et pratiques sur ce sujet. Quant aux autres personnes engagées dans ce travail en collaboration avec les peuples autochtones et avec tous ceux vivant dans la même zone, il faudra les sensibiliser sur l'impact d'une telle formation de base et sur un système de mesures d'accompagnement afin de pouvoir augmenter les possibilités d'une implantation du PPA et de pouvoir satisfaire les exigences de la PO 4.10.
La capacité des peuples autochtones à se représenter eux-mêmes dans la CoCoCongo, CoCoSi et dans les nouvelles structures de concertation entre toutes les parties prenantes et prévues par le Projet GEF-BM, doit être qualifiée comme pratiquement inexistante. Les raisons de cette non-représentation concrétisent le paradoxe de la situation des peuples autochtones. En effet, les motifs explicatifs de cette discrétion diffèrent non seulement selon les contextes (urbain/rural; ONG/institutions gouvernementales), mais ils résident à l’un et l’autre des pôles extrêmes de la conception identitaire qu’ils illustrent de ce fait.
Dans la ville de Kinshasa, quatre organisations sont opérationnelles dont l’une constituant la Ligue Nationale pour les Pygmées du Congo (LINAPYCO), l'Association Nationale du Premier Peuple Autochtone Natif et la Minorité Nationale Pygmées en RDC – Plate-forme Nationale des Batwa (ANPANMNP/PFNB), le Centre International des Droits des peuples de la foret Batwa (CIDB) et l’Union pour le Développement des Minorités Ekonda (UDME). Le problème majeur auquel sont confrontées ces organisations semble être l’absence des financements permettant de rentabiliser et de pérenniser les acquits et de faire en sorte que ces peuples autochtones puissent sortir et se relever de leurs situations socio-économiques déplorables.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 35
Autour le PNVi, il y a plusieurs ONG qui collaborent avec les peuples autochtones:
Le «Programme d’intégration et de Développement des Peuples Pygmées» (PIDP) constitue la première et l’unique organisation initiée par les peuples autochtones par laquelle les populations Twa cherchent à améliorer leurs conditions de vie et à oeuvrer en faveur de leur effective ou meilleure intégration dans le processus du développement endogène. Le PIDP s’est fixé les objectifs suivants: a) Défendre les droits des peuples autochtones à tout niveau et protéger leurs biens et intérêts; b) Intégrer les peuples autochtones installés en RDC dans le processus de développement socio-économique. Pour atteindre ces objectifs, le PIDP a sélectionné comme domaines d'intervention la promotion des droits humains et ceux des peuples autochtones plus particulièrement, l’Education (alphabétisation, scolarisation etc.), l’agriculture, l’élevage, l’amélioration de l’habitat, l’hygiène et la santé, la promotion de l’artisanat, la valorisation de la culture et la protection de l’environnement.
Le «Réseau des Associations Autochtones Pygmées» (RAPY) regroupe actuellement 6 associations autochtones légalement constituées et enregistrées, exerçant leurs activités dans le Sud Kivu. Il s’agit: de «l’Union pour l’Emancipation de la Femme Autochtone» (UEFA); du «Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables» (CAMV); de «l’Action d’Appui pour la Protection des Droits des Minorités en Afrique Centrale» (AAPDMAC); de la «Solidarité pour les Initiatives des Peuples Autochtones» (SIPA); de «l’Action pour le Regroupement et l’Auto promotion des Pygmées» (ARAP) et du «Collectif pour le Peuple Autochtone du Kivu» (CPAKI).
Le «Programme d’Appui aux Pygmées» (PAP-RDC) a été mis en place par un groupe d’initiateurs suite à la situation déplorable des populations Mbuti, à leur isolement et leur mode de vie socio-économique inadapté par rapport à la vie moderne. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: a) Identifier les enfants scolarisables et conscientiser leurs parents en faveur d'une scolarisation; chercher à identifier les problèmes d’éducation; réhabiliter les infrastructures scolaires; assister les élèves en fournitures scolaires, uniformes et frais de scolarité; promouvoir l’alphabétisation des adultes dans les villages des peuples autochtones; b) Identifier les problèmes de santé; chercher des solutions à ces problèmes de concert avec la population cible; faciliter l’accessibilité aux soins de santé primaire; aménager les sources; sensibiliser la population du rayon d’action sur le danger que représente les MST/SIDA; promouvoir l’hygiène et l’assainissement de l’habitat; c) Inventorier les problèmes agricoles et les potentialités locales en vue de les résoudre; mettre sur pied un plan d’action en collaboration avec les peuples autochtones; rendre disponibles les semences et les outils agricoles; accompagner les peuples autochtones en passe d'intégrer l’agriculture dans leurs activités quotidiennes; former les populations Mbuti dans les techniques agricoles; d) défense des droits des peuples autochtones; protéger leurs intérêts, organiser une assistance judiciaire gratuite au profit des peuples autochtones; éducation relative à leurs droits et devoirs; promotion de l’artisanat: coupe-couture, tissage, vannerie, poterie. Le PAP-RDC, à travers ses réalisations, a pu marquer plusieurs personnes parmi la population Mbuti et leur milieu. Des semences, des outils agricoles, des vêtements ont été distribués, des centres de santé appuyés au profit de la prise en charge des peuples autochtones, des actions de lobbying menées en leur faveur et leurs enfants scolarisés. PAP-RDC oeuvre dans le territoire de Beni dans la province du Nord Kivu et dans les territoires de Mambassa et de Irumu dans la province Orientale.
Le «Centre d’Encadrement et de Développement des Pygmées au Congo» (CENDEPYC) a vu le jour en 1970, mais sa reconnaissance juridique remonte jusqu'en 1993. Cette ONG initie les peuples autochtones aux travaux sociaux comme le sont: l’agriculture, la scolarisation des enfants, l'élevage, les soins par les plantes médicinales, la promotion de la culture des Twa et Mbuti, la construction des maisons et des latrines. Elle fonctionne sur la base des recettes générées par la vente des médicaments à base des plantes. Depuis sa création, l’ONG a construit une école primaire à Masulukwede, elle a acquis un champ de 20 hectares, elle dispose de 2 centres de médecine traditionnelle et elle a distribué des houes et machettes ainsi que des semences aux peuples autochtones. Faute des fonds suffisants, le Centre a créé une branche, Médecine Naturelle des Pygmées au Congo (MENAPYC), activité principale menée dans les centres-villes de Butembo et de Beni.
La «Santé et l'Education pour l’Intégration des Populations Inaccessibles» (SEIPI) a vu le jour en 1994. L’objectif de cette association consiste à encadrer les populations vulnérables (personnes en situation difficile: peuples autochtones, enfants défavorisés, populations en déplacement, populations déshéritée) par des soins médicaux, la scolarisation et des activités sociales. La SEIPI dont le siège social se trouve à Butembo. Sa stratégie est de regrouper des peuples autochtones dans des villages sélectionnés pour des expériences en sédentarisation, la sensibilisation à l’auto-prise en charge, des échanges ainsi que des soins curatifs. Les résultats sont les suivants: regroupement de 168 familles dans 5 villages d’expérimentation en sédentarisation, à la scolarisation de 500 enfants dans les complexes de SEIPI. Ces actions n’ont pas abouti à des résultats escomptés. C'est à cause des moyens logistiques insuffisants, des

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 36
guerres et de l'insécurité, mais aussi et surtout à cause de la vie semi-nomade des peuples autochtones que les villages d’expérimentation sélectionnés pour la sédentarisation ont été abandonnés.
L'objectif d'une bonne partie des PPA est de renforcer les compétences des associations des peuples autochtones et des ONG permettant les peuples autochtones à long terme de représenter et de défendre eux-mêmes leurs droits, leur culture et leurs zones d'usage. La tâche de la mission de contrôle à cet égard sera d'accompagner les ONG lors de la cession des fonctions de direction vers les peuples autochtones, de leur intégration dans le processus de la prise de décision, et aussi de superviser l'efficacité d’amélioration des compétences et de la renforcer à travers un accompagnement technique des structures de réalisation.
Au niveau national, l'ICCN travaillera en collaboration avec les organisations et identifiera à travers elles les associations des peuples autochtones ainsi que les ONG à l'intérieur des zones désignées à l'identification de nouvelles aires protégées. Les associations des peuples autochtones et/ou les ONG seront, à l'intérieur de ces zones, les partenaires de l'ICCN pendant la mise en œuvre des PPA.

Calendrier de la mise en œuvre, les coûts et du plan de financement du PPA-Projet GEF-BM en RDC Plan des peuples autochtones: questions et actions clés
Objective Activité Responsabilité Délai Coût Indicateurs Etablir des opportunités légales égales
1. Mise en place des compétences nécessaires pour la mise en œuvre d’un PPA en accord avec la PO 4.10 (PGS 1.1.)
Sensibilisation et formation du personnel de l’ICCN concerné et des ONG soutenant des PA (ONG PPA) dans l'acquisition des techniques de communication interculturelle, des standards internationaux de coopération avec les peuples autochtones (PO 4.10 etc.) et avec les leçons tirées des expériences faites dans d'autres pays lors de la mise en œuvre des PPA sur la base des éléments inscrits dans le manuel d’exécution des PPA (Draft IPP Handbook).
Mission de contrôle 7/2007 30,000 • Les bénéficiaires de cette formation sont capables de mettre en oeuvre le PPA
2. Reconnaître et protéger les campements et zones d’usage des peuples autochtones à l'intérieur des aires protégées existantes et proposées ainsi que leurs zones tampons (PGS 2.1.1 & 2.2.4)
2.1. Sensibilisation de toutes les parties prenantes 2.2. Etat des lieux autour du PNVi (Recensement et documentation des
zones d’usage à travers une cartographie participative) • Pour le PNVi • Pour les zones destinées aux nouvelles aires protégées • Superviser l’élaboration
2.3. Certifier des villages PA comme localité • Organiser des réunions dans tous les campements habités par des
PA autour du PNVi et élaborer dans un processus participatif une demande de regroupement de tous les campements dans un nombre de localités habitées par des PA
• Processus de certification autour du PNVi
• Etablir le même processus dans les zones désignées aux nouvelles aires protégées
2.4. Protéger les droits d’usage des PA à l'intérieur des aires protégées
• Légaliser l'utilisation des ressources naturelles par des peuples autochtones à l'intérieur des aires protégées à travers la nouvelle loi de conservation
• Mise en œuvre des règlements dans le PNVi
2.5. Protéger les droits d’usage des PA à l'intérieur des zones tampons • Etablir des plans de gestion en accord avec le manuel relatif aux
«concessions des communautés locales» et au code forestier • Superviser leur élaboration • Certifier des concessions des communautés locales aux
localités habitées par des PA autour du PNVi • Certifier des concessions des communautés locales aux
localités habitées par des PA à l'intérieur des zones destinées aux nouvelles aires protégées
ONG-PPA
ONG-PPA ONG-PPA
Mission de contrôle
ONG-PPA
Administrateurs de territoire
ONG-PPA & AT
ICCN
ICCN
ONG-PPA
MECNEF MECNEF
MECNEF
7/2007
8/2007 Avant la
démarcation
10/2007
12/2007
Avant la démarcation
12/2007
2/2008
3/2008 pour le PNVi 3/2008 6/2008
Avant la
démarcation
20,000
50,000 100,000
20,000
10,000
5.000
20,000
Comp.1
Comp.2
Comp.2 Comp.2 Comp.2
Comp.2
• Toutes les communautés PA disposent d'un titre qualifiant leur village comme localité et comme constituant un territoire légal
• Les associations des PA ne
reçoivent plus aucune réclamation de la part des PA à propos des confiscations, déplacements, etc.
• • 95% des localités habitées par
des PA autour du PNVi et des nouvelles aires protégées, disposent d'une concession des communautés locales. Ces forêts donnent aux PA l'accès à 1km² au minimum par personne.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 38
Plan des peuples autochtones: questions et actions clés Objective Activité Responsabilité Délai Coût Indicateurs
Etablir des opportunités techniques égales 3. Donner aux peuples autochtones
les capacités techniques leur permettant de participer activement à la gestion des aires protégées et au processus d’identification des nouvelles aires protégées (PGS 1.5.)
• Etablir des modules de formation • Etablir un programme de formation • Réaliser les formations • Supervision et accompagnement technique
ICCN & ONG PPA ICCN & ONG PPA
ONG PPA ICCN & Mission de
contrôle
9/2007 10/2007
A partir de 1/08
A partir de 1/08
10,000 10,000 80,000 10,000
• Les modules de formation sont en accord avec les meilleures expériences
• Les PA sont considérés comme des personnes qualifiées jouant un rôle de plus en plus important et actif dans la gestion durable
4. Développer les capacités techniques du personnel de l’ICCN et de ses partenaires au profit de la création d'une meilleure coopération avec les peuples autochtones (PGS 1.4).
• Formation du personnel concerné • Réaliser des activités de sensibilisation à l'attention de tous les cadres
de l'ICCN et de ses partenaires
ICCN ICCN & ONG PPA
9/2007 12/2007
Comp.1 Comp.1
• Les plaintes portées, justifiées et soumises par les PA relatives aux activités de l'ICCN se réduisent.
5. Sensibiliser les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka sur les risques du processus de développement (PGS 3.2.3)
5.1. Sensibilisation des PA 5.2. Assister les associations des PA dans leur renforcement des
compétences afin de pouvoir mieux préserver les connaissances, cultures et modes de vie traditionnelle • Offrir une formation appropriée pour accroître les capacités
organisationnelles, techniques et financières des Associations des PA • Réaliser des campagnes de sensibilisation dans les localités
habitées par des PA 5.3. Encourager la création des forums de communication et l’échange
entre les peuples autochtones et leurs voisins et assurer également que ce processus se déroule sur la base d’une bonne compréhension mutuelle • Sensibilisation des PA et des autres personnes dans la région • Faciliter la création des plateformes • Faciliter les discussions et visites d’échanges
Voir 2.2
Mission de contrôle
ONG PPA
ONG PPA ONG PPA ONG PPA
Voir 2.2
9/2007
Voir 2.2.
9/2007 12/2007
Début 1/08
Voir 2.2
20,000
Voir 2.2.
20,000 20,000 20,000
• Les associations des PA sont considérées comme étant des représentants des populations PA et elles deviennent de plus en plus actives à différents niveaux
• Le PIM ainsi que les autres
rapports témoignent d'une coopération améliorée entre les PA et leurs voisins dans leurs actions communes en faveur d'une réduction de la pauvreté et de la consolidation d'une société multiculturelle
Etablir des opportunités financières égales 6. Assurer que les villages habités
par des PA reçoivent leur tranche des revenus générés par les PNVi et des nouvelles aires protégées (PGS 4.1)
• Elaborer une proposition • Discuter la proposition avec toutes les parties prenantes • Mise en œuvre du nouveau règlement concernant le PNVi • Pour les zones destinées pour les nouvelles aires protégées
ICCN & ONG PPA ICCN & ONG PPA
ICCN ICCN
3/2007 6/2007 9/2007 Avant la
démarcation
Comp.1 Comp.1 Comp.2 Comp.3
• A partir de 12/08, il n’y aura plus des réclamations documentées et justifiées de la part des PA
7. Offrir des programmes spéciaux destinés aux peuples autochtones pour les faire bénéficier de l'ouverture des postes et d'emplois dans le cadre du Projet GEF-BM (garde de parc, pisteur, etc.) (PGS 4.2.4)
• Réaliser des analyses et prospections sur les opportunités d’emploi et des capacités des PA
• Elaborer des ordres administratifs pour le PNVi • Elaborer des ordres pour l’identification des nouvelles aires protégées • Etablir une structure chargée de l’appui des PA lors du processus de
l’application
ICCN & ONG PPA
ICCN ICCN
ONG PPA
9/2007
12/2007 12/2007
10/2007
10,000
Comp.2 Comp.3
10,000
• Le niveau de vie dans les campements des PA autour du PNVi a été amélioré à travers des opportunités offertes par l’ICCN

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 39
Plan des peuples autochtones: questions et actions clés Objective Activité Responsabilité Délai Coût Indicateurs
Etablir des opportunités organisationnelles égales 8. Faciliter la représentation des
peuples autochtones dans les instances de prise de décision concernant la conservation de la nature et la gestion des aires protégées et ses zones tampons au long du processus auprès des comites au sein du Projet GEF-BM.
(PGS 3)
8.1. Sensibilisation des PA 8.2. Faciliter l’élection des représentants afin de pouvoir mieux
coordonner, communiquer et soutenir les activités du PPA 8.3. Faciliter l’établissement des comités au niveau des sites (PNVi) et 8.4. Soutien aux organisations des peuples autochtones au niveau
national 8.5. Assurer des places pour les PA au niveau de chaque comité (y
compris les coûts de transport/per diem etc.)
Voir 2.2 Voir 2.2
ONG PPA
Mission de contrôle
ICCN
Voir 2.2 Voir 2.2
12/2007
12/2007
12/2007
Voir 2.2 Voir 2.2
20,000
20,000
C .1,2&3
• Les représentants sont considérés comme des personnes qualifiées et reconnues comme des portes paroles élues
• Les représentants des PA jouent un rôle de plus en plus important et actif de façon à pouvoir être mieux satisfaits du Projet.
9. Etablir un système de suivi et d’évaluation participative à l'attention des PA et du Projet GEF-BM (PGS 1.2)
• Sensibilisation des PA • Formation des ONG soutenant des peuples autochtones (ONG-PPA)
en méthodologie, recherche quantitative ainsi qu’en la gestion des bases de données
• Réaliser des PIM7 du PPA et du Projet GEF-BM • Réaliser une évaluation externe du Projet GEF-BM
Voir 2.2 Mission de contrôle
ONG PPA Mission de contrôle
Voir 2.2 12/2007
Début 1/09 Début 1/09
Voir 2.2 20,000
40,0008 20,0009
• Les rapports PIM sont utilisés pour la calibration des activités du Projet GEF-BM
7 PIM (Participatory Impact Monitoring) = Suivi participatif des impacts sociaux. 8 Les coûts du PIM sont estimés à US$ 10,000 pa et sont estimés être nécessaires pendant au moins 4 ans. 9 Les coûts sont estimés sur l’hypothèse qu’une seule évaluation coûtera aux alentours de 10,000 et qu’il y aura des évaluations en 2009, 2011.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 40
De manière globale, on peut croire que les 9 activités du PPA seront suffisantes pour garantir la réalisation du Projet GEF-BM en accord avec la PO 4.10, et que le Projet: • renforcera les systèmes traditionnels de gouvernance, de gestion, et de l’utilisation des ressources
naturelles et promouvra le respect du dialogue communautaire ainsi que des droits coutumiers de tous les citoyens de la RDC;
• contribuera à réduire la pauvreté des populations dans toutes les zones rurales de la RDC de même que la dégradation des ressources naturelles et qu'il encouragera un développement durable;
• installera un système efficace de gestion des aires protégées accompagné par des impacts positifs au profit de la biodiversité et de la population entière, mais plus particulièrement encore des peuples les plus pauvres, marginalisés et alors vulnérables que sont les peuples autochtones;
• respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka;
• s’assurera que les peuples autochtones dans la zone d’intervention du Projet GEF-BM reçoivent les bénéfices culturellement adaptés et équivalent à celui des autres groupes ;
• assistera les peuples autochtones à régulariser leur situation légale et à améliorer celle de leur vie.
77.. RReessppoonnssaabbiilliittééss ddee llaa mmiissee eenn œœuuvvrree Les acteurs principaux du PPA sont a) l'ICCN avec ses partenaires de la conservation, b) les ONG soutenant les peuples autochtones et les associations des peuples autochtones ainsi que c) les populations Twa, Mbuti, Aka et Cwa elles-mêmes. La mise en œuvre du plan des peuples autochtones par un réseau des ONG soutenant les peuples autochtones autour du PNVi et dans les zone de prospection pour les nouvelles aires protégées (ONG PPA; voir projet de TdR en annexe) et sur la supervision, accompagnement et le suivi mise en place par un mission de contrôle (voir un Projet de TdR en annexe) devront être coordonnés par l’ICCN.
88.. SSuuiivvii eett éévvaalluuaattiioonn La mise en oeuvre du system de suivi d’impact participatif sera un autre élément important destiné à soutenir les diverses structures de la mise en œuvre des activités du PPA et du Projet GEF-BM. A partir de 2008, les informations collectées par les différents comités devront être analysées, synthétisées et ensuite rendues disponibles annuellement à toutes les parties prenantes ainsi qu'au public intéressé. Ces rapports seront mis au service de l’entité de supervision internationale qui les retiendra comme source lors de son évaluation biannuelle du processus du PPA.
La participation des populations Twa, Mbuti, Cwa et des Aka dans la gestion du Project GEF-BM et au partage des bénéfices devra être évaluée en vérifiant les indicateurs susmentionnés dans le PPA et en fonction des éléments clefs suivants:
Amélioration des compétences: Des rapports et d'autres informations relatives à la sensibilisation et la formation dans le contexte du PPA devront être esquissés en vue d'évaluer: a) la fréquence de participation, etc.; b) les observations et expériences positives faites par les participants à propos des résultats du programme de l'amélioration des compétences.
Le partage des bénéfices: Les documents, les rapports etc. concernant la distribution des revenus générés par les aires protégées devront être esquissés afin de documenter a) l'intégration des peuples autochtones dans le processus de prise de décision; b) la distribution des bénéfices prévue par les plans d'aménagement; c) la satisfaction globale des différents participants avec les processus et les résultats; d) comment les résultats du projet (bénéfices, etc.) sont utilisés en fonction des objectifs portant sur la réduction de la pauvreté.
La prise de décision: Le processus de prise des décisions devra être évalué afin de décrire: a) le rôle et les responsabilités des peuples autochtones au niveau des différents processus; b) la perception par les différents désintéressés du processus et de la performance des différents acteurs. L'attention particulière devra consister à examiner si les stratégies sont élaborées de manière participative et mise en oeuvre de façon à pouvoir contribuer à une réduction des problèmes et obstacles identifiés.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 41
AAnnnneexxee 11:: PPoolliittiiqquuee ooppéérraattiioonnnneellllee ««ppeeuupplleess aauuttoocchhttoonneess»» ((PPOO 44..1100)) ddee llaa BBaannqquuee MMoonnddiiaallee Le présent document est la traduction du texte anglais de la OP 4.10, Indigenous Peoples, en date de juillet 2005, qui contient la formulation de cette directive approuvée par la Banque mondiale. En cas de divergence entre le présent document et la version anglaise de la OP 4.10, en date de juillet 2005, c’est le texte anglais qui prévaudra. Note : Les PO/PB 4.10 remplacent la directive opérationnelle 4.20, Peuples autochtones. Elles s’appliquent à tous les projets dont l’examen du descriptif est intervenu le 1er juillet 2005 ou après cette date. Pour toute question, s’adresser au Directeur du Département développement social (SDV).
1. La présente politique (1) contribue à la mission de réduction de la pauvreté et de promotion d’un développement durable poursuivie par la Banque (2) tout en garantissant un processus de développement respectant pleinement la dignité, les droits de la personne, les systèmes économiques et les cultures des Populations autochtones. Chaque fois que la Banque est sollicitée pour financer un projet affectant directement des populations autochtones (3), elle exige de l’emprunteur qu’il s’engage à procéder, au préalable, à une consultation libre et fondée sur une communication des informations aux populations concernées (4). Le financement de la Banque ne sera accordé que, si lors de la consultation libre et fondée sur la communication des informations nécessaires à se faire une opinion, le projet obtient un soutien massif dans la communauté respective de la part des populations autochtones (5). De tels projets financés par la Banque prévoient des mesures destinées: a) à éviter des répercussions négatives potentielles sur les communautés des populations autochtones; ou b) si cela n’est pas possible, à atténuer, minimiser ou compenser ces répercussions. Les projets financés par la Banque sont aussi conçus de manière à assurer que les populations autochtones en retirent des avantages socio-économiques culturellement adaptés et au profit de la population féminine autant que de la population masculine et de toutes les générations.
2. La Banque reconnaît que l’identité et la culture des populations autochtones sont indissociables des territoires sur lesquels elles vivent et des ressources naturelles dont elles dépendent. Cette situation particulière expose ces populations à différents types de risques et de répercussions plus ou moins marquées du fait des projets de développement, notamment la perte de leur identité, de leurs spécificités culturelles et de leurs moyens d’existence traditionnels, aussi bien qu’à une exposition à diverses maladies. Les problèmes de genre et inter générations sont également plus complexes au sein des populations autochtones. En tant que groupes sociaux dont les caractéristiques identitaires diffèrent souvent de celles des groupes dominants de la société nationale, les communautés autochtones appartiennent souvent aux segments les plus marginalisés et vulnérables de la population. Il en résulte souvent que leurs statuts économique, social et juridique limitent leurs capacités à défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits sur les terres, territoires et autres ressources productives, ou leur aptitude à participer au développement et à en recueillir les fruits. Mais la Banque n’ignore pas que les populations autochtones jouent un rôle crucial dans le développement durable et que leurs droits sont alors de plus en plus pris en compte dans la législation nationale et internationale.
3. Identification. Étant donné la variété et la mouvance des cadres de vie des populations autochtones ainsi que l’absence de définition universellement acceptée du terme «populations autochtones», la présente politique ne cherche pas à définir ce terme. Les populations autochtones sont désignées en fonction de leurs différents pays sous différents vocables tels que «minorités ethniques autochtones», «aborigènes», «tribus des montagnes», «minorités nationales», «tribus ayant droit à certains privilèges» ou «groupes tribaux».
4. Aux fins d’application de la présente politique, l’expression «populations autochtones» est employée au sens générique du terme pour désigner un groupe socioculturel vulnérable distinct présentant, à divers degrés, les caractéristiques suivantes: a) les membres du groupe s’identifient comme appartenant à un groupe culturel autochtone distinct, et cette identité est reconnue par d’autres; b) les membres du groupe sont collectivement attachés à des habitats ou à des territoires ancestraux géographiquement délimités et situés dans la zone du projet, ainsi qu’aux ressources naturelles de ces habitats et territoires (7); c) les institutions culturelles, économiques, sociales ou politiques traditionnelles du groupe sont différentes par rapport à celles de la société et de la culture dominantes; et d) les membres du groupe parlent un langage souvent différent de la langue officielle du pays ou de la région. La présente politique est tout aussi applicable à des groupes ayant perdu «leur ancrage collectif dans des habitats géographiquement circonscrits ou des territoires ancestraux situés dans la zone du projet» (paragraphe 4 (b)) pour cause de départ forcé (8). La décision de considérer un groupe particulier comme une population autochtone à laquelle la présente politique s’appliquerait peut nécessiter de recourir à un avis technique (voir paragraphe 8).

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 42
5. Utilisation des systèmes nationaux. La Banque peut décider d’utiliser un système national pour traiter des problèmes de sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre d’un projet financé par la Banque et affectant des populations autochtones. La décision d’utiliser le système national est prise en conformité avec les exigences de la politique de la Banque en matière de systèmes nationaux (9).
Préparation du projet 6. Un projet proposé au financement de la Banque ayant un impact sur des populations autochtones nécessite que: a) la Banque procède à un examen préalable aux fins d’identifier l’éventuelle présence de populations
autochtones vivant dans la zone couverte par le projet ou ayant des attaches collectives à cette zone (voir paragraphe 8);
b) l’emprunteur réalise une évaluation sociale (voir paragraphe 9 et Annexe A); c) l’emprunteur organise, préalablement à chaque nouvelle étape du projet, une consultation des
communautés de population autochtone affectées, libre et fondée sur la communication des informations requises, et notamment au stade de la préparation du projet, afin de prendre pleinement connaissance de leurs points de vues et de s’assurer qu’elles adhèrent massivement au projet (voir paragraphes 10 et 11);
d) l’emprunteur prépare un Plan en faveur des populations autochtones (voir paragraphe 12 et Annexe B) ou un Cadre de planification en faveur des populations autochtones (voir paragraphe 13 et Annexe C); et
e) l’emprunteur diffuse ce plan ou ce cadre (voir paragraphe 15).
7. Le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 6 b), c) et d) est proportionnel à la complexité du projet envisagé et fonction de la nature et de la portée des répercussions potentielles du projet sur les populations autochtones, que ces répercussions soient positives ou négatives.
Examen préalable 8. Aux tout premiers stades de la préparation du projet, la Banque procède à un examen préalable pour déterminer si des populations autochtones (voir paragraphe 4) vivent dans la zone du projet ou y ont des attaches collectives (10). Dans le cadre de cet examen préalable, la Banque sollicite l’avis technique des experts en sciences sociales dotés d’une bonne connaissance des groupes sociaux et culturels présents dans la zone du projet. Elle consulte également les populations autochtones concernées et l’emprunteur. La Banque peut procéder à cet examen préalable en suivant le cadre défini par l’emprunteur pour identifier les populations autochtones, pour autant que ce cadre est conforme à la présente politique.
Évaluation sociale 9. Analyse. Si, sur la base de l’examen préalable, la Banque conclut que des populations autochtones vivent dans la zone du projet ou y ont des attaches collectives, l’emprunteur entreprend une évaluation sociale pour juger des répercussions positives et négatives du projet sur les populations autochtones et analyse les alternatives au projet susceptibles d’avoir des répercussions importantes. Le type, la portée et le niveau de détail de l’analyse conduite dans le cadre de cette évaluation sociale seront fonction de la nature et de l’ampleur des répercussions positives ou négatives du projet proposé sur les populations autochtones (pour plus de détails, voir l’Annexe A). Pour réaliser cette évaluation sociale, l’emprunteur engage des experts en sciences sociales dont les compétences, l’expérience et les termes de référence sont jugés acceptables par la Banque.
10. Consultation et participation. Lorsque le projet a un impact sur les populations autochtones, l’emprunteur engage au préalable un processus de consultation de ces populations, libre et fondée sur la communication des informations requises. Pour ce faire, l’emprunteur: a) établit un cadre approprié intégrant les aspects genre et inter générations qui fournit à l’emprunteur,
aux communautés de populations autochtones affectées, aux organisations de populations autochtones (OPA), s’il en est, et à d’autres organisations de la société civile locale identifiées par les communautés autochtones concernées l’occasion de se concerter à chaque étape de la préparation et de l’exécution du projet;
b) recourt à des méthodes (11) de consultation adaptées aux valeurs sociales et culturelles des communautés autochtones affectées ainsi qu’aux réalités locales et porte une attention particulière, lors de la conception de ces méthodes, aux préoccupations des femmes, des jeunes et des enfants et de leur accès aux opportunités de développement et aux bénéfices qu’elles procurent; et
c) fournit aux communautés autochtones affectées toutes les informations pertinentes relatives au projet (y compris une évaluation des répercussions négatives potentielles du projet sur lesdites populations) d’une manière culturellement adaptée, à chaque stade de la préparation et de l’exécution du projet.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 43
11. Au moment de décider s’il convient ou non de donner suite au projet, l’emprunteur s’assure, sur la base de l’évaluation sociale (voir paragraphe 9) et du processus de consultation préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises (voir paragraphe 10), que les communautés autochtones affectées soutiennent bien le projet. Si tel est le cas, l’emprunteur prépare un rapport détaillé indiquant: a) les conclusions de l’évaluation sociale; b) le processus de consultation préalable, libre et fondé sur la communication des informations
requises, des populations affectées; c) les mesures complémentaires, y compris les modifications à apporter à la conception du projet, qui
doivent être éventuellement prises pour prévenir les répercussions susceptibles de nuire aux populations autochtones et leur permettre de tirer du projet des avantages adaptés à leur culture;
d) les recommandations pour une consultation préalable, libre et fondée sur la communication des informations requises, et une participation des communautés des populations autochtones pendant la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation du projet; et
e) tout accord officiellement conclu avec les communautés autochtones et/ou les (OPA). La Banque s’assure ensuite, par le truchement d’un examen du processus et des résultats de la consultation menée par l’emprunteur, que les communautés des populations autochtones soutiennent massivement le projet. Pour ce faire, elle s’appuie tout particulièrement sur l’évaluation sociale et sur le déroulement et les résultats du processus des consultations préalables, libres et fondées sur la communication des informations requises. La Banque ne soutiendra plus aucun projet avant de s'être assurée de l’existence d’un tel soutien.
Plan/Cadre de planification en faveur des populations autochtones 12. Plan en faveur des populations autochtones. Sur la base de l’évaluation sociale et en concertation avec les communautés autochtones affectées, l’emprunteur prépare un plan en faveur des populations autochtones (PPA) décrivant les mesures à mettre en place pour faire en sorte que: a) les populations autochtones affectées tirent du projet des avantages sociaux et économiques culturellement adaptés; et b) les répercussions négatives potentielles du projet sur les populations autochtones soient évitées, minimisées, atténuées ou compensées lorsque ces répercussions sont identifiées, (pour plus de détails, voir l’Annexe B). Souplesse et pragmatisme guident la préparation de ce plan (12) dont le niveau de détail varie en fonction du projet considéré et de la nature des impacts à traiter. L’emprunteur intègre ce plan à la conception du projet. Lorsque les populations autochtones sont les seules ou de loin les plus nombreuses à bénéficier directement du projet, les éléments du plan doivent être inclus dans la conception globale du projet, sans qu’il soit nécessaire d’établir un plan distinct. Dans ce cas, le document d’évaluation du projet (DEP) contient un bref résumé des éléments qui garantissent la conformité du projet à la présente politique, en particulier aux conditions régissant l’élaboration du PPA.
13. Cadre de planification en faveur des populations autochtones. Certains projets nécessitent la préparation et la mise en oeuvre de programmes d’investissement annuels ou de plusieurs sous projets (13). Le cas échéant, et s’il ressort de l’examen préalable effectué par la Banque une probabilité que des populations autochtones vivent dans la zone du projet ou y ont des attaches collectives, mais que cette probabilité ne peut être confirmée tant que les programmes ou les sous projets n’ont pas été identifiés, l’emprunteur prépare un cadre de planification en faveur des populations autochtones (CPPA). Ce CPPA stipule que ces programmes ou sous projets doivent faire l’objet d’un examen préalable conformément à la présente politique (pour plus détails, voir l’Annexe C). L’emprunteur intègre le CPPA à la conception du projet.
14. La préparation des PPA de programmes et de sous projets. Si l’examen préalable d’un programme particulier ou d’un sous projet identifié dans le CPPA indique que des populations autochtones vivent dans la zone couverte par le programme ou le sous projet ou y ont des attaches collectives, l’emprunteur s’assure, avant que ledit programme ou sous projet soit mis en oeuvre, qu’une évaluation sociale soit réalisée et qu’un PPA élaboré conformément aux dispositions de la présente politique. L’emprunteur communique chaque PPA à la Banque pour examen avant que le programme ou les sous projet en question ne soit considéré comme éligible à un financement de la Banque (14).
Diffusion de l’information 15. L’emprunteur met le rapport d’évaluation sociale et la version provisoire du PPA/CPPA à la disposition des communautés autochtones sous une forme, d’une manière et dans une langue qu’elles peuvent comprendre (15). Avant l’évaluation du projet, l’emprunteur soumet l’évaluation sociale et la version définitive du PPA/CPPA à la Banque pour examen (16). Une fois que la Banque a confirmé que ces documents constituent une base suffisante pour évaluer le projet, elle les rend publics conformément à sa Politique de diffusion de l’information, et l’emprunteur les met à la disposition des communautés autochtones concernées comme il l’a fait pour la version provisoire desdits documents.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 44
Considérations particulières
La terre et les ressources naturelles qu’elle recèle 16. Les populations autochtones entretiennent des liens étroits avec les terres, les forêts, l’eau, la faune, la flore et les autres ressources de leur milieu naturel, aussi certaines considérations particulières entrent en ligne de compte lorsqu’un projet a un impact sur ces liens. Dans ce cas, lorsqu’il réalise l’évaluation sociale et prépare le PPA/CPPA, l’emprunteur accorde une attention toute particulière: a) aux droits coutumiers (17) dont jouissent les populations autochtones, à titre individuel et collectif,
sur les terres ou les territoires qui sont la propriété traditionnelle du groupe ou dont l’utilisation ou l’occupation par ledit groupe sont consacrées par la coutume et qui conditionnent l’accès du groupe à des ressources naturelles indispensables au maintien de sa culture et à sa survie;
b) à la nécessité de protéger lesdites terres et ressources contre toute intrusion ou empiètement illégal; c) aux valeurs culturelles et spirituelles que les populations autochtones attribuent auxdites terres et
ressources; et d) à leurs pratiques de gestion des ressources naturelles et à la viabilité à long terme desdites pratiques.
17. Si le projet prévoit: a) des activités dont la réalisation est subordonnée à l’établissement de droits fonciers, légalement reconnus, sur les terres et territoires qui sont la propriété traditionnelle du groupe ou dont l’utilisation ou l’occupation par ledit groupe est consacrée par la coutume (comme des projets de délivrance de titres fonciers); ou b) l’achat desdites terres, le PPA présente un plan d’action en vue d’obtenir que ladite propriété, occupation ou utilisation soit légalement reconnue. Normalement, ce plan d’action est mis en oeuvre avant l’exécution du projet, mais il doit parfois être exécuté en même temps que le projet proprement dit. Cette reconnaissance légale peut prendre diverses formes: a) reconnaissance juridique pleine et entière des systèmes fonciers coutumiers existants des populations autochtones ou b) conversion des droits d’usage coutumiers en droits de propriété communautaires et/ou individuels. Si la législation nationale n’autorise aucune de ces deux options, le PPA prévoit des mesures visant à obtenir la reconnaissance juridique des droits de possession, ou bien d’usage à perpétuité ou à long terme renouvelables.
Mise en valeur des ressources naturelles et culturelles à des fines commerciales 18. Dans le cas d’un projet de mise en valeur des ressources naturelles (minerais, hydrocarbures, forêts, ressources en eau, terrains de chasse ou zones de pêche) à des fins commerciales sur des terres ou territoires qui sont la propriété traditionnelle du groupe ou dont l’utilisation ou l’occupation par ledit groupe est consacrée par la coutume, l’emprunteur s’assure que les communautés affectées soient informées, dans le cadre d’un processus de consultation préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises, a) des droits qui leur sont conférés sur lesdites ressources par le droit écrit et le droit coutumier; b) de la portée et de la nature de l’exploitation commerciale envisagée et des parties intéressées par ladite exploitation ou associées à celle-ci; et c) des répercussions que pourrait avoir ladite mise en valeur sur les conditions de vie des populations autochtones, leur environnement et leur utilisation de ces ressources. L’emprunteur prévoit dans le PPA des dispositions permettant aux populations autochtones de tirer une part équitable des avantages dudit projet (18); ces dispositions doivent, au minimum, assurer que les populations autochtones bénéficient, d’une manière culturellement adaptée, d’avantages de compensations et de droits à des voies de recours légaux au moins équivalents à ceux auxquels tout propriétaire détenteur d’un titre foncier légalement reconnu aurait droit si ses terres faisaient l’objet d’une mise en valeur à des fins commerciales.
19. Dans le cas d’un projet de mise en valeur des ressources culturelles et des connaissances (pharmacologiques ou artistiques, par exemple) des populations autochtones à des fins commerciales, l’emprunteur s’assure que les communautés affectées soient informées, dans le cadre d’un processus de consultation préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises, a) des droits qui leur sont conférés sur lesdites ressources par le droit écrit et le droit coutumier; b) de la portée et de la nature de la mise en valeur envisagée, ainsi que des parties intéressées par ladite mise en valeur ou associées; et c) des répercussions que pourrait avoir ladite mise en valeur sur les conditions de vie des populations autochtones, leur environnement et leur utilisation de ces ressources. L’exploitation a des fines commerciales des ressources culturelles et des connaissances des populations autochtones est subordonnée à leur accord préalable de cette mise en valeur. Le PPA doit refléter la nature et le contenu de cet accord et comporter des dispositions permettant aux populations autochtones de bénéficier de l’opération d’une manière culturellement adaptée et de tirer une part équitable des avantages procurés par le projet de mise en valeur à des fins commerciales.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 45
Réinstallation physique des populations autochtones 20. La réinstallation des populations autochtones posant des problèmes particulièrement complexes et pouvant être lourde de conséquences pour leur identité, leur culture et leurs modes de vie traditionnels, l’emprunteur devra envisager différents scénarios possibles pour éviter de déplacer les populations autochtones. Dans des circonstances exceptionnelles, si la réinstallation ne peut être évitée, l’emprunteur procèdera à cette réinstallation sous réserve que les communautés autochtones affectées se prononcent largement en faveur de cette solution dans le cadre d’un processus de consultation préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises. Dans ce cas, l’emprunteur préparera un plan de réinstallation conforme aux directives de la PO 4.12, Réinstallation involontaire compatible avec les préférences culturelles des populations autochtones et prévoit une stratégie de réinstallation fondée sur le foncier. Dans le cadre de ce plan de réinstallation, l’emprunteur fournira des informations sur les résultats du processus de consultation. Le plan de réinstallation devra permettre, dans la mesure du possible, aux populations autochtones affectées de retourner sur les terres et territoires qui sont la propriété traditionnelle du groupe ou dont l’utilisation ou l’occupation par ledit groupe sont consacrées par la coutume si les raisons ayant justifié leur déplacement venaient à disparaître.
21. Dans de nombreux pays, les terres officiellement réservées sous le label de parcs ou aires protégés risquent d’empiéter sur les terres et territoires qui sont la propriété traditionnelle de populations autochtones ou dont l’utilisation ou l’occupation par lesdites populations sont consacrées par la coutume. La Banque est consciente de l’importance de ces droits de propriété, d’occupation ou d’usage, ainsi que de la nécessité de gérer durablement les écosystèmes critiques. Il faut donc éviter d’imposer aux populations autochtones une restriction d’accès aux zones officiellement désignées comme parcs ou aires protégées, en particulier de leur accès aux sites sacrés. Dans des circonstances exceptionnelles, si de telles restrictions ne peuvent être évitées, l’emprunteur prépare, sur la base du processus de consultation des communautés autochtones affectées, préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises, un cadre fonctionnel assurant aux populations autochtones affectées une participation conforme aux dispositions de la PO 4.12. Ce cadre fonctionnel donne des directives pour préparer, durant l’exécution du projet, un plan de gestion des différents parcs et zones protégées. Ce cadre fonctionnel est par ailleurs conçu de manière à ce que les populations autochtones puissent participer à la conception, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation du plan de gestion, et recueillent une part équitable des avantages procurés par les parcs et les aires protégées. Le plan de gestion devra accorder la priorité à des dispositifs de collaboration permettant aux populations autochtones, en tant que gardiens des ressources, de continuer à les utiliser d’une manière écologiquement durable.
Populations autochtones et développement 22. Pour servir les objectifs de la présente politique, la Banque peut, à la demande d’un pays membre, aider ce dernier à planifier son développement et à formuler des stratégies de réduction de la pauvreté en appuyant financièrement diverses initiatives. Ces initiatives peuvent viser à: a) renforcer, en fonction des besoins existants, la législation nationale pour que les systèmes fonciers coutumiers ou traditionnels des populations autochtones soient officiellement reconnus; b) associer davantage les populations autochtones au processus de développement, en intégrant leurs points de vue dans la conception des programmes de développement et des stratégies de réduction de la pauvreté et en leur donnant la possibilité de tirer plus pleinement parti desdits programmes, grâce à la mise en place des réformes politiques et juridiques, au renforcement des capacités et à la conduite préalable d’un processus de consultation libre et fondé sur la communication des informations requises; c) appuyer les activités prioritaires de développement des populations autochtones dans le cadre de programmes (comme des programmes de développement de proximité ou des fonds sociaux administrés localement) mis au point par les pouvoirs publics en collaboration avec les communautés autochtones; d) s’attaquer aux problèmes de genre19 et inter générations qui se posent au sein des populations autochtones, notamment aux besoins spécifiques des femmes, des jeunes et des enfants autochtones; e) préparer des profils de participation des populations autochtones pour recueillir des informations sur leur culture, leur structure démographique, les relations entre les hommes et les femmes et entre les générations, leur organisation sociale, leurs institutions, leurs systèmes de production, leurs croyances religieuses et leurs modes d’utilisation des ressources; f) renforcer la capacité des communautés et des organisations des populations autochtones à mener à bien la préparation, l’exécution, le suivi et l’évaluation des programmes de développement; g) renforcer la capacité des organismes publics chargés de fournir des services de développement aux populations autochtones; h) protéger le savoir autochtone, notamment en renforçant les droits de propriété intellectuelle; et i) faciliter la mise en place des partenariats entre les pouvoirs publics, les OPA, les OSC et le secteur privé en faveur de la promotion des programmes de développement au profit des populations autochtones.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 46
Notes 1 Cette politique doit être mise en regard des autres politiques pertinentes de la Banque, notamment l’Évaluation
environnementale (OP 4.01), les Habitats naturels (OP 4.04), la Lutte antiparasitaire (OP 4.09), le Patrimoine culturel physique (OP 4.11, à paraître), la Réinstallation involontaire (OP 4.12), les Forêts (OP 4.36) et la Sécurité des barrages (OP 4.37).
2 Le terme «Banque» englobe la BIRD et l’IDA; le terme «prêts» recouvre les prêts de la BIRD, les crédits de l’IDA, les garanties de la BIRD et de l’IDA et les avances du Mécanisme de financement de la préparation des projets (PPF), mais non pas les prêts, crédits ou dons à l’appui de politiques de développement. En ce qui concerne les aspects sociaux des opérations líées à des politiques de développement, voir l’OP 8.60, Prêts à l’appui des politiques de développement, paragraphe 10. Le terme «emprunteur» désigne, en fonction du contexte, le bénéficiaire d’un don ou crédit de l’IDA, le garant d’un prêt de la BIRD ou l’organisme chargé de l’exécution du projet, si cet organisme n’est pas l’emprunteur.
3 Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet ayant un impact sur les populations autochtones, indépendamment de la source du financement.
4 Une «consultation des populations autochtones affectées, préalable, libre et fondée sur la communication des informations nécessaires» signifie qu’il faut lancer un processus de décision collective culturellement adapté, qui soit le fruit d’une consultation sérieuse et de bonne foi des intéressés permettant à ces derniers de participer en toute connaissance de cause à la préparation et à l’exécution du projet. Ce processus ne confère pas de droit de veto individuel ou collectif (voir le paragraphe 10).
5 Pour plus de détails sur la manière dont la Banque détermine si «les populations autochtones concernées adhèrent largement au projet proposé», voir le paragraphe 11.
6 La politique ne fixe pas a priori de seuil numérique minimum, dans la mesure où des groupes de populations autochtones peut ne compter que très peu de membres et, partant, être plus vulnérables.
7 Par «ancrage collectif» on entend une présence physique et des liens économiques avec des terres et des territoires qui sont la propriété traditionnelle du groupe concerné, ou dont l’utilisation ou l’occupation par ledit groupe est consacré par la coutume depuis des générations, y compris les zones ayant une signification spéciale, comme les sites sacrés. Ce terme désigne également la valeur attachée par des groupes transhumants ou de nomades aux territoires qu’ils utilisent de façon saisonnière ou cyclique.
8 Par «départ forcé» on entend la perte de l’ancrage collectif à des habitats géographiquement circonscrits ou à des territoires ancestraux qui intervient, du vivant des membres du groupe concerné, du fait des conflits, des programmes publics de réinstallation, de la confiscation des terres, des catastrophes naturelles ou de l’intégration desdits territoires dans une zone urbaine. Aux fins d’application de la présente politique, le terme «zone urbaine» désigne, généralement, une ville ou une agglomération qui présente toutes les caractéristiques suivantes, dont aucune n’est à elle seule décisive: a) la zone est légalement désignée comme zone urbaine par la législation nationale; b) elle est densément peuplée; et c) elle présente une forte proportion d’activités économiques non agricoles par rapport aux activités agricoles.
9 La politique de la Banque actuellement applicable est la PO/PB 4.00, Utilisation à titre pilote des systèmes de l’emprunteur pour traiter des questions relatives aux sauvegardes environnementales et sociales dans les projets financés par la Banque. Applicable uniquement aux projets pilotes recourant aux systèmes de l’emprunteur, cette politique inclut l’exigence que de tels systèmes soient conçus de manière à satisfaire aux objectifs et principes opérationnels tels qu’ils sont énoncés dans la politique sur les systèmes nationaux s’agissant des populations autochtones identifiées (voir tableau A.1.E).
10 Cet examen préalable peut être réalisé de manière indépendante ou dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet (voir PO 4.01, Évaluation environnementale, paragraphes 3, 8).
11 Ces méthodes de consultation (communication dans les langues autochtones, délais de réflexion suffisamment longs pour permettre aux personnes consultées de parvenir à un consensus et choix des lieux de consultation ad hoc) doivent aider les populations autochtones à exprimer leur point de vue et leurs préférences. Un guide intitulé Indigenous Peoples Guidebook (à paraître) fournira des conseils sur les pratiques recommandées en la matière et à d’autres égards.
12 Dans le cas des zones où co-existent des groupes non autochtones aux côtés de populations autochtones, le PPA devra faire tout son possible pour éviter de créer des injustices inutiles vis à vis de groupes défavorisés et socialement marginalisés.
13 De tels projets englobent des projets à l’initiative des communautés, des fonds sociaux, des opérations d’investissement sectoriel et des prêts accordés à des intermédiaires financiers.
14 Toutefois, si la Banque estime que le CPPA remplit son office, elle peut convenir avec l’emprunteur que l’examen préalable de ce document n’est pas nécessaire. C’est alors dans le cadre de sa supervision que la Banque procède à une évaluation du PPA et de sa mise en oeuvre (voir la PO 13.05, Supervision de projet).
15 L’évaluation sociale et le PPA doivent faire l’objet d’une large diffusion auprès des communautés autochtones affectées, par des moyens et dans des lieux culturellement adaptés. Dans le cas d’un CPPA, le document est diffusé par l’intermédiaire des OPA à l’échelon national, régional ou local, selon le cas, pour atteindre les communautés susceptibles d’être touchées par le projet. Lorsqu’il n’existe pas d’OPA, ce document peut être diffusé, si besoin en est, par l’intermédiaire d’autres organisations de la société civile.
16 Une exception à la règle stipulant que la préparation d’un PPA (ou CPPA) est une condition de l’évaluation du projet peut être faite par la direction de la Banque si le projet considéré satisfait aux conditions requises de la PO 8.50 Aide d’urgence pour la reconstruction. Dans ce cas, l’autorisation consentie par la direction stipule le calendrier et le budget devant servir de cadre à la préparation de l’évaluation sociale et du PPA (ou à la préparation du CPPA).
17 Le terme «droits coutumiers» désigne ici des systèmes traditionnels d’exploitation communautaire des terres et des ressources, y compris l’utilisation saisonnière ou cyclique, régis par les lois, valeurs, coutumes et traditions des populations autochtones plutôt que par un titre juridique délivré par l’État et conférant officiellement le droit d’utiliser ces terres ou ressources.
18 Le manuel intitulé Indigenous Peoples Guidebook (à paraître) consacré aux populations autochtones fournira des conseils sur les pratiques recommandées en la matière.
19 Voir la PO/PB 4.20, Genre et développement.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 47
AAnnnneexxee 22 BBiibblliiooggrraapphhiiee Abruzzi, W.S. (1979). Population pressure and subsistance strategies among the Mbuti Pygmies. Human Ecology 7-2 pp. 183-
189. Arom, S., S. Bahuchet, E. Motte-Florac & J. M. C. Thomas (eds.) 1981-1993. Encyclopédie des Pygmées Aka. SELAF, Paris. Bahuchet, S. 1985. Les Pygmées Aka et la Forêt Centrafricaine. SELAF, Paris. Bahuchet, S. 1993a. Situation des populations indigènes de forets denses et humides. Bruxelles: Commission européenne. Bahuchet, S. 1993b. History of the inhabitants of the central African rain forest: Perspective from comparative linguistics. In:
Hladik et al. 37-62. Bahuchet, S. 1993c. (ed.) Atlas des populations indigènes des forets denses humides. Projet CEE – online version.
(http://lucy.ukc.ac.uk/Rainforest/) Bahuchet, S. 1999. (ed.) The situation of indigenous peoples in tropical forests. APFT (Avenir des peuples des forêts tropicales)
pilot report - Online version. (http://lucy.ukc.ac.uk/Sonja/RF/Ukpr/Report_c.htm) Bahuchet, S. and Guillaume H. 1982 Aka-farmer relations in the northwest Congo basin. In: Leacock.E. and Lee, R.B. (Eds.)
Politics and history in band societies. Cambridge: Cambridge University Press pp.189-211. Bahuchet, Serge & Guillaume, Henri (1979). Relations entre chasseurs-collecteurs pygmées et agriculteurs de la forêt du nord-
ouest du bassin congolais. In: Bahuchet, Serge (Ed.) (1979). Pygmées de centrafrique: Etudes ethnologiques, historiques et linguistiques sur les pygmées „Ba.Mbenga“ (Aka/Baka) du nord-ouest du Bassin congolais. Paris: Centre national de la recherche scientifique. P. 109-139.
Bahuchet, Serge (1992). Dans la forêt d’afrique centrale: Les Pygmées Aka et Baka. Paris: Edition Peeters & SELAF. Bailey, R.C. & Bahuchet, S. & Hewlett, B. 1990. Development in Central African rain forest: concerns for forest peoples.
Washington: World Bank. Bailey, R.C. & Peacock, N.1988 Efe pygmies of northeastern Zaïre: subsistence strategies in the Ituri forest. in Garine and
Harrison (eds.), Coping with uncertainty in food supply, Oxford University Press Oxford, 88-117. Bailey, R.C. 1985. The socio-ecology of Efe Pygmy men in the Ituri forest, Zaire. PhD-Thesis. Cambridge: Harvard University Press. Bailey, R.C. and DeVore, I. 1989. Research on the Efe and Lese populations of the Ituri forest, Zaire. American Journal of
Physical Anthropology 78: 459-471. Barnard, A. et Woodburn, J., « Property, power and ideology in hunting and gathering societies: an introduction », in T. Ingold, D.
Riches et J. Woodburn (ed.), Hunters and Gatherers, vol. 2: Property, Power and Ideology, New York/Oxford, Berg, 1991. Barume, K. 2000. Heading Towards Extinction? Indigenous Rights in Africa: The case of the Twa of the Kahuzi-Biega National
Park, Democratic Republic of Congo. IWGIA Document No. 101, Copenhagen: IWGIA/ Forest Peoples Programme. Beauclerk, J., Hunters and Gatherers in Central Africa: On the Margins of Development, Oxfam Research Paper no. 6, Oxford,
Oxfam Publications, 1993. Bideri, Clemence & Petter Hergum, H. (2004): The Pygmies of the Great Lakes. Occasional Paper No. 02/2004, An assessment
of the Batwa/Bambuti Situation in Burundi and Eastern part of the Democratic Republic of Congo and Batwa/Bambuti Organisations in Bukavu (DRC) and Bujumbura (Burundi). Oslo: Norwegian Church Aid.
Bird-David, N., ‘Beyond the original affluent society: a culturalist reformulation’, Current Anthropology, vol. 33, no. 1, 1992, p. 25 à 47. Borges, J.L. & Guerrero, M. 1970. The book of imaginary beings. London: Jonathan Cape Borrini-Feyerabend, G. (ed.), Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation (vol. 1: A Process Companion; vol.
2: A Resource Book), Gland, Social Policy Group, IUCN, 1997. Carillo Oviedo, G., Indigenous Peoples and Conservation: WWF Statement of Principles, Gland, Forests/Protected Areas Unit,
WWF International, 1996. Caruso, Emily (2005): The Global Environment Facility in Central Africa. A desk-based review of the treatment of indigenous
peoples’ and social issues in a sample of 14 biodiversity projects Forest Peoples Programme, March 2005. Cavalli-Sforza, L.L. (ed.) 1986. African Pygmies. New York: Academic Press. Cernea, M.M. & Schmidt-Soltau, K. 2003. The end of forcible displacements? Conservation must not impoverish people. In:
Policy Matters 12: 8-34. Cernea, M.M. & Schmidt-Soltau, K. 2006. Poverty risks and national parks: Policy issues in conservation and resettlement;
World Development (in print) Colchester M., Jackson, D. & Kenrick, J. 1998. Forest Peoples of the Congo Basin: past exploitation, present threats and future
prospects. In: The Congo Basin — Human and Natural Resources. Amsterdam: Netherlands Committee for IUCN. Colchester, M. 1994/2003 Slave and Enclave. The Political Ecology of Equatorial Africa. Penang, Malaysia: World Rainforest
Movement. Demesse, Lucien (1978). Changements techno-économques es sociaux chez les Pygmées Babinga. Paris: Société d’études
lingustiques et anthropologiques de France. DFID & FAO 2002. How forests can reduce poverty. Rome: FAO. Doumenge C., 1990. La conservation des écosystèmes forestiers du Zaïre. Gland, IUCN. Endicott, K.L., ‘The conditions of egalitarian male–female relationships in foraging societies’, Canberra Anthropology, vol. 4, no.
2, 1981. Etoungou, P. 2003. Decentralisation viewed from inside : The implementation of community forests in East Cameroon.
Washington : WRI. FPP (Forest peoples project) 2003. Indigenous people and protected areas in Africa, Forest people project report. Moreton-in-
Marsh: FPP. Gapira, Wa Mutazimiza (1979) Les incidentes socio-economiques et politiques de la création du Parc National Albert dans la
territoire de Rutshuru 1925-1960). Travail de fin d’études pour l’obtention du diplôme de graduat en pédagogie appliquée. Grinker, R.R. 1994. Houses in the Rainforest – Ethnicity and Inequality among Farmers and Foragers in Central Africa.
Berkeley: University of California Press. Guide pour la compréhension du Code forestier à l’usage des populations locales et des peuples autochtones pygmées- Adrien
Sinafasi & Pacifique Mukumba (octobre 2004) Gusinde, Martin (1948). Urwaldmenschen am Ituri: Anthropo-biologische Forschungsergebnisse bei Pygmäen und Negern im
östlichen Belgisch-Kongo aus den Jahren 1934/1935. Wien: Springer. Harako, R. 1976. The Mbuti as hunters. Kyoto University African Studies, 10: 37-99. Harako, R. 1988. The cultural ecology of hunting behavior among Mbuti Pygmies in the Ituri Forest, Zaire. In (R. S. O. Harding &
G. Teleki, eds.) Omnivorous primates: Gathering and hunting - cultural ecology of hunting behavior in Human Evolution, pp.499-555.Columbia University Press, New York.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 48
Hart, J. 2000. Impact and sustainability of indigenous hunting in the Ituri Forest, Congo-Zaire: a comparison of un-hunted and hunted duiker populations. Pp. 106-153. IN: J. Robinson and E. Bennett (Eds). Hunting for Sustainability. Columbia University Press
Hart, J. 2001. Diversity and abundance in an African forest ungulate community and implications for Conservation. Pp 183-206. IN W. Weber, L. White, A. Vedder, and L. B. Naughton-Treves (Eds). African Rain Forest Ecology and Conservation: An Interdisciplinary Perspective. Yale University Press, New Haven.
Hart, J. 1986. Comparing dietary ecology of a community of frugivorous ungulates in Zaire. PhD Thesis, Michigan State University, East Lansing, Michigan.
Hart, J. A. & T. Hart 1986. The ecological basis of hunter-gatherer subsistence in the Ituri Forest of Zaire. Human Ecology, 14: 29-55. Hewlett, B.1996. Cultural diversity among African pygmies. In: Kent. C. (Ed.) Cultural diversity among the twentieth century
foragers. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 215-244. Hladik, C.M. & Hladik, A. & Linares, O.F. & Pagezy, H. & Sempe, A. & Hadley, M. (Eds.) 1993. Tropical forests, people and
food: Biocultural interaction and applications to development. Paris: Unesco. Hulstaert, G. (1978). Notes sur la langue des Bafotó, Anthropos 73, pp.113-132. ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature) (2005): Parc National des virunga Secteur Nord. Station de
mutsora. Programme Environnement autour du Parc National des Virunga (WWF/PEVi Kacheche). Cohabitation entre le parc national des Virunga les Pygmees et les communautes locales dans les cheferies Rwenzori et Watalinga. Mwenda , 11 -12 Novembre 2005, Novembre 2005, Station de Mutsora –PNVI /secteur Nord.
Ichikawa, M. & H. Terashima 1996. Cultural diversity in the use of plants by the Mbuti huntergatherers in Zaire. In (Kent, S. ed.) Cultural Diversity of the Twentieth Century Foragers: an African Perspective, pp. 276-293. Cambridge University Press.
Ichikawa, M. & Kimura, D. 2003. Recent advances in central African hunter-gatherer research African Study Monographs, Suppl.28: 1-6.
Ichikawa, M. 1978. The residential groups of the Mbuti Pygmies. Senri Ethnological Studies 1: 131-188. Ichikawa, M. 1986. Ecological bases of symbiosis, territoriality and intraband cooperation among the Mbuti Pygmies. SUGIA,
7(1): 161-188. Ichikawa, M. 1991. The impact of commoditization on the Mbuti of Zaire. Senri Ethnological Studies, 30: 135-62. Ichikawa, M. 1996. The co-existence of man and nature in the central African rain forest. In (Ellen, R. & K. Fukui, eds.)
Redefining Nature, pp.467-492. Berg Publishers. Ichikawa, M. 2001. The forest world as a circulation system: The impacts of Mbuti habituation and subsistence activities on the
forest environement. African Study Monographs, Suppl.26: 157-168. Ingold, T., Riches, D. et Woodburn, J. (éd.), Hunters and Gatherers vol. 1: Evolution and Social Change, et vol. 2: Property,
Power and Ideology, New York/Oxford, Berg, 1991 Irvine, F. R. 1961. Woody Plants of Ghana. Oxford University Press, Oxford. IUCN 1988 Le droit de la forêt, de la faune et de la flore dans les pays de la forêt dense humide africaine. Programme:
Utilisation rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale. IUCN Gland. IUCN/WCPA/WWF (Union mondiale pour la nature/ Commission mondiale des aires protégées / Fonds mondial pour la nature),
Principles and Guidelines on Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas, Gland, IUCN/WCPA/WWF, 1999. Jackson, D. 2004. Implementation of international commitments on traditional forest-related knowledge: Indigenous peoples’
experiences in Central Africa. Paper presented at the Expert Meeting on Traditional Forest-Related Knowledge in San Jose/Costa Rica (Dec 2004).
Jackson, D., « Some recent international initiatives in Equatorial Africa and their impacts on forest peoples », in K. Biesbrouck, S. Elders et G. Rossel (ed.), Central African Hunter-Gatherers in a Multidisciplinary Perspective: Challenging Elusiveness, CNWS, Universiteit Leiden, 1999, p. 279 à 290.
Jackson, Dorothy (2004): Implementation of international commitments on traditional forestrelated knowledge: Indigenous peoples’ experiences in Central Africa. Forest Peoples Programme. Paper commissioned by the International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests for presentation at the Expert Meeting on Traditional Forest-Related Knowledge (TFRK) 6–10 December 2004 in San Jose, Costa Rica.
Joiris, D.V. 1997. A comparable approach to hunting rituals among Baka. In: Kent, S. (ed.) Cultural diversity among the 20th century foragers. Cambridge: Cambridge University Press. Pp.245-275
Kabananyuke, K. « Pygmies in the 1990s, changes in forestland tenure, social impacts and potential health hazards, including HIV infection », rapport inédit, Makerere Institute of Social Research, Makerere University, Kampala, 1999.
Kalere, B. 2004. Situation socioéconomique et perspectives de développement des pygmées bambuti / batwa en territoire de Kalehe, province du sud kivu/rd congo.
Kapupu Diwa Mutimanwa (2001): The Bambuti-Batwa and the Kahuzi-Biega National Park: The Case of the Barhwa and Babuluko People of the PNKB, Democratic Republic of Congo. Summary of case study presented at the CAURWA/FPP conference: Indigenous Peoples and Protected Areas in Africa: From Principles to Practice held in Kigali, Rwanda, September 2001. (Programme d'intégration et de développement du Peuple Pygmée au Kivu).
Kenrick, J. 2000 ‘The Forest Peoples of Africa in the 21st Century: Present Predicament of Hunter Gatherers and Former Hunter Gatherers of the Central African Rainforests.’ Indigenous Affairs 1/00: 10- 24.
Kitanishi, K. 1995. Seasonal change in the subsistence activities and food intake of the Aka huntergatherers in northeastern Congo. African Study Monographs 16 (2): 73-118.
Komatsu, K. 1998. The food cultures of the shifting cultivators in Central Africa: The diversity of food material. In: African Study Monographs Suppl. 25: 149-177.
Kwokwo Barume, A.; 2000. Heading towards extinction? Indigenous rights in Africa: The case of the Twa of the Kahuzi-Biega National Park. Copenhagen: IWGIA.
Lattimer, M. 2004. Erasing the Board. Report of the international research mission into crimes under international law committed against the Bambuti Pygmies in the eastern Democratic Republic of Congo. Minority Rights Group International, London.
Lee, R.B. & Daly, R.H. (eds).1999. The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers. Cambridge University Press, Cambridge.
Lee, R.B. & DeVore, I. (eds.) 1968. Man the Hunter. Chicago: University Press. Lee, R.B. & Hitchcock, R.K. 2001. African hunter-gatherers: survival, history, and the politics of identity. In: African Study
Monographs Suppl. 26: 257-280. Leurat, N. 1998. Minorités et organisation de l’état : Actes du quatrième colloque international de la common law en Français.
Bruxelles : Bruylant. Lewin, R. 1888. New views emerge on hunter and gatherers. Science 240:1146-1148. Lewis, J. 2000. The Batwa Pygmies of the Great Lakes Region. Minority Rights Group International, London.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 49
Lewis, J. 2003. Project Evaluation of ‘Indigenous Peoples and Protected Areas: from principles to practice’ A Project run by the Forest Peoples Project. Moreton-in-Marsh: FPP.
Luling, V. et Kenrick, J., Forest Foragers of Tropical Africa: A Dossier on the Present Condition of the ‘Pygmy’ Peoples, Londres, Survival, 1998.
Mapual Mandjumba, M. 1990. Bref aperçu de la situation démographique au Zaïre. Géokin, 1 (1) : 65-72. Mayers, R.; 1987; Langues des groupes pygmées au Gabon: Un etat des lieux; Phalla (2): 111-124. MRG (Minority Rights Group international) & RAPY (2004): (Réseau des Assosiations autochtones Pygmées) : Eraising the
board. Report of the international research mission into crimes under international law committed against the Bambuti Pygmies in the eastern RDC.
Mugangu, S. C, 2000. Les droits de homme dans la région des grands Lacs: droit des pygmées et la conservation de la nature dans la législation nationale et internationale, Cas des pygmées de l’hinterland du Parc National de Kahuzi Biega. FIUC, Academia Brulant, Belgique.
Mugangu, S. C. 2001. Conservation et utilisation de la diversité biologique en temps de troubles armés: cas du parc National des Virunga. UICN, Yaoundé.
Mulvagh, Lucy; Nelson, John & Jackson, Dorothy (2005): Central Africa: Great Lakes Region and Cameroon. Article produced for The Indigenous World 2005, IWGIA’s Yearbook. (Nelson, John (2004): Forest Peoples Project: Conservation and Communities in Central Africa - The need to secure indigenous rights and biodiversity. Opportunities at the 5ème CEFDHAC, Conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale May 2004.
Mutimanwa, K.D. 2001. The Bambuti-Batwa and the Kahuzi-Biega National Park: The Case of the Barhwa and Babuluko People. In: FPP (Forest peoples programme) (2003). Indigenous people and protected areas in Africa: Forest people project report. Moreton-in-Marsh: Forest peoples programme. pp 87-103.
Ngima, G.M. 2001. The relationship between the Bakola and the Bantu peoples of the coastal regions of Cameroon and their perception of commerical forest exploitation. African Study Monographs Suppl. 26: 209-235.
Oksanen, T. & Mersmann, C. 2003. Forests in poverty reduction strategies – An assessment of PRSP Processes in Sub-Saharan Africa. In Oksanen, T., Pajari, B. & Tuomasjukka, T. (eds.) 2003. Forests in poverty reduction strategies : Capturing the potentials. Joensuu: EFI Proceedings Nr. 47/2003.
Pageezy, H. 1988a Contraintes nutritionnelles en milieu forestier équatorial liées à la saisonnalité et à la reproduction: Réponses biologiques et stratégies de subsistance chez les Ba-Oto et les Ba-Twa du village de la Nzalekenga (lac tumba, zaïre). Thèse de doctorat. Université d'Aix-Marseille III.
Pageezy, H. 1988b Coping with uncertainty in food supply among the Oto and the Twa in equatorial flooded forest near Lake Tumba, Zaïre. In: Garine & Harrison, Coping with Uncertainty in food supply, Oxford : Clarendon Press, 175-209.
Pagezy, H. (1973). Adaptation physique et organisation des activitiés quotidiennes de femmes pygmoîdes Twa et non pygmoîdes Oto de la forêt équatoriale (Lac Tumba, Zaire) Paris: Thèse de 3ème Cycle).
Pagezy, H. (1975). Les interrelations homme-faune de la forêt du Zaire. L’homme et l’animal. Premier colloque d’ethnozoologie. Paris: Inst. d’ethnosciences. Pp. 63-88.
Pagezy, H. (1976). Quelques aspects du travail quotidien des femmes Oto et Twa vivant en milieu forestier équatorial (Lac Tumba, Zaire). L’anthropologie 80-3, pp. 465-490.
Peterson, R.B. 2000. Conservation in the Rainforest: Culture, Values, and the Environment in Central Africa. Boulder: Westview. Pimbert, M.P. et Pretty, J.N., Parks, People and Professionals: Putting ‘Participation’ into Protected Area Management,
Discussion paper no. 57, Genève, UNRISD, 1995. Plumptre, A.; Kayitare, A.; Rainer, H.; Gray, M.; Munanura, I.; Barakabuye, N.; Asuma, S.; Sivha, M.; Namara, A.; (2004). The
socio-economic status of people living near protected areas in the Central Albertine Rift. WCS, International Gorilla Conservation Programme and Care.
Poole, Peter (2003) Cultural Mapping and Indigenious Peoples. A report for the UNESCO. [http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/2f04f4d4fcba283b39b5da634087fa53cultural_mapping_1.pdf].
Robinson, J.G. & Bennett, E.L. (Eds.) Hunting for Sustainability in tropical forests, Colombia University Press, New York, 2000. Rudd, Kristina (2004). “Death will follow us” – The Impoverishment of the Uganda Batwa Associated with Bwindi Impenetrable
National Park. Middlebury College, Vermont. Sahlins, M. 1968. Notes on the original affluent society. In: Lee, R.B. & DeVore, I. (eds.) 1968. Man the Hunter. Chicago: Aldine.
Pp.85-89. Schadeberg, T., « Batwa: the Bantu name for the invisible people », in K. Biesbrouck, S. Elders et G. Rossel (ed.), Central
African Hunter-Gatherers in a Multidisciplinary Perspective: Challenging Elusiveness, CNWS, Universiteit Leiden, 1999, p. 21 à 40.
Schebesta, P. 1933. Among Congo Pigmies. Hutchinson & Co. Ltd, London. Schebesta, P. 1938-1958. Die Bambuti-Pygmaen von Ituri. Brussels: Boekhandel Falk & Zoon. Schebesta, Paul SVD (1938). Die Bambuti Pygmäen vom Ituri: Ergebnisse zweier Forschungsreisen zu den
zentralafrikanischen Pygmäen. Band 1: Geschichte, Geographie, Umwelt, Demographie und Anthropologie der Ituri-Bambuti (Belgisch Kongo). Bruxelles: Institut Royal Colonial Belge, Section des Sciences Morales et Politiques, Mémoires (4;1).
Schebesta, Paul SVD (1941). Die Bambuti Pygmäen vom Ituri: Ergebnisse zweier Forschungsreisen zu den zentralafrikanischen Pygmäen. Band 2: Ethnographie der Ituri-Bambuti Teil 1: Die Wirtschaft der Ituri-Bambuti (Belgisch-Kongo). Bruxelles: Institut Royal Colonial Belge, Section des Sciences Morales et Politiques, Mémoires (4;2.1).
Schebesta, Paul SVD (1948). Die Bambuti Pygmäen vom Ituri: Ergebnisse zweier Forschungsreisen zu den zentralafrikanischen Pygmäen. Band 2: Ethnographie der Ituri-Bambuti Teil 2: Das soziale Leben. Bruxelles: Institut Royal Colonial Belge, Section des Sciences Morales et Politiques, Mémoires (4;2.2).
Schebesta, Paul SVD (1950). Die Bambuti Pygmäen vom Ituri: Ergebnisse zweier Forschungsreisen zu den zentralafrikanischen Pygmäen. Band 2: Ethnographie der Ituri-Bambuti Teil 3: Die Religion. Bruxelles: Institut Royal Colonial Belge, Section des Sciences Morales et Politiques, Mémoires (4;2.3).
Schmidt-Soltau, K. 2003. Conservation related resettlement in Central Africa: environmental and social risks. In: Development and Change (34)3:525-551.
Schumacher P. (1939) Die soziale Umwelt der Kivu-Pygmäen. Bruxelles: Institut des Parc Nationaux du Congo Belge. Schweinfurth, G. 1873. The heart of Africa: Three years’ travel and adventures in the unexplored regions of Central Africa from
1868-1871. London: Samson Low, Marston, Low and Searle. Shalukoma C., 1993. Enquête socioéconomique sur les pygmées vivants aux alentours du Parc National de Kahuzi-Biega,
Projet PNKB/GTZ, Bukavu

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 50
Shalukoma C., 2002. Analyse de l’interaction socio - économique et écologique entre la Parc National de Kahuzi-Biega et les populations pygmées du Sud/Kivu.
Shalukoma, Chantal & A.J. Murhula M.M. (2001): Vision de stratégie de conservation des ressources naturelles à travers l’intégration socio-économique des pygmées vivant au PNKB.
Sinafasi, Makelo Adrien & Mukumba, Isumbisho Pacifique (2004): Mise en œuvre des engagements intergouvernementaux sur les connaissances traditionnelles dans le domaine des forêts: Cas de la Republique Democratique du Congo.
Tanno, T. 1976. The Mbuti net hunters in the Ituri forest, eastern Zaire: Their hunting activities and band composition. Kyoto University African Studies, 10: 101-135.
Tanno, T. 1981. Plant utilization of the Mbuti Pygmies: with special reference to their material culture and use of wild vegetable food. African Study Monographs, 1: 1-53.
Terashima, H. 1983. Mota and other hunting of the Mbuti archers. African Study Monographs, 3: 71-85. Terashima, H., M. Ichikawa & M. Sawada 1989. Wild plant utilization of the Balese and the Efe of the Ituri Forest, the Republic
of Zaire. African Study Monographs, Supplementary Issue, 8: 1-78. Thomas, Jacqueline M.C. & Bahuchet, Serge (1983). Encyclopédie des pygmées Aka: Techniques, langage et société des
chasseurs-cueilleurs de la forêt centrafricaine (Sud-Centrafrique et Nord-Congo). I (1). Les Pygmées Aka. Paris: Centre national de la recherche scientifique.
Thomas, Jacqueline M.C. & Bahuchet, Serge (1991a). Encyclopédie des pygmées Aka: Techniques, langage et société des chasseurs-cueilleurs de la forêt centrafricaine (Sud-Centrafrique et Nord-Congo). I (2). Le Monde des Aka. Paris: Centre national de la recherche scientifique.
Thomas, Jacqueline M.C. & Bahuchet, Serge (1991b). Encyclopédie des pygmées Aka: Techniques, langage et société des chasseurs-cueilleurs de la forêt centrafricaine (Sud-Centrafrique et Nord-Congo). I (3). La Société. Paris: Centre national de la recherche scientifique.
Thomas, Jacqueline M.C. & Bahuchet, Serge (1991c). Encyclopédie des pygmées Aka: Techniques, langage et société des chasseurs-cueilleurs de la forêt centrafricaine (Sud-Centrafrique et Nord-Congo). I (4). La Langue. Paris: Centre national de la recherche scientifique.
Turnbull, C. M. 1961. The Forest People: A Study of the Pygmies of the Congo. Simon and Schuster, New York. Turnbull, C. M. 1965. Wayward Servants: The Two Worlds of the African Pygmies. Natural History Press, Garden City, New York. Turnbull, C. M. 1983. The Mbuti Pygmies: Change and Adaptation. Holt, Rinehart andWinston, New York. UNESCO (2005) World Heritage Paper 17 : Promouvoir et préserver le patrimoine congolais. Paris : UNESCO. Vansina, J. 1990. Paths in the Rainforests – Towards a History of political tradition in equatorial Africa. London: James Currey. Wilkie, D.S. (1988). Hunters and farmers of the African forest. In Denslow, J.S. and Padoch, C. (eds.), People of the Tropical
Rain Forest. University of California Press. Berkeley, pp. 111-126. Wilkie, D.S. and Curran, B. (1993). Historical trends in forager and farmer exchange in the Ituri rain forest of northeastern Zaire.
Human Ecology 2: 389-417. Wilkie, D.S. and Morelli, G. (1997). Roads and Development in Eastern Congo: declining livelihoods and growing self-reliance
among the Lese and Efe. Cultural Survival Quarterly 21(3): 38-41 1997. Woodburn, J. 1982. Egalitarian Societies. Man, 17: 431-451. Woodburn, J., « Indigenous discrimination: the ideological basis for local discrimination against hunter-gatherer minorities in
sub-Saharan Africa », Ethnic and Racial Studies, vol. 20, no. 2, 1997, p. 345 à 361. WWF-ICCN, 1995. Lignes Directrices pour la Gestion de la Réserve de Faune à Okapis, Projet de proposition préparé par
WWF-Fonds Mondial pour la Nature en collaboration avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et soumis à la Banque Mondiale en exécution partielle de l’accord de subvention japonais NA74752.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 51
AAnnnneexxee 33 LLiissttee ddeess ppeerrssoonnnneess rreennccoonnttrrééeess
Jour Date Lieux Activité 1 1/2/2006 Yaoundé Lecture des documents clefs 2 2/2/2006 Yaoundé Lecture des documents clefs 3 3/2/2006 Yaoundé Lecture des documents clefs 4 4/2/2006 Yaoundé-
Kinshasa Voyage à Kinshasa
5 5/2/2006 Kinshasa Elaboration d'une stratégie de recherche 6 6/2/2006 Kinshasa Familiarisation avec l’ICCN 7 7/2/2006 Kinshasa Discussion avec Pasteur Wilungula (ICCN – Administrateur Délégué Général), Dr.
Mwamba (ICCN - Dir. Coopération) et Kapupu Mutimanwa (LINAPYCO & REPALEAC)
8 8/2/2006 Kinshasa Participation à l’atelier de planification de REPALEAC pour la période 2006-2010 et à l’atelier de restitution de mission ICCN & KFW. Discussion avec Dr. Mwanba (ICCN - Directeur Coopération), Benoît Kisuki (ICCN – Administrateur Directeur Technique) et Jean Claude Le Corre (ICCN - Programme d’appui institutionnel).
9 9/2/2006 Kinshasa Discussion avec Dr. Mwanba (ICCN - Directeur Coopération), Rémy Bakandowa (WWF – Directeur Administratif), Didier Devers (University of Maryland), Jean Paul Kibambe (OSFAC Inc.) et Henri Ikoleki Elomba (ICCN - Projet Réhabilitation des Aires Protégées en République Démocratique du Congo).
10 10/2/2006 Kinshasa Participation à l’atelier de planification de REPALEAC pour la période 2006-2010. Discussion avec le Prof. Kankonde (Banque Mondiale), Robbert Bekker (ICCN – Projet Réhabilitation des Aires Protégées en République Démocratique du Congo), John Hart (WCS), Jaap Schoorl (GTZ) et Joseph Itongwa Mukumo (PIDP Nord Kivu & CNCJA).
11 11/2/2006 Kinshasa Discussion avec Caicha W’Otshambi Otambi (ANPANMNP-PFNB) et Espérance Binyuki (UEFA & RAPY).
12 12/2/2006 Kinshasa Planification pour le sondage sur le terrain. 13 13/2/2006 Kinshasa Discussion avec Filippo Saracco (UE) et Cath Long (Rainforest Foundation). 14 18/2/2006 Kinshasa-
Goma Discussion avec Alphonse Muhimdo (CREF), Lionel Diss (Rainforest Foundation Norway) et Claude Sikubwabo (ICCN Nord Kivu & UICN Projet Parc pour la paix).
15 19/2/2006 Goma Discussion avec Teresa Hart (WCS), Mpirikanyi Forongo (ACODRI), Valentin Sendegeya & Francis Mujinya (ACOPA) et Achille Biffumbu (Pygmeeen Kleinood).
16 20/2/2006 Goma Discussion avec M. Mashagiro (ICCN Dir. Nord Kivu), Didier Bolamba (ICCN – Maiko), Wojciech Walter Dziedzic (WWF – Programme Environnemental autour des Virunga) et Patrick Lavand’homme (UN-OCHA).
17 21/2/2006 Goma Discussion avec la population des villages dans le PN Virunga: Kirolirwe (personne ressource: Buhungu) Burungu (personne ressource: Migabo) et Kihonga (personne ressource: Bimenyimana) et atour du PN Virunga: Kitshanga (personne ressource: Pascal Ntahompageze). Discussion avec M Migabo (Chef de groupe des familles dans le parc), Edewand Maitongaiko (Chef de groupement des Bashali-Mukoto), Abbé Faustin Kakule (Paroisse Catholique de Kitshanga), Leandre Munyarusisiro (Administrateur de territoire – Assistant résident de Bishusha à Kitohanga et le territoire de Rutshuru) et Ndongo Tali Katabana (Animateur de paix d’ACODRI).
18 22/2/2006 Goma Discussion avec les peuples autochtones autour du PN Virunga: Bigamiro Mutaho & Nirengenga Mukendo. Discussion avec Claude Sikubwabo (ICCN Nord Kivu & Projet Parc pour la paix), Achille Biffumbu (Pygmeeen Kleinood), et Joseph Itongwa Mukumo (PIDP Nord Kivu & CNCJA).
19 23/2/2006 Goma - Beni Discussion avec Delphin Nganzi Nganzi Kangala (WWF Virunga Nord), Lazar Isalama (ICCN-Maiko), Fidèle Amsini (WCS-Maiko).
20 24/2/2006 Beni Discussion avec Dr. Jackson Basikania, Moro Unen, Soheranda Kazele, José Mokbondo, Elisi Tsandi (touts de PAP-RDC) Jean-Robert Kasereca (SoDéRu).
21 25/2/2006 Beni-Manguredjipa
Discussion avec Kasayote Mononga (Secrétaire Administratif du Secteur des Bapere), Nepo Kemonyo (ICCN Maiko) et Augustin Kambale Talima (AGIR).
22 26/2/2006 Manguredjipa Discussion avec la population des villages autour du PN Maiko: Fatwa (personnes ressources: Sinafasi Malimawe Kennedy, Alikanza Athneze), Mangasie (personnes ressources: Shina Alexandre et Masumboko Jenga) et Manguredjipa (personnes ressources: Kasayote Mononga et Abbés Jean Marie Mangungu) Manguredjipa est en même temps une zone de réinstallation pour la population dans le PNVi. Discussion avec Bwana Puwa Mambele (Déplacée du village Engandabino à l'intérieur du PN Maiko), M. Mafaranga (Déplacée du village Longomani à l'intérieur du PN Maiko), et M. Adabu (Déplacée du village Bambolo à l'intérieur du PN Maiko).
23 27/2/2006 Manguredjipa-Beni
Discussion avec la population des villages autour du PN Maiko, qui constituent en même temps la zone de réinstallation des populations dans le PNVi: Kambau & Kantine (personnes ressources: Chef Ngalu Kibela, et Kakule Ngoe – «Encadreur des pygmées») et les peuples autochtones du Maguha-Mabola (personnes ressources: Kasonge Romani, Kani Tambani). Discussion avec Henock Pascal Baguma Cihusi (ICCN Maiko).
24 28/2/2006 Beni Discussion avec les peuples autochtones autour du PN Virunga: Mopaka, Upende et Mavievie-Endoyi. Discussion avec Mwami Kapupa (Chef du Secteur Beni), Norbert Mushensi (ICCN Chef du Secteur Nord de Virunga), Banamuhere Sukira

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 52
Jour Date Lieux Activité (ICCN Virunga) et Pawku V. Pavasa (CADAK et CREF).
25 1/3/2006 Beni Discussion avec les peuples autochtones et la population en général autour du PN Virunga: Mamundioma (personne ressource: Chef Aurosi Mapiyamukono II), Makoyoba et les populations déplacées de la région Mayangose (personnes ressources: Chef coutumier Olenga Kitobi Gregoire, Bonguma Kitobi Andre). Discussion avec Christophe Leonard (SoDéRu).
26 2/3/2006 Beni-Kyondo Discussion avec la population des villages à l'intérieur du PN Virunga: Kasindi (personne ressource: Chef Kambaze Mundeya), les Hima au nord de Karuruma (personnes ressources: Président John Kitaka Artaizipwa) et la population (personne ressource Kideman Makome), le COPEVI (personnes ressources: Kikwaya Alois et Frédéric Kasonia) et l’ICCN à Kyavigonge (M. Musemakweli et Kamate Malikewa). Discussion avec la population des villages autour du PN Virunga: Museya (personnes ressources: Chef Kasereka Muhangi Felix). Discussion avec Jean Jacques Rousseau Tshingungu Kapele (Administrateur de Territoire de Beni) et Mughemi Syausua Ephrem (ICCN Virunga).
27 3/3/2006 Kyondo-Goma Discussion avec la population des villages autour du PN Virunga: Kyondo (personne ressource: Jean Masika Museghe). Discussion avec Jean Claude Kyungu (DFGF-E) Jean Dedieu Ndivito (RMIPAT) et Delphin Nganzi Nganzi Kangala (WWF Virunga Nord).
28 4/3/2006 Goma Discussion avec M. Mashagiro (ICCN Dir. Nord Kivu) et Didier Bolamba (ICCN – Maiko).
29 5/3/2006 Goma Préparation de la présentation pour l'atelier de restitution préliminaire. 30 6/3/2006 Goma-
Kinshasa Discussion avec Patrick (Diane Fossy Gorilla Fund – International), Robert Muir (FZG), Wojciech Walter Dziedzic (WWF), Alejandra Colom (WWF) et Didier Devers (University of Maryland).
31 7/3/2006 Kinshasa Discussion avec le Prof Kakonde (Banque Mondiale), Laurent Debroux (Banque Mondiale), le Dr. Mwamba (ICCN) et John Hart (WCS).
32 8/3/2006 Kinshasa Atelier de restitution préliminaire avec l'ICCN. Discussion avec Filippo Saracco (UE) et Pierre Laye (Attaché de la Cooperation de l'Ambassade de France).
33 9/3/2006 Kinshasa-Y’dé Voyage. 34-50
Yaoundé Elaboration des rapports préliminaires.
51 8/11/2006 Yaoundé Harmonisation du PAD avec les rapports. 52 9/11/2006 Yaoundé Harmonisation du PAD avec les rapports. 53 10/11/2006 Yaoundé Harmonisation du PAD avec les rapports. 54 13/11/2006 Yaoundé Harmonisation du PAD avec les rapports. 55 14/11/2006 Yaoundé Harmonisation du PAD avec les rapports. 56 12/12/2006 Nairobi-Bunia Voyage. 57 13/12/2006 Bunia-Nagero Discussion avec l’equipe de PN Garamba et d’APF 58 14/12/2006 Nagero Discussion avec la population des villages autour du PN Garamba: Nagero
(personne ressource: Chef Odra André). 59 15/12/2006 Nagero-
Tekadje Discussion avec la population des villages autour du PN Garamba: Tekadji (personne ressource: Chef Imbidi).
60 16/12/2006 Tekadje-Faradje
Discussion avec la population des villages autour du PN Garamba: Bhadri (personne ressource: Chef Bomekate Londoma Jean), Djabir (personne ressource: Chef Gulemandango).
61 17/12/2006 Faradje-Nagero
Discussion avec la population des villages autour du PN Garamba:Faradjei (personne ressource: Chef Lado Pagopi Odon).
62 18/12/2006 Nagero Atelier de restitution avec les parties presenantes à Nagero. 63 19/12/2006 Nagero-Bunia Voyage. 64 20/12/2006 Bunia-Nairobi Voyage. Elaboration du chapitre PNG. 65 25/12/2006 Elaboration du chapitre PNG. 66 26/12/2006 Elaboration du chapitre PNG. 67 27/12/2006 Elaboration du chapitre PNG. 68 08.01.2007 Y’dé Kinshasa Voyage. Préparation de la présentation pour l'atelier de restitution. 69 09.01.2007 Kinshasa Révision des rapports. 70 10.01.2007 Kinshasa Atelier de restitution. 71 11.01.2007 Kinshasa-Beni Voyage. Préparation d’atelier de restitution pour le PNVi 72 12.01.2007 Beni Préparation d’atelier de restitution pour le PNVi 73 13.01.2007 Beni Atelier de restitution. 74 14.01.2007 Beni-Kinshasa Voyage. Révision et finalisation des rapports. 75 15.01.2007 Kinshasa-Y’dé Révision et finalisation des rapports. 76 18.01.2007 Révision et finalisation des rapports. 77 19.01.2007 Révision et finalisation des rapports. 78 20.01.2007 Révision et finalisation des rapports. 79 21.01.2007 Révision et finalisation des rapports. 80 22.01.2007 Révision et finalisation des rapports.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 53
AAnnnneexxee 44:: PPrroojjeett ddee TTeerrmmeess ddee RRééfféérreennccee rreellaattiiffss àà llaa mmiissee eenn œœuuvvrree dduu PPPPAA dduu PPrroojjeett GGEEFF--BBMM A. Mission de contrôle 1. Contexte du projet
Dans la perspective d'une restructuration, la République Démocratique du Congo (RDC) a entrepris un vaste chantier de réformes structurelles destinées à l'amélioration de la gestion de ses ressources naturelles. La Nouvelle Vision pour la Conservation des Aires Protégées dans la RDC vise une «gestion efficace et coordonnée d’un réseau d’aires protégées afin d'assurer que la conservation de la nature sera une composante intégrale du Programme National de Forêt et de Conservation de la Nature et du Programme National de Lutte contre la Pauvreté». Pour la mise en oeuvre de sa nouvelle vision, le Gouvernement de la RDC a demandé, à travers la Banque Mondiale (BM), une aide financière auprès du Fond pour l’Environnement Mondial (GEF). Le Projet GEF-BM est composé de trois composantes:
Composante 1: Appui à la réhabilitation institutionnelle de l'ICCN (niveau national) Composante 2: Appui aux parcs nationaux Virunga et Garamba (niveau des sites) Composante 3: Expansion du réseau des aires protégées (niveau national)
Le Projet GEF-BM est susceptible d'avoir des conséquences sur les populations rurales à travers l’identification des nouvelles aires protégées avec une superficie de 10 millions de hectares, la mise en place des aires protégées avec une superficie de 2 millions de hectares et l'amélioration de l’aménagement des parcs nationaux Virunga et Garamba avec une superficie totale de 1,3 millions de hectares. Les effets généraux ont été analysés dans l'étude sur l'impact social (EIS), mais la meilleure pratique - la Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale sur les Peuples Autochtones (PO 4.10) - exige une action particulière lorsque les investissements de la Banque Mondiale impliquent des peuples autochtones représentées, en RDC, par les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka. Dans la zone tampon du Parc National de Virunga, il y a environ 12.000 individus des différents groupes Twa et Mbuti et dans les autres zones rurales destinées a l’identification des nouvelles aires protégées encore environ 100.000 -200.000 peuples autochtones.
2. Justification du Plan des peuples autochtones
Compte tenu de l’existence des impacts du Projet GEF-BM sur les populations autochtones, la préparation d'un Plan des Peuples Autochtones (PPA) constitue l'une des conditions fixées par la PO 4.10. L’objectif principal de ce PPA consiste à s'assurer que le projet respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations autochtones et de s’assurer en même temps que les peuples autochtones en retirent des avantages socio-économiques, culturellement adaptés. Ce rapport démontre la manière dont ces objectifs peuvent être atteints et il prévoit des mesures destinées: a) à éviter les incidences susceptibles d'être préjudiciables aux populations autochtones concernées; ou b) au cas où cela ne serait pas possible, à atténuer, minimiser ou compenser de telles incidences.
3. Objectifs de la mission de contrôle
L'objectif de cette mission consiste à assurer la mise en ouvre du PPA de Projet GEF-BM en accord avec la PO 4.10 de la Banque Mondiale et à garantir que le Projet GEF-BM: • renforcera les systèmes traditionnels de gouvernance et promouvra le respect du dialogue
communautaire et des droits coutumiers de tous les citoyens en RDC; • réduira la pauvreté de toutes les populations et encouragera un développement durable; • déclenchera des impacts positifs sur la population entière, mais plus particulièrement encore parmi
les peuples les plus pauvres, marginalisés et vulnérables, c'est-à-dire les peuples autochtones; • respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations
Mbuti, Cwa, Aka et Twa; • s’assurera que, à l'intérieur de la zone d’intervention, les peuples autochtones reçoivent les bénéfices
culturellement adaptés et équivalent en même temps à ceux que reçoivent tous les autres groupes; • assistera les peuples autochtones à améliorer leur situation de vie.
4. Résultats attendus
Les résultats suivants sont: 1. Les compétences nécessaires à la mise en œuvre du PPA en accord avec la PO 4.10 ont été
mises en place.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 54
2. Les compétences du réseau des ONG en faveur des peuples autochtones et des associations des peuples autochtones en charge de la mise en œuvre sont renforcées afin de garantir que le PPA soit mise en place en accord avec la OP 4.10 et le rapport final du PPA de Projet GEF-BM.
3. Un système de suivi et d’évaluation participative au profit du PPA est opérationnel.
5. Activités retenues
Pour atteindre les résultats tels que décrits ci-dessus, les activités suivantes ont été retenues:
5.1. Formation des facilitateurs de la mise en œuvre du PPA Sensibilisation et formation du personnel de l’ICCN et des ONG en faveur des PA (ONG PPA) relative aux techniques de la communication interculturelle, au standard international de la coopération avec les peuples autochtones (PO 4.10 etc.) et aux leçons tirées dans les autres pays lors de la mise en œuvre des PPA à travers les différents éléments du manuel d’exécution concernant les PPA.
5.2. Mission d’accompagnement et de supervision des facilitateurs de la mise en oeuvre du PPA (ONG PPA)
5.2.1. Réaliser une formation appropriée pour améliorer les capacités organisationnelles et techniques du réseau des ONG soutenant les peuples autochtones et leurs associations en charge de la mise en oeuvre du PPA du Projet GEF-BM.
5.2.2. Réaliser des missions d’accompagnement. Pendant chaque mission et en collaboration avec l’ICCN et les ONG PPA, le consultant évaluera l’état de la mise en place du PPA du Projet GEF-BM, l'état de la mise en oeuvre des recommandations de la mission précédente et il proposera des actions nouvelles à mettre en œuvre et tout particulièrement: a) diagnostiquer les faiblesses organisationnelles techniques et de la gestion inhérente au niveau du
pilotage du réseau ainsi qu’au niveau de chacun de ses membres; b) proposer un plan de renforcement des capacités; c) effectuer des visites conjointes sur le terrain et proposer des mesures visant à améliorer les
interactions entre le réseau et les peuples autochtones affectées; d) apporter une assistance technique, méthodologique et organisationnelle au réseau et veiller à la
bonne mise en œuvre de toutes ces actions; e) accompagner le processus de la mise en oeuvre du PPA du Projet GEF-BM et proposer des
actions efficaces pour améliorer ce qui en existe déjà.
5.3. Système suivi et évaluation
5.3.1. Réaliser une formation sur la méthodologie et la recherche quantitative et sur la gestion des bases de données
5.3.2. Réaliser une évaluation externe du PPA du Projet GEF-BM.
5.4. Production des rapports
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec l'ICCN, le réseau des ONG soutenant les peuples autochtones et leurs associations en charge de la mise en oeuvre du PPA et, si nécessaire, en consultation avec la Banque Mondiale. Le consultant doit être disponible de tenir compte des rapports fournis par les peuples autochtones, le réseau, l'ICCN et par d'autres structures relevantes et aussi de la Banque Mondiale, et il présentera les rapports finaux incluant les commentaires faits. Il devra également suivre et donner des rapports relatifs à la manière dont le plan d'action, les programmes et le processus de la planification des structures concernées, l'action en général et la mise en oeuvre du PPA du Projet GEF-BM tiennent compte des résultats.
5.5. Produits à fournir et emploi de temps relatif aux résultats:
Le consultant élaborera un bref rapport de mission après chacune des interventions et un rapport annuel.
Tâches supplémentaires du consultant: Rédaction d'un rapport: le 31/9 de chaque année Révision et commentaires de la part de tous les dépositaires: le 15/10 de chaque année Introduction des recommandations issues de la procédure de révision: le 22/10 de chaque année Date de la présentation du rapport final: le 31/10 de chaque année
6. Time line
Voir Plan d’action du PPA du Projet GEF-BM

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 55
7. Budget
Voir Plan d’action du PPA du Projet GEF-BM
Payement
Le consultant sera payé de la manière suivante: I. 30% du honoraire et des dépenses annuelles pour la communication/transport/matériel sera payé à la
livraison du rapport annuel. II. Les 70% restant du honoraire sera payé lorsque le rapport final sera approuvé.
8. Qualification des prestataires des services
Le consultant devra disposer d'une formation académique en anthropologie, sociologie ou dans une autre matière y relative et avec au moins dix ans d'expérience dans le domaine de la participation avec les peuples autochtones. Le/la consultant/e doit avoir des bonnes connaissances relatives à la structure et du fonctionnement du gouvernement local en RDC, mais sur les populations rurales ainsi et les peuples autochtones et il/elle doit également s'être familiarisé/e avec la Politique Opérationnelle 4.10 peuples autochtones de la Banque Mondiale et disposer des expériences concernant sa mise en oeuvre à l'intérieur des projets soutenus par la Banque Mondiale en Afrique.

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 56
B. Projet de Termes des références pour la mise en oeuvre du plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM à travers d'un réseau des ONG soutenant les peuples autochtones et leurs associations 1. Contexte du projet
Dans la perspective d'une restructuration, la République Démocratique du Congo (RDC) a entrepris un vaste chantier de réformes structurelles destinées à l'amélioration de la gestion de ses ressources naturelles. La Nouvelle Vision pour la Conservation des Aires Protégées dans la RDC vise une «gestion efficace et coordonnée d’un réseau d’aires protégées afin d'assurer que la conservation de la nature sera une composante intégrale du Programme National de Forêt et de Conservation de la Nature et du Programme National de Lutte contre la Pauvreté». Pour la mise en oeuvre de sa nouvelle vision, le Gouvernement de la RDC a demandé, à travers la Banque Mondiale (BM), une aide financière auprès du Fond pour l’Environnement Mondial (GEF). Le Projet GEF-BM est composé de trois composantes:
Composante 1: Appui à la réhabilitation institutionnelle de l'ICCN (niveau national) Composante 2: Appui aux parcs nationaux Virunga et Garamba (niveau des sites) Composante 3: Expansion du réseau des aires protégées (niveau national)
Le Projet GEF-BM est susceptible d'avoir des conséquences sur les populations rurales à travers l’identification des nouvelles aires protégées avec une superficie de 10 millions hectares, la mise en place des aires protégées avec une superficie de 2 millions hectares et l'amélioration de l’aménagement des parcs nationaux Virunga et Garamba avec une superficie totale de 1,3 millions hectares. Les effets généraux ont été analysés dans l'étude sur l'impact social (EIS), mais la meilleure pratique - la Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale sur les Peuples Autochtones (PO 4.10) - exige une action particulière lorsque les investissements de la Banque Mondiale impliquent des peuples autochtones, qui sont représentées, en RDC, par les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka. Dans la zone tampon du Parc National des Virunga, il y a environ 12.000 individus des groupes Twa et Mbuti et dans les autres zones rurales destinés a l’identification des nouvelles aires protégées encore environ 100.000 -200.000 peuples autochtones.
2. Justification du Plan des peuples autochtones
Compte tenu de l’existence des impacts du Projet GEF-BM sur les populations autochtones, la préparation d'un Plan des Peuples Autochtones (PPA) constitue l'une des conditions fixées par la PO 4.10. L’objectif principal de ce PPA consiste à s'assurer que le projet respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations autochtones et de s’assurer en même temps que les peuples autochtones en retirent des avantages socio-économiques, culturellement adaptés. Ce rapport démontre la manière dont ces objectifs peuvent être atteints et il prévoit des mesures destinées: a) à éviter les incidences susceptibles d'être préjudiciables aux populations autochtones concernées; ou b) au cas où cela ne serait pas possible, à atténuer, minimiser ou compenser de telles incidences. La Banque Mondiale n’accepte le financement d'un projet que lorsque ce projet obtient un large soutien de la part des populations autochtones à l’issue d’un processus préalable de consultation libre et informée.
3. Objectifs de la mise en place du plan des peuples autochtones
L'objectif de cette mission consiste à assurer l'implantation du PPA de ce PPA du Projet GEF-BM en accord avec la PO 4.10 de la Banque Mondiale et à garantir que le Projet GEF-BM: • renforcera les systèmes traditionnels de gouvernance et promouvra le respect du dialogue
communautaire et des droits coutumiers de tous les citoyens en RDC; • réduira la pauvreté de toutes les populations et encouragera un développement durable; • déclenchera des impacts positifs sur la population entière, mais plus particulièrement encore parmi
les peuples les plus pauvres, marginalisés et vulnérables, c'est-à-dire les peuples autochtones; • respectera pleinement la dignité, les droits de la personne, l’économie et la culture des populations
Mbuti, Cwa et Twa; • s’assurera que, à l'intérieur de la zone d’intervention, les peuples autochtones reçoivent les bénéfices
culturellement adaptés et équivalent en même temps à ceux que reçoivent tous les autres groupes; • assistera les peuples autochtones à améliorer leur situation juridique, politique, sociale,
économique, culturelle et psychologique.
4. Résultats attendus

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 57
Les résultats attendus sont les suivants: • Des opportunités légales égales aux peuples autochtones dans la zone d’intervention du Project
GEF-BM ont été établies • Des opportunités techniques égales aux peuples autochtones dans la zone d’intervention du
Project GEF-BM ont été établies • Des opportunités financières égales aux peuples autochtones dans la zone d’intervention du
Project GEF-BM ont été établies • Des opportunités organisationnelles égales aux peuples autochtones dans la zone d’intervention
du Project GEF-BM ont été établies 5. Activités retenues
L'ONG PPA est responsable de la mise en place du plan d’action du PPA du Projet GEF-BM, et tout particulièrement de l'implantation des activités qui lui ont été attribuées (voir plus haut) Il est, par ailleurs, attendu de l'ONG PPA de • Participer activement aux formations et aux missions d’accompagnement • Participer activement aux processus de la sensibilisation et aux opportunités de formation dans le
domaine des techniques de communication interculturelle, des standards internationaux de la coopération avec les peuples autochtones (PO 4.10 etc.) et tenir compte des leçons tirées dans les autres pays lors de la mise en œuvre des PPA à travers les différents éléments du manuel d’exécution des PPA .
• Participer activement aux missions d’accompagnement. Ce qui veut dire que la mission de contrôle doit avoir accès à tous les documents relatifs à la réalisation des PPA, que les expériences, les compétences et les faiblesses doivent être discutées avec la mission et que l'on prenne en considération ses recommandations lors de la réalisation des PPA.
• Participer activement à une formation en méthodologie et dans le domaine de recherche quantitative ainsi qu'à la gestion des bases de données en cours de préparation du system de suivi/évaluation participatif.
Production des rapports
Le réseau des ONG soutenant les peuples autochtones et les associations des peuples autochtones en charge de la mise en oeuvre du PPA travaillera en étroite collaboration avec l'ICCN, la mission de contrôle et, si nécessaire, en consultation avec la Banque Mondiale. Le réseau doit être disponible de tenir compte des rapports fournis par les peuples autochtones, la mission de contrôle, l'ICCN et par d'autres structures relevantes et aussi de la Banque Mondiale, et il présentera les rapports finaux avec les commentaires faits. Il devra également suivre et donner des rapports relatifs à la manière dont le plan d'action, les programmes et le processus de la planification des structures concernées, l'action en général et la mise en oeuvre du PPA du projet GEF-BM tient compte des résultats.
Produits à fournir et emploi de temps relatif aux résultats:
Le réseau élaborera un rapport de mission après chacune des interventions et un rapport annuel: Rédaction d'un rapport: le 31/9 de chaque année Révision et commentaires de la part de tous les dépositaires: le 15/10 de chaque année Introduction des recommandations issues de la procédure de révision: le 22/10 de chaque année Date de la présentation du rapport final: le 31/10 de chaque année
6. Time line
Voir Plan d’action du PPA du Projet GEF-BM
7. Budget
Voir Plan d’action du PPA du Projet GEF-BM
7.1. Payement
Le réseau sera payé de la manière suivante: • 30% des dépenses pour chacune des activités seront payés comme avance. • Les 70% restant seront payés lorsque le rapport final des activités et le rapport final annuel seront
fournis et approuvés.
8. Qualification des prestataires des services Les membres du réseau des ONG soutenant les peuples autochtones et les associations des peuples autochtones devront disposer d'au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de la consultation

ICCN Plan des peuples autochtones du Projet GEF-BM
Rapport Final Février 2007 58
communautaire, de la participation des peuples autochtones et du contexte de la gestion des ressources naturelles. Le réseau doit disposer de bonnes connaissances relatives à la structure et au fonctionnement du gouvernement local en RDC, au code forestier et à la gestion durable des ressources naturelles, mais aussi des peuples autochtones et il doit s'être familiarisé avec la Politique Opérationnelle 4.10 peuples autochtones de la Banque Mondiale.
Les responsables de la mise en œuvre devront avoir les qualifications et aptitudes suivantes; • Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’appui des peuples autochtones; • Des aptitudes à travailler en milieu des peuples autochtones et ceci même sous pression; • Une bonne connaissance du code forestier et de la gestion durable des ressources naturelles; • Une adresse électronique fonctionnelle; • Doivent être basés à l'intérieur de la province dans laquelle ils voudraient être employés.